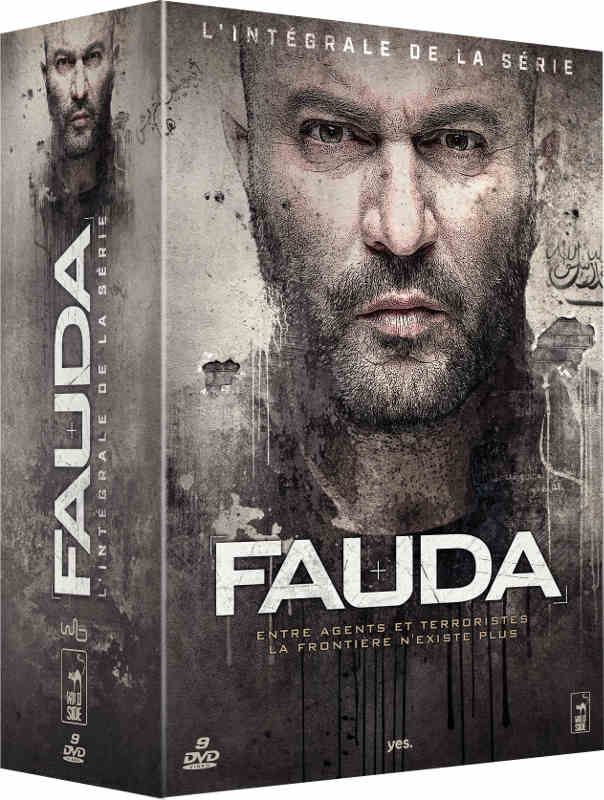L'interview Jewpop de Lior Raz, Doron dans la série "Fauda" 23 Jan 2023 3:02 AM (2 years ago)
De passage à Paris, Lior Raz a accepté de répondre aux questions de Jewpop. Nos interviews, il faut l’avouer, sont souvent bordéliques. Ça tombait bien parce que Fauda signifie « bordel », « chaos » en arabe. Et là, on a été servis.
Lior Raz, co-créateur et acteur principal de la série Fauda, nous transperce d’entrée de son regard gris acier, sa force tranquille impressionne. Notre chroniqueuse Ella Klein se présente et lui dit, histoire de donner le ton, qu’elle n’est là que pour le selfie, il sourit (NDLR : quand Doron sourit ainsi, tu oublies ton idée stupide de lui demander de poser pour la photo avec un kova tembel* sur la tête). Le boss de Jewpop, chargé de mener l’interview, n’en mène pas large. D’autant plus que quelques secondes avant d’entrer en piste, on lui glisse une liste de sujets à ne pas aborder. Bingo ! Comme à l’oral du bac : tu peux oublier les seuls sujets que tu avais révisés, c’est l’impasse totale. Nous allions devoir improviser, et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous ne sommes pas aussi performants que la team Fauda pour se sortir du chaos.
Comment on aurait aimé que ça se passe. Notre interview presque rêvée
Alain Granat : Avant de commencer, j’ai un petit cadeau Lior. C’est un livre d’humour sur les séries tv, Game of Séries.
Lior Raz : Ah super, c’est très gentil, merci beaucoup vraiment ! Ça a l’air extra !
A.G. : D’après nos infos, Dr Shirin reviendrait dans la saison 3 de Fauda, vous pouvez confirmer ?
L. R. : Je ne peux rien vous dire sur la saison 3, que nous sommes en train d’écrire, mais je vous promets qu’elle sera encore plus intense, violente, pleine de compassion et d’amour…
A.G. : Désolé d’insister, on sait bien que vous ne pouvez pas spoiler la saison 3, mais juste pour nos lecteurs, révélez-nous un truc sympa que vous avez écrit. Genre une scène où vous êtes assis dans un café, peinard en train de manger un falafel, et là il se passerait un pur truc de malades !
L. R. : Vraiment je ne peux rien vous dire, mais je note ! Les falafels, c’est vraiment une super idée ! D’ailleurs je cherche des auteurs pour notre pool d’écriture, laissez-moi votre carte.
A.G. : Vous jouez un officier du Mossad dans « Opération Finale », un film américain qui retrace la capture d’Eichmann. Votre accent allemand n’était pas assez bon pour jouer un officier nazi ?
L.R. : (rires) Vous êtes vraiment marrant ! C’est décidé, je vous prends dans mon pool d’auteurs.
Ella Klein : Pour conclure cette interview, j’ai un petit service à vous demander. Je suis la maman d’une petite fille qui est en colo depuis une semaine et je m’inquiète de savoir si elle mange bien. Vous pourriez m’expliquer comment m’infiltrer en douce là-bas pour la ramener ? (NDLR : Ella présente à Lior son smartphone avec quelques photos du lieu et le plan Google maps).
L.R. : Bon la première chose, c’est d’y aller de nuit avec une fourgonnette, et d’avoir ton équipe de soutien pas loin dans une voiture, ton mari et tes beaux-parents par exemple, en cas de coup dur. Tu te déguises en mono, tu mets un bermuda et un t-shirt pourri, mais pas des Crocs hein ! Des baskets pour ne pas faire de bruit, et surtout tu penses à prendre un chiffon imbibé d’alcool anesthésiant pour endormir la gamine, qui va hurler comme un veau en te voyant ! Facile comme mission… Et si par malheur tu es repérée, tu hurles « Fauda ! » comme dans la série, ça marche à tous les coups ! Plus de questions ? Bonne chance Ella !
hein ! Des baskets pour ne pas faire de bruit, et surtout tu penses à prendre un chiffon imbibé d’alcool anesthésiant pour endormir la gamine, qui va hurler comme un veau en te voyant ! Facile comme mission… Et si par malheur tu es repérée, tu hurles « Fauda ! » comme dans la série, ça marche à tous les coups ! Plus de questions ? Bonne chance Ella !

Comment l’interview s’est vraiment déroulée. Verbatim
Alain Granat : Avant de commencer, j’ai un petit cadeau Lior. C’est un livre d’humour sur les séries tv, Game of Séries (NDLR : le boss, co-auteur du livre avec Jonathan Demayo, ne recule devant aucune bassesse pour placer ses bouquins).
Lior Raz : Ah super, c’est très gentil, merci beaucoup, vraiment ! (NDLR : Lior est d’une courtoisie rare, mais dans son regard de sabra taciturne, tu peux voir « je pige pas un mot de français, je vais le lire comment ton bouquin, avec Reverso ? »).
A.G. : D’après nos infos, Dr Shirin reviendrait dans la saison 3 de Fauda, vous pouvez confirmer ?
L.R. : (regard alternant effarement et immense lassitude) D’abord, je ne peux rien vous dire sur la saison 3, que nous sommes en train d’écrire… Mais Shirin, si je me souviens bien de la saison 2, est… (NDLR : Lior est définitivement un as pour éviter tout spoil)
A.G. : Désolé d’insister, on sait bien que vous ne pouvez pas spoiler la saison 3, mais juste pour nos lecteurs, révélez-nous un truc sympa que vous avez écrit. Genre une scène où vous êtes assis dans un café, peinard en train de manger un falafel, et là il se passerait un pur truc de malades !
L.R. : Je ne comprends pas votre question. Il se passerait quoi ? Pourquoi je mangerais un falafel ? (NDLR : regard mode interrogatoire Fauda, intérieur jour, sous-sol du Shabak, accessoires : une baignoire remplie d’eau glacée). Je vous ai dit que je ne peux rien révéler de la saison 3 (NDLR : grand moment de solitude, tu te sens un peu comme Kev Adams qui vient de faire un sketch avec l’accent chinois #fail), mais je vous promets qu’elle sera encore plus intense, violente, pleine de compassion et d’amour.
A.G. : Vous jouez un officier du Mossad dans « Opération Finale », un film américain qui retrace la capture d’Eichmann. Votre accent allemand n’était pas assez bon pour jouer un officier nazi ?
L.R. : (rires) Ben Kingsley, qui joue Eichmann, n’a pas d’accent allemand. C’est une distribution internationale, j’ai un accent israélien quand je parle anglais, Mélanie Laurent a un accent français, et David Isaac un accent américain. Et puis vous savez, il y avait à cette époque des gens de toutes nationalités dans les rangs du Mossad (NDLR : dans le regard de Lior se lit soudain : « Est-ce que j’ai une tête à jouer un putain d’officier nazi ? »).
Ella Klein : Pour conclure cette interview, j’ai un petit service à vous demander. Je suis la maman d’une petite fille qui est en colo depuis une semaine et je m’inquiète de savoir si elle mange bien. Vous pourriez m’expliquer comment m’infiltrer en douce là-bas pour la ramener ? (NDLR : Ella présente à Lior son smartphone avec quelques photos du lieu et le plan Google maps).
L.R. : (rires) (NDLR : rire nerveux sur le mode « j’en peux plus de leurs questions à la con ») Mais ne faites pas votre mère juive, foutez-lui la paix à votre fille ! « My only advice, let her live her life ! » (NDLR : on vous le met en anglais pour la sensation !).

Ensuite on a fait de jolies photos pour nous la péter sur les réseaux sociaux et on est allés boire un coup pour nous remettre de nos émotions. On l’a trouvé super cool Lior Raz en vrai. Et tellement Doron.
Alain Granat et Ella Klein
*kova tembel : en hébreu, chapeau d’idiot, un bob de forme conique, emblématique des années cinquante, soixante et soixante-dix en Israël.
Commander l’intégrale des saisons 1, 2 et 3 de Fauda sur fnac.com
© photos : DR
Article publié le 17 juillet 2018. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop
Erri De Luca : « Le yiddish est une langue blessée à mort qui vit une forme de résurrection » 23 Jan 2023 3:02 AM (2 years ago)
Erri De Luca, comme Clint Eastwood, ne vieillit pas. Il revient avec un roman, Le Tour de l’oie, publié chez Gallimard. Après avoir reçu le prix Femina en 2002 pour Montedidio et le Prix européen pour la littérature en 2013, il livre à Jewpop le témoignage intime d’une parole rare.
L’interview Jewpop de Erri De Luca
Alexandre Gilbert : Erri de Luca, vous avez été maçon, chauffeur de convois humanitaires en ex-Yougoslavie, écrivain, poète, activiste d’extrême-gauche et même membre du jury du Festival de Cannes en 2003, quelle est la suite ?
Erri De Luca : Je suis coproducteur d’un film américain en préparation. Il s’agit d’un scénario bouleversant que j’ai pu lire et encourager, et qui est produit par mon amie Paola Bisson de Oh!Pen film. C’est un film de Michael Mayer, qui a déjà réalisé Out in the Dark. Il s’appellera Happy Times.
A.G. : Cette énergie vitale qui passe par la pratique de l’escalade, vous la tenez de votre père chasseur alpin. Comment a-t-il vécu la guerre contre la France puis son invasion par les fascistes ?
E.D.L. : Mon père était soldat en Albanie, sur les montagnes de Grèce. J’ai bien connu le coup de poignard de l’Italie à la France quand j’étais ouvrier du bâtiment en France et quarante ans après, les vieux ouvriers me le reprochaient encore.
A.G. : Est-ce pour mieux comprendre l’histoire de ce père que vous apprenez le yiddish ?
E.D.L. : Le yiddish est une langue blessée à mort qui vit une forme de résurrection. En l’apprenant, j’ai voulu contribuer à sa réintroduction. Le yiddish me renvoie à mon appartenance à la première moitié du siècle dernier, lorsque je n’étais pas encore né. Il m’a permis de m’inscrire dans le grand registre du XXe siècle qui comme moi, a vécu des révolutions et des migrations, pour libérer les peuples de la domination coloniale. J’ai appartenu à cette dernière génération révolutionnaire et fait partie de la queue de l’émigration ouvrière italienne.
A.G. : Son héritage c’est aussi la transmission de son dialecte, le napolitain ?
E.D.L. : Le napolitain est mon yiddish à moi, ma langue maternelle, voir ma langue « grand-maternelle ». Il emmène avec lui les odeurs des cuisines, des poubelles, des grains de café et de morue.
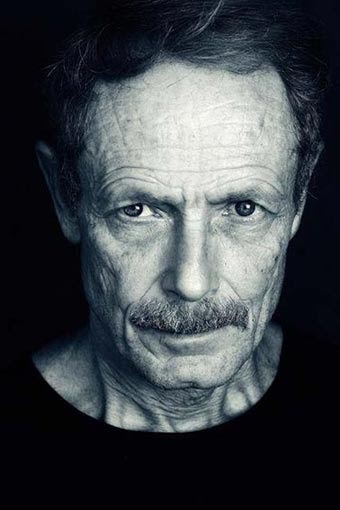
A.G. : Les odeurs que vous évoquez ne sont-elles pas également celles de l’île d’Ischia ?
E.D.L. : Ischia est l’île de mon enfance et de mon adolescence estivale. C’est l’île où j’ai grandi centimètre par centimètre, car je grandissais uniquement au soleil. J’ai appris à pêcher le poisson sur des petites embarcations modestes, et à utiliser exclusivement la force de mes bras. J’ai appris à prendre la mer au sérieux, ses risques et ses blessures.
A.G. : Le goût du risque et de la responsabilité, l’avez vous retrouvé dans l’action politique en France ?
E.D.L. : L’histoire des mouvements sociaux français est radicalement plus cohérente que celle de l’Italie. Surtout lorsqu’on voit ce qu’est le mouvement 5 Étoiles. Cette question ne se pose tout simplement pas là bas.
A.G. : À l’heure du crépuscule des idoles marxistes, alors que la force des populistes prime le droit, comment réagissez vous à l’arrestation du révolutionnaire Cesare Battisti, en cavale depuis plus de trente ans ?
E.D.L. : La chasse aux derniers des Mohicans est presque terminée. Son extradition en Italie contredit la loi brésilienne qui n’admet pas cette démarche vers un pays qui applique la peine à perpétuité. Mais les lois sont soumises aux caprices des vainqueurs.
A.G. : Parmi les auteurs d’extrême droite que vous avez lu, n’y a-t-il pas eu Louis-Ferdinand Céline ?
E.D.L. : Ma lecture du Voyage au bout de la nuit s’intercale dans une période bien agitée de ma vie, où j’ai pu partager une semblable acidité voir une amertume similaire d’esprit avec le narrateur. Mais c’est la fin des coïncidences avec lui. Je ne partage pas son style. D’ailleurs, je ne crois même pas en avoir un. Don Quichotte est mon livre préféré de la littérature moderne. Je m’identifie surtout à son cheval, l’animal le mieux réussi parmi ceux que j’ai pu lire.
A.G. : Dans Le Tour de l’oie, le narrateur ne parle plus à Rocinante mais à son fils, tel un vieux Gepetto dont la conception de l’attente rejoint celle de la pensée juive. Une dernière question : que vous reste-t-il à attendre de l’existence ?
E.D.L. : Qu’elle puisse se poursuivre encore un peu et continuer à me surprendre.
Entretien réalisé par Alexandre Gibert.
Lire les articles d’Alexandre Gilbert sur Jewpop
Commander Le Tour de l’oie de Erri de Luca (2019, Gallimard) sur le site Librairie Gallimard
© photos et visuels : DR
Article publié le 9 mars 2019. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2019 Jewpop
Bagneux, ton univers impitoyable 23 Jan 2023 3:00 AM (2 years ago)
J’ai découvert récemment que Bagneux était aussi une ville. Avec son quota de HLM, de pressings, de Franck Provost et de boulangeries. Pour moi, Bagneux c’était juste le nom d’un cimetière. À force d’entendre mes parents dire « on va encore à Bagneux », ce nom était rentré dans mon inconscient comme un lieu exclusivement dédié aux enterrements. Je n’avais jamais imaginé que de vrais gens pouvaient habiter Bagneux. J’étais stupéfaite. Un peu comme le jour où, en première année de maternelle, j’ai découvert que je ne m’appelais pas « boubelè zis maindélè shein »*, mais Ella, en quatre lettres. Et au fil du temps, j’ai commencé moi aussi à me rendre à Bagneux. Et j’ai décelé des choses que personne ne m’avait racontées.

J’ai d’abord observé que les allées de Bagneux en voiture, c’est un peu comme Mario Kart. Plein de parallèles (non ça c’est Pac-Man, ceci dit), pas de feu rouge, pas de sens interdit, pas de limitation de vitesse. Le but est d’arriver en premier afin de garer sa voiture dans le bon sens pour repartir. Au premier bruit de moteur du convoi, une désorganisation méthodique se met en place. Une course-poursuite s’organise. Joseph, un grand-oncle habitué des lieux, qu’il fallait covoiturer depuis la Place des Vosges, me lance : « Ella, vite ! Prends le rond-point à gauche dans l’autre sens ! Ils vont tous passer par l’allée centrale, nous on va contourner par la parallèle, on arrivera en premier et on pourra mettre la voiture au plus près ». Trois voitures me suivent. Je me fais presque doubler ! Des voitures sont déjà garées. Nous sortons et rejoignons le groupe alors que commence l’éloge de Lucette Abitbol.
Joseph : On s’est trompé ! C’est pas l’enterrement d’Hannah !
Simon (son frère, qui nous avait suivi) : Y a des séfarades enterrés à Bagneux ? Ils sont pas tous à Pantin ?
Joseph : Faut croire… Il paraît qu’il y a aussi des goys, tu savais ? Ha regarde, c’est la tombe de Max ! Incroyable, ils l’ont mis à côté d’Isaac ! Ils se détestaient déjà en Pologne et encore plus en arrivant à Montreuil. Et maintenant ils sont à côté, Oï vey ! Tu sais, d’ailleurs sa soeur Haya, elle…
Simon : Red nicht** Joseph, Sarah t’écoute !
Joseph : Arrrh. Si on peut plus rien dire… Ella, en voiture, on file !
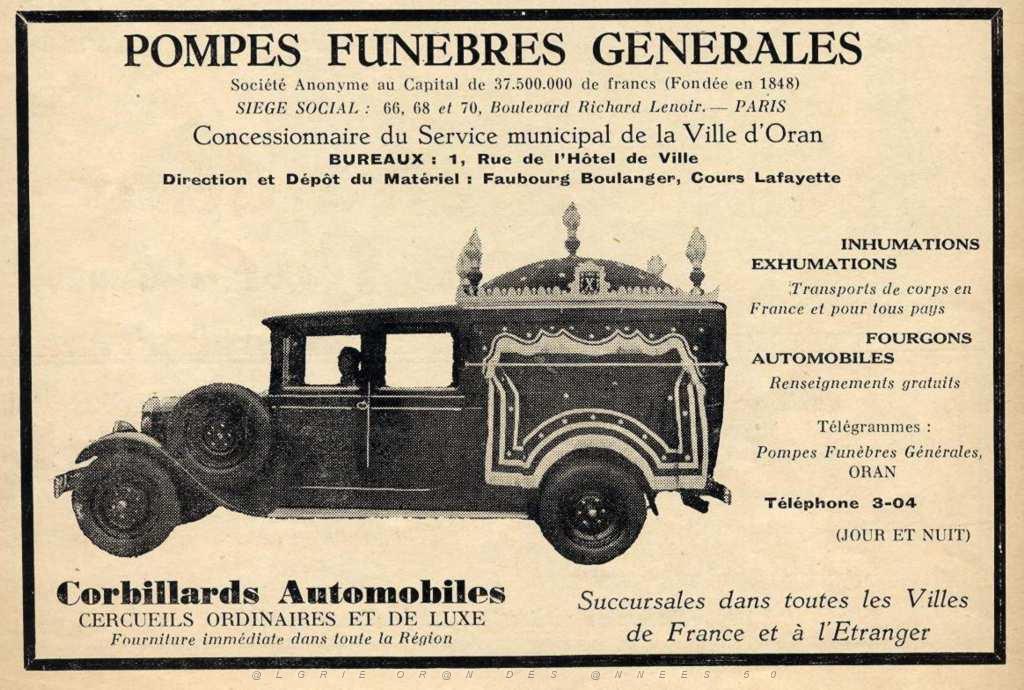
On devrait dire à Waze de répertorier les divisions. Car pour éviter le trafic on est au point, mais alors pour retrouver à temps le bon enterrement, on est à l’abri de rien et surtout pas d’une cérémonie « sfarde », comme ils disent sans prononcer le « é ».
Nous arrivons pile au moment du discours. Le Grand Rabbin Olivier Kaufmann, retenu pour une cérémonie des déportés, est remplacé au pied levé par un rabbin inconnu de la famille, qui, ne sachant pas que Szjtein se prononce « chteïn », se trompe plus de dix fois en récitant le nom de la famille, oubliant au passage une sœur dans son éloge et saccageant l’hommage dû à la défunte. Je vous passe les débats interminables ayant précédés l’enterrement, sur les volontés de Hannah que l’on récite ou non le Kaddich, prière qui sera finalement lue par un frère, mais successivement interrompue par la mélodie endiablée de bal beli oto d’un téléphone portable, puis par le bruit des menus centimes que le type de la Tsedaka agite ostensiblement dans sa tirelire en conserve à l’effigie du Rabbi Loubavitch.
Arrive le moment de verser une poignée de terre sur le cercueil, après avoir attendu 15 minutes à la queuleuleu entre les tombes dans un froid polaire (j’ai remarqué qu’il faisait toujours froid à Bagneux, même le 15 août, ça doit venir de l’anticyclone de Cracovie), où immanquablement, Joseph se trompe et jette 4 pièces dans le caveau au lieu de vider sa petite pelletée de sable. Enfin, tout le monde se retrouve dans l’allée, y compris le shnorrer*** de service. Vous savez, celui qui n’a pas vu la famille depuis des années, dont on sait à peine comme il a été informé de la nouvelle. Celui qui vient pour le pickel et les harengs, et qui se lève le premier pour porter le cercueil avant la mise en terre. Celui dont la logorrhée verbale est pire que la drasha d’un rabbin bac -5. Celui qui, comme à chaque fête, vous demande, « alors Ella, t’en es où toi, t’as pas un petit chéri ? Tu sais, j’ai bien connu ta tante qui… ». Il est interrompu (et moi sauvée), par un ancien élève de Hannah du temps où elle enseignait à l’école publique près de République. Romain Dasguerres se présente et me demande, gêné :
« Excuse-moi, tu as l’air de bien connaître la famille. Pourquoi ils me demandent tous « à qui le tour ? »
Et moi de lui répondre : « mais non, ils te disent a git your**** » !
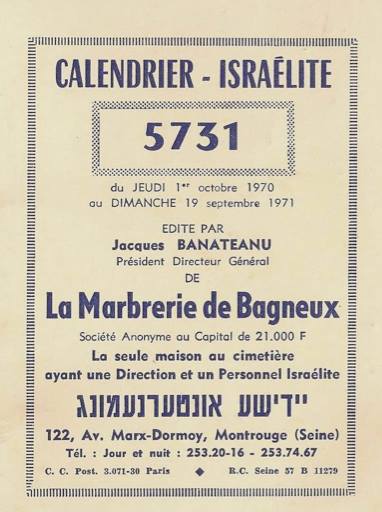
Je suis repartie seule, laissant sur place Joseph qui voulait profiter du déplacement pour faire une grande tournée. Dans ma voiture, j’ai repensé à la phrase de Woody Allen « si l’au-delà existe, c’est à quelle distance du centre ville ? C’est ouvert jusqu’à quelle heure ? ». Et j’ai médité…
Du burlesque de la situation, je me suis souvenue de mes grands-parents. Des chaises pliantes marron et ocre. Du goût des cornichons au tonneau. Du tchaïnik électrique. Des parties de bridge et de rami. Du sachet de thé que l’on ne jette pas, mais que l’on partage à 3 tasses.
Alors c’est sûr, on ne meurt qu’une fois. Et un enterrement, c’est pas comme un mariage, on ne choisit pas ses invités, ni à côté de qui on veut être placé. On a pas non plus de deuxième chance (ni de troisième). Et après ? Après, il y a tout le reste. Tout ce qui nous est cher. Qui marque nos sens. Ce qui ressuscite au détour d’un accent entendu dans le métro. Ce qui maintient l’émotion intacte. Tout ce que cette génération nous a laissé en héritage. L’humour en premier. À la vie. Lehaim.
Ella Klein
* en yiddish : « ma beauté de petite fille »
** en yiddish : « Tais-toi ! »
*** en yiddish : « profiteur, tapeur »
**** en yiddish : « bonne année ! »
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Enregistrer
Des Juifs d’Afrique du Nord au Pletzl ? Une présence méconnue et des épreuves oubliées (1920-1945) – 1ère partie 23 Jan 2023 2:57 AM (2 years ago)
L’histoire méconnue des Juifs d’Afrique du Nord dans le quartier parisien du Pletzl dès l’entre-deux-guerres, par l’historien Jean Laloum.
Le 10 septembre 1919, Moïse Amar, ministre officiant originaire d’Alger et domicilié rue François Miron à Paris (4e), adresse une supplique au président de l’Association consistoriale israélite de Paris (ACIP) en vue des fêtes de Tichri : Le soussigné, au nom des Algériens habitant le 4e arrondissement, a l’honneur de vous informer que nous avons l’intention de nous réunir, afin de pouvoir célébrer ces fêtes solennelles. Vous n’ignorez pas que la plupart de ces fidèles n’ont pas les moyens de retenir une place dans les autres temples de Paris et que si vous nous autorisez l’ouverture dans un de vos locaux de la rue des Francs Bourgeois ou de la rue des Tournelles, nous accueillerons avec une immense joie, cette demande légitime. Je viens donc en leurs noms, vous supplier
de prendre en considération cette circonstance et de nous accorder cette faveur […] 1.
Or on associe généralement la population juive du quartier du Marais dans l’entre-deux-guerres aux yiddishophones qui l’habitent massivement. De fait, le terme Pletzl ne signifie-t-il pas « petite place » en yiddish ? Mais si cette équation est bien fidèle à la réalité, elle n’exclut pas que d’autres populations aient pu également y apposer leur marque, comme ces Juifs d’Afrique du Nord qui, dès le début du XXe siècle pour certains, ont traversé la Méditerranée, venant essentiellement d’Algérie, Français donc pour l’écrasante majorité d’entre-eux. Leur présence est suffisamment significative et originale pour qu’on se penche sur leur sort, levant du même coup le voile de l’oubli sur l’une des facettes méconnues, sinon totalement ignorées, de l’histoire de ce quartier emblématique.

Des hommes marchant rue des Rosiers au niveau du numéro 7, photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.
Mais avec quelles sources, avec quelles méthodes, se dira-t-on, faire ressurgir ce passé enfoui ? Une grande partie des archives permettant de redécouvrir cette présence dans le quartier Saint-Gervais de l’entre-deux-guerres sont celles qui, constituées pour les besoins de la persécution durant la période de l’Occupation, sont conservées pour la plupart aux Archives nationales et au Centre de documentation juive contemporaine, mais aussi à Yad Vashem à Jérusalem. Les listes de recensement, les fichiers et dossiers d’aryanisation économique, les fiches d’internement et les listes de convois de déportation, tout comme les missives adressées par les intéressés au Commissariat général aux questions juives (CGQJ), sorte de ministère de l’antisémitisme de 1941 à 1944, les lettres de dénonciation enfin, livrent en effet autant d’informations qui, une fois recoupées, renseignent sur l’état civil, l’adresse, la profession ou la date d’arrivée en métropole. Une fois ce premier maillage documentaire réalisé, d’autres sources permettent de broder d’autres motifs sur la trame ainsi formée : les archives de l’Association consistoriale israélite de Paris pour la dimension de l’entraide et du culte ; le témoignage surtout, source importante d’information sur l’arrivée, l’installation et la spécificité du mode de vie de ces populations. L’histoire orale ayant en outre l’immense avantage à nos yeux de restituer une histoire plus enveloppée de chair, nous en avons usé sans modération.
Le Marais des Juifs d’Afrique du Nord entre les deux guerres
Yad Vashem conserve un document répertorié sous le nom de « collection Georges Epstein », également présent sous forme de microfilm au CDJC. Il dresse pour l’année 1941 un inventaire démographique détaillé – par arrondissement, rue, numéro – de la population juive parisienne, associée à son activité professionnelle (2). Ces listes constituent l’état le plus complet disponible sur l’implantation parisienne des Juifs d’Afrique du Nord au début de l’Occupation. Il faut en revanche recourir à d’autres sources pour en apprendre davantage sur leur lieu de naissance ou leur date d’arrivée en métropole. Cette documentation croisée montre en tout cas que la population juive originaire d’Afrique du Nord est en 1941 une réalité bien vivante dans le quartier Saint-Gervais, surtout dans sa partie sud, et plus précisément en amont de l’axe que constitue la rue de Rivoli, dans les rues François Miron, Saint-Antoine, des Jardins Saint-Paul, de l’Ave Maria, du Figuier ou de Fourcy, des Barres, Geoffroy L’Asnier ou encore les impasses Guépine et Putigneux. Sur les 79 personnes répertoriées rue François Miron, 22 sont originaires d’Afrique du Nord comme 19 des 60 résidents de la rue Saint-Antoine. La proportion est plus grande encore dans les rues de Fourcy et des Barres : respectivement 10 personnes sur 23 et 7 sur 13. Cette implantation préférentielle n’exclut pas néanmoins une présence nord-africaine au cœur même du Pletzl, rues des Rosiers, des Écouffes et alentour : sur les 179 personnes recensées rue des Rosiers 13 sont originaires d’Afrique du Nord – soit les familles Touboul, Sarfati, Amsellem, Halimi, Banon, Benhaqui, Dray, Haim, Lévy, Sassi, Sebaouni, Tiar, Zittoun, etc. Sur les 187 personnes recensées rue des Écouffes, 12 ont cette même origine (3). Comme le montre le kaléidoscope d’histoires familiales que nous avons recueillies, l’arrivée en métropole a des causes multiples : engouement profond pour la France, raison familiale ou encore retombée des poussées de violence pogromistes qui affectent l’Afrique du Nord. Ainsi les émeutes antijuives liées, à la charnière des XIXe et XXe siècles, à l’affaire Dreyfus poussent-elles la famille Gharbi à quitter Alger pour Marseille, où Isaac Gharbi parvient difficilement à subvenir aux besoins de ses sept enfants, avant que la famille ne « monte » à Paris en 1926. « Mon pauvre grand-père, se souvient Roger Gharbi, vendait des jumelles aux touristes sur les paquebots marseillais, pour nourrir sa nombreuse famille (4) ».

Photo issue d’un album offert au MAHJ par Laurent de Commines. L’album fut retrouvé dans les affaires de ses grands-parents maternels (Français d’Algérie installés à Souk-Ahras) mais ne leur appartenait pas. Le donateur indique que ses grands-parents avaient des amis journalistes à Constantine dans les années 1930. La photo a été prise dans une rue de Constantine après le pogrom du 5 août 1934, durant lequel 27 personnes furent assassinées, dont 25 citoyens français de religion juive, parmi lesquels 5 enfants (âgés de quelques mois à 10 ans) et 6 femmes. Cette photo figure dans le catalogue de l’exposition « Juifs d’Algérie » (MAHJ/Skira-Flammarion, 2012)
De même, le pogrom de Constantine du 5 août 1934 eut un retentissement considérable en Algérie, particulièrement chez les Juifs du Constantinois, provoquant le départ, quelques mois, voire parfois des années plus tard, des familles Allouch, Chamak, Dana, Zekri et Fhal (5). Après une traversée mouvementée, Yossef Allouch arrive à Paris en 1934. De la Pointe Rivoli, son premier domicile, la famille déménage successivement dans un hôtel de l’impasse Guépine, puis rue Geoffroy L’Asnier, pour se fixer au 12 rue de Fourcy. C’est aussi dans un hôtel au 34 de la rue du Roi de Sicile, en plein quartier du Marais, que descendent en 1936 Albert Ruben Chamak et sa nombreuse famille, avant de déménager, un à deux ans plus tard, à l’hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron. Messaoud, dit Albert, Dana, son épouse Léa et leurs douze enfants s’établissent en 1937 rue des Coutures Saint-Gervais, dans le 3e arrondissement. Passés d’abord par Marseille, Daniel Zekri et sa famille logent dans un hôtel parisien du quartier Strasbourg Saint-Denis pour se fixer finalement rue de Fourcy. La famille Fhal s’établit également à Marseille avant de gagner la capitale où Esther, la mère, décède quinze jours après son arrivée. Après un hôtel de la rue François Miron, le veuf, Joseph, et ses enfants habitent un temps Vincennes, puis rue du Fauconnier, enfin rue François Miron à nouveau.
“Je préfère manger du pain et de l’eau en France que du poulet rôti en Algérie”
C’est en revanche l’amour de la France qui, en 1936, conduit en métropole Isaac, dit Jacques, Assuli, tailleur à Oran. Sentiment si enraciné chez lui qu’il avait même inventé une sorte de dicton, se remémore Huguette, sa fille (6) : « Je préfère manger du pain et de l’eau enFrance que du poulet rôti en Algérie ». La famille s’installe en plein coeur du Pletzl au 26 de la rue des Rosiers. Ancien combattant et gazé de la Grande Guerre, Isaac Arous, aveugle désormais, est devenu incapable d’exercer son métier de maître bottier à Alger. Sa famille décide de rallier la France au début des années vingt (7). Installée dans un premier temps rue des Barres, elle gagne en 1926 l’immeuble de la Fondation Fernand Halphen construit cette même année dans l’île Saint-Louis, au 10-12 rue des Deux-Ponts (8). La famille Sebbane, pour sa part, quitte en 1938 sa ville natale de Nemours, en Oranie, pour s’installer au 43 rue Vieille-du-Temple dans un immeuble situé vis-à-vis de la rue des Rosiers. Nous sommes arrivés pour des raisons familiales, explique Jeannine, l’une des filles ; on avait un frère qui déjà habitait Paris et notre situation n’était pas brillante à Nemours, donc notre frère aîné a cru bon de nous faire venir à Paris et nous étions déjà six enfants, ce qui n’était pas facile. Mon père en Algérie était menuisier, et il avait repris un travail chez Renault à Paris, il n’a pas travaillé très longtemps et malheureusement il est mort en 1941 d’un chaud et froid (9).
C’est aussi pour rejoindre les fils aînés que la famille Alzerat quitte Bône en 1936. René, l’aîné des frères, héberge alors sa mère M’Rhaïma – dite Marie, et ses cadets à son domicile, 26 rue de Rivoli (10). Pourquoi donc, s’interroge Roger Alzerat, ses frères avaient-ils quitté l’Algérie ? Parce qu’ils avaient envie de s’expatrier en France à l’époque, peut-être pour le travail. C’est plutôt la jeunesse qui a envie de bouger. C’est d’abord René l’aîné qui part. Ensuite il fait venir Alex, Jacques vient après, puis mon frère Maurice. Mon frère aîné devait avoir une vingtaine d’années. À Bône il était bijoutier. Il avait une boutique de bijouterie or. Mardochée Ohnona natif de Salé au Maroc, lui, est fils unique. Il vient en France en 1937 à l’âge de 12 ans, après la mort de sa mère, en compagnie de ses oncle et tante, Ayache et Freha Suissa, et de leurs enfants, David et Esther. La famille élargie s’installe rue Charlemagne (11). Dans cette partie sud du quartier Saint-Gervais, ces familles se sentent un peu comme dans un village, vivant dans une grande proximité, en circuit fermé.
[…] tout le monde se connaissait, se remémore Raymond Chamak. Il y avait les familles Allouch, les familles Taïeb, les Gharbi, les Allali, toutes les communautés juives d’Afrique du Nord et, passé la rue de Rivoli, c’était les Juifs ashkénazes, c’étaient les Juifs polonais, ceux qui arrivaient de Pologne. Sitôt qu’il y en avait une [personne] qui était malade, témoigne de son côté Pierre Allouch, toutes les autres le savaient, sitôt qu’il y avait une fête ils se regroupaient tous chez les uns et chez les autres, ils faisaient ce qu’ils avaient connu en Algérie, il paraît qu’à Constantine c’était comme ça, ils vivaient les uns sur les autres, quand il y en avait un qui avait fait la loubia (12), cela sentait, « tiens, il a fait la loubia ». Beaucoup, comme Lucienne Bibi-Roubi évoquant les rues de son enfance, perçoivent la rue de Rivoli comme une véritable frontière : « […] ce côté là on va dire était Afrique du Nord, et l’autre côté, Europe centrale (13). » Un sentiment largement partagé par André Cohen qui, justement, habitait avant-guerre sur cette « frontière » : « il est évident, que ce quartier était divisé en deux zones en ce qui concerne les Juifs, d’un côté de la rue Rivoli, rue François Miron, il y avait tout ce quartier qui était plutôt fréquenté par les séfarades […] 14 ».
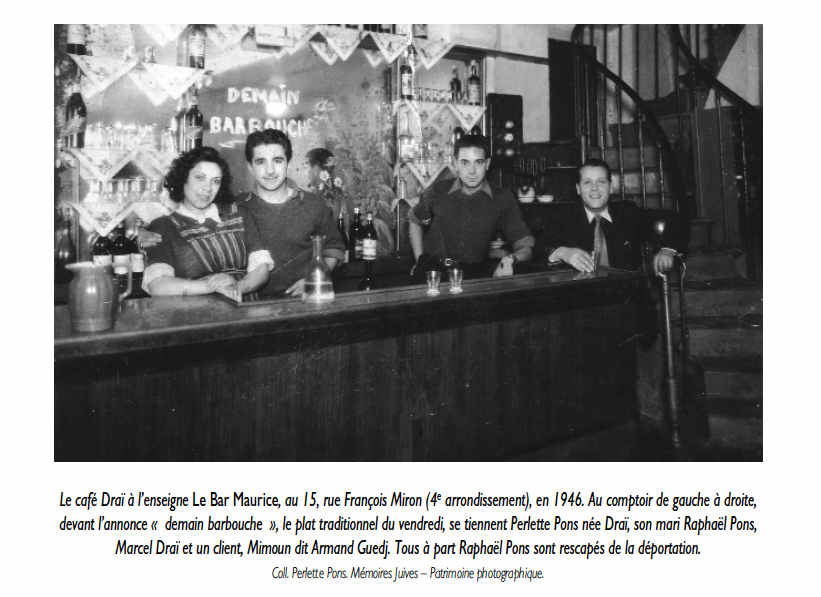
L’aspect « village » est encore accentué par la présence de nombreux cafés et restaurants tenus par des natifs d’Afrique du Nord, qui sont des lieux privilégiés de la convivialité. Pas moins de cinq établissements dans la seule rue François Miron : Gharbi au 7, Draï au 15, Bouanich au 30, Elbaz au 46 et Sabba au 50, et trois rue de Jouy : Chich au 23, Tiar au 25 et Mimoun au 30 (15). C’est chez Bouanich que Yacoub Sebbane aime retrouver des amis, comme lui natifs de Nemours. Certains qui se sont éloignés du quartier ne songent qu’à y retourner ou au moins à s’en rapprocher. Lorsque après le décès de son épouse Joseph Fhal se trouve dans l’obligation de partir habiter Vincennes, il livre une véritable guérilla à ses enfants pour les contraindre à y revenir : « Mon père, se souvient sa fille Louise, il nous faisait une vie parce que là-bas il n’y avait pas d’Algériens, il n’y avait personne. Nous sommes restés à peu près six mois, il ne voulait plus qu’on reste. Alors on est descendu sur Saint-Paul […] ». La même raison pousse Moïse Vidal et sa nombreuse famille à quitter le quartier des Halles pour le Marais : Mon père voulait un quartier juif, se rappelle Lucienne Bibi-Roubi, et c’est là qu’on a échoué, en premier lieu, rue des Écouffes, au numéro 22. Mon père, de son plein chef, a loué un petit appartement où il n’y avait ni confort ni rien dedans, mais enfin on était déjà dans le quartier. Ensuite évidemment, toutes les filles grandissaient, ce logement était trop petit, donc après ce 22, rue des Écouffes on a habité au 7, rue François Miron.
Un petit peuple industrieux
Les Juifs originaires d’Afrique du Nord travaillent dans tous les secteurs d’activité. Certaines professions toutefois sont particulièrement représentées (16), à commencer par celle de marchand de quatre saisons. La profession, plutôt féminine, mobilise l’ensemble de la famille au quotidien. C’est un métier d’opportunité, fruit d’une reconversion professionnelle rapide. Son exercice est néanmoins tributaire de l’obtention d’une médaille professionnelle auprès de la Préfecture de police. Pour suppléer son mari aveugle, Esther Arous obtient en 1923 cette médaille (17). Isaac néanmoins seconde son épouse jusqu’à sa mort, sous les roues d’un camion, au début des années trente. Esther, veuve avec encore quatre enfants à charge – l’aînée, Marie, s’est mariée entre temps, doit alors continuer seule : Après, raconte Jeanne, l’une de ses filles, c’est ma mère qui s’est dirigée toute seule pour faire les Halles, pour charger sa voiture […]. Elle se levait très tôt. Nous on savait qu’on devait aller à l’école, on se levait à telle heure et puis on se préparait. C’était ma sœur Diamante surtout qui s’occupait de nous puisqu’elle était au dessus de nous [entendre : plus âgée que nous], mon frère Prosper non, parce que lui travaillait, il était télégraphiste à la Poste à ce moment là, […]. Maman quand elle rentrait, c’était huit heures, huit heures et demi, et comme elle avait une coupure l’après-midi, – vous savez les marchands de quatre saisons c’était le matin et puis le soir –, donc elle avait une coupure par exemple de une heure et demie à quatre heures, elle reprenait à quatre heures. Donc elle revenait. Elle était rue de La Grange, ce n’était pas loin. Elle traversait le Pont de l’Ile Saint-Louis, le petit pont qui est vers le Jardin Notre Dame pour aller à la maison, donc ça ne faisait pas loin. Elle préparait le repas pour le soir et quand elle rentrait on se mettait tous à table, et puis on discutait […].
Yossef Allouch, ouvrier épisodique chez Renault, seconde son épouse : spécialisé dans la banane, il achète aux Halles la marchandise qu’elle se charge d’écouler rue Clerc, dans le 7e arrondissement. Albert Ruben Chamak, ancien peintre en bâtiment à Constantine, puis cheminot gare Montparnasse, finit par quitter son emploi pour aider sa femme Louise : il achète les légumes aux Halles ; elle les écoule rue Saint-Antoine. Même reconversion pour Messaoud-Albert Dana, primitivement cordonnier. La famille de Reine Vidal, née en mars 1890 à Alger, gagne la France en 1924. D’abord cuisinière dans divers restaurants du faubourg Montmartre, Reine obtient sa médaille en mai 1925 (18). Elle exerce boulevard Raspail alors qu’elle est domiciliée avec les siens rue de la Verrerie, puis rue François Miron. Moïse son mari, né à Médéa en avril 1879, blessé aux Dardanelles en 1915 et titulaire d’une pension d’invalidité, travaille comme ouvrier spécialisé en usine. À cette époque-là, se rappelle leur fille Lucienne Bibi-Roubi, le commerce marchait énormément, c’est ma grand-mère qui nous a pratiquement élevé, moi ma grand-mère je l’appelais « Maman » et ma mère je l’appelais « Manrenette ». Quand ma mère rentrait du travail très fatiguée, la table était prête puisque ma grand-mère vivait avec nous, ma mère mangeait puis se mettait au lit et ma grand-mère comptait la recette et alors elle étalait les billets, ‘Là Hébarek, Là Hébarek (19), ma fille que le Bon Dieu te donne la santé !’ […].
D’autres métiers de circonstance permettent à nombre de chefs de famille de subvenir aux besoins d’une famille souvent nombreuse. Ayache Suissa est commerçant ambulant en thé, épices et condiments. Équipé de deux grosses valises dans lesquelles il stocke sa marchandise, il écoule ses produits auprès des populations arabes de la proche banlieue parisienne. C’est d’ailleurs l’un des rares indices que nous ayons de l’existence de rapports commerciaux entre les populations arabo-musulmane et juive, avec celui des marchandises proposées par
l’épicerie de la Veuve Boukhalter au 68 rue François Miron qui, précise l’administrateur provisoire (20) en mai 1941, « étaient destinées à des Arabes, qui formaient sa seule clientèle (21) ». Le quartier compte aussi nombre de chineurs, au nombre desquels les marchands ambulants Abbou, Benharouch, Kersenti, les marchands forains Benamou, Bensoussan, Califat, Charbit et Dahan ou encore le brocanteur Banon domicilié au 25 de la rue des Rosiers. Le « chineur » ou « brocanteur », écrit Lou Helvasser, était plus proche du chiffonnier que de l’antiquaire. Poussant une voiture à bras en criant « habits, chiffons, ferrailles à vendre » ils récupéraient tout ce qui était récupérable « vieux matelas, vieux duvets, vieux papiers, métaux : cuivre, bronze, tuyaux de plomb » qu’ils allaient revendre au poids rue des Jardins Saint-Paul, chez Cukierman, Griziwatz et les deux frères Munster (22).
Parmi les autres métiers représentés, citons encore les employés de commerce – ainsi Daniel Zekri, père de sept enfants, travaille-t-il chez le négociant en tissu bien connu Bouchara – et les coiffeurs. Six salons de coiffure sont installés au sud du quartier Saint-Gervais (23) tandis que celui de Maurice Albou fait cavalier seul au 52 rue du Roi de Sicile (24). Notons, sans surprise, les difficultés accrues rencontrées dans les années trente par les frères Alzerat pour s’insérer dans le monde du travail parisien : Ils ont commencé, raconte leur puîné Roger, à chercher du travail – il n’y avait pas de travail, ils sont à l’hôtel, dans le 4e arrondissement je pense. Ils ont fait tous les métiers car même comme coiffeur il n’y avait pas de travail. C’était à une époque où le travail était très difficile. [René, l’aîné] a réussi à s’installer en reprenant son ancien métier de bijoutier, travaillant pour un bijoutier, pour une maison qui était dans le Marais. Au début ils ont fait tous les métiers du monde pour gagner leur vie.
Festoyer, s’amuser, prier comme au pays
Les cafés et restaurants des rues François Miron et de Jouy, on l’a dit, sont nombreux et accueillants. Ce que j’ai en mémoire de ce quartier, se remémore avec plaisir André Cohen, c’est que rue François Miron par exemple, il y avait un nombre de cafés très important avec des terrasses, il y avait le café Jaïs qui fait l’angle rue François Miron avec la rue de Jouy, avec une grande terrasse, il y avait le grand café Lalo, Juif d’Afrique du Nord, un très grand café. Je sais que tous ces gens qui fréquentaient ces cafés étaient soit d’Algérie, soit de Tunisie – il y en avait très peu –, Maroc très peu aussi, ils étaient essentiellement d’Algérie. Il y avait aussi un autre café qui s’appelait Draï, presque en face de l’école maternelle qu’il y a rue François Miron. Il y avait un restaurant qui était en plein quartier ashkénaze, c’était une famille Cohen, un restaurant séfarade en plein dans la rue des Rosiers, juste un petit peu après Goldenberg, un très grand restaurant. Il y avait une épicerie très importante qui s’appelait Haury, à l’angle de la rue François Miron et de la rue Tiron, là il y avait tous les produits possibles et imaginables d’Afrique du Nord, toutes les épices, enfin tout ce qu’on pouvait trouver. Nous qui habitions au 26, rue de Rivoli, ma mère faisait indifféremment ses courses de ce côté-là ou alors de l’autre côté avec les Juifs polonais c’est-à-dire la rue des Rosiers, donc pour les fêtes c’était facile de se procurer ce dont ils avaient besoin, les boucheries, les charcuteries.
Rares sont ces Juifs d’Afrique du Nord à déroger aux goûts et aux habitudes culinaires de leur région d’origine : les cafés offrent de généreuses kémia (25) avec l’apéritif, les restaurants des mets traditionnels. Depuis 1937 Esther Gharbi règne sur la cuisine du café-restaurant Au Petit Marseillais créé par son fils René Moïse au 7, rue François Miron. « Ma pauvre grand-mère, assure Roger Gharbi, était une cuisinière née, c’était un cordon bleu, elle faisait toutes les spécialités, le couscous tous les jours sauf le vendredi, le berbouche (26), on venait de partout. On faisait les gras-doubles, la t’fina, on travaillait à plein bras ». À l’entrée de l’établissement se tenaient Julie et Youmtobe Baruchel, originaires d’Oran et d’Alger. Le couple confectionnait des merguez qui, grillées sur un petit fourneau au charbon de bois, régalaient les « clients qui buvaient au comptoir une anisette et puis alors, les merguez ça défilait, et elles étaient bonnes ! » s’exclame Lucienne Bibi-Roubi. Chez Draï aussi, à l’enseigne du Bar Maurice, au 15 de la rue François Miron, le berbouche était servi le vendredi (27).
Les grandes fêtes juives sont autant d’occasions pour les femmes de déployer leurs talents dans l’art de préparer le couscous et le berbouche, mais les enfants redoutent l’opération du nettoyage du gras-double, tant l’odeur des tripes empuantit l’atmosphère.
Au moment des Fêtes, se souvient André Cohen, ma mère achetait le gras-double. Il était naturel, ça sentait mauvais dans toute la maison, elle le lavait, le lavait, le lavait, c’était une infection, je criais après elle, c’était une horreur pendant deux jours, ça puait, et elle faisait la chkembey, le gras-double en sauce rouge.
Joseph, dit encore Yossef ou Bâ Yossef Fhal, cordonnier à Khenchela, est un passionné de musique orientale ; en Algérie comme en France, il pratique le violon et la derbouka lors des réjouissances familiales – naissances, « communions » et mariages. Il accompagne également les petits orchestres orientaux qui se produisent dans les salons et bistrots du quartier Saint-Gervais. Chez Gharbi, Au Petit Marseillais, se produisent tour à tour, le samedi soir, les chanteurs, compositeurs et instrumentistes Simon dit Salim Hallali, sa mère Chelbyia, Élie Moyal alias Lili Labassi, « Blond-Blond » ainsi surnommé du fait de son albinisme, et, de temps à autre Raymond Leyris.
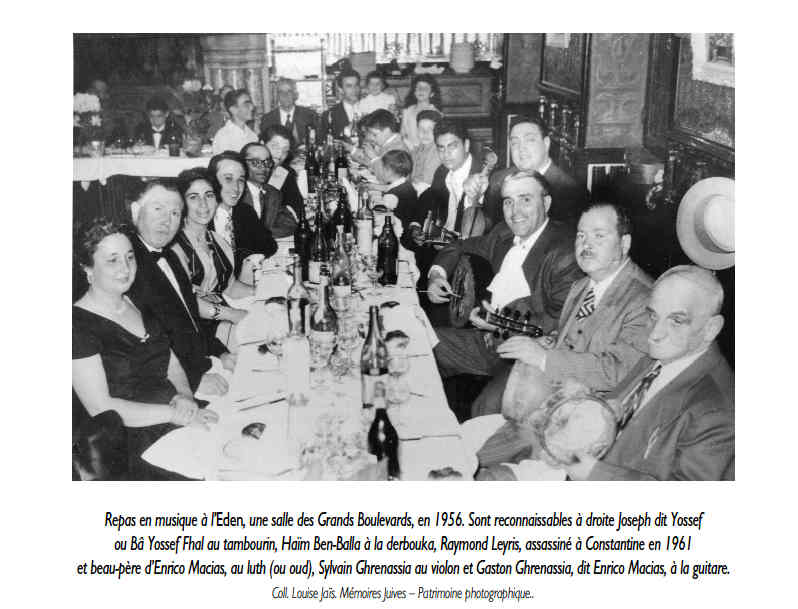
“Comment tu peux venir habillée comme ça en France !”
Alors explique Roger Gharbi, il y avait le plateau, il y avait des danseuses de chez nous, d’Afrique du Nord, des Juives et des Musulmanes, il y avait les deux, Lili Labassi avait ses danseuses, enfin elles se mettaient en tenue. Et ça marchait au plateau, pendant que la danseuse faisait son numéro, les clients lui donnaient de l’argent sur le front, lui collait un billet à cette époque de dix francs ou de vingt francs, sur le front, ou même entre les seins, mais gentiment, sans arrière-pensée, attention !
Dans la famille Allouch, les fiançailles et les mariages sont fêtées rue de Fourcy, au domicile familial qui est doté de pièces de réception suffisamment amples. Dans l’orchestre, Braham Allouch, shamès (28) à la synagogue de la rue de La Verrerie, joue du târ (29). Il y avait Bâ Yossef, explique Pierre Allouch, le petit-fils. C’était un violoniste, c’est lui qui interprétait quelques chansons de sa composition, moitié français moitié arabe, il y avait Chelbiya. Chelbiya était la mère à Salim Hallali. Et ils étaient tous les trois, il y avait le matelas plié avec un haïk (30) dessus, ils étaient assis tous les trois là-dessus. Dehors il y avait un plateau – parce que ça dansait –, alors chacun y allait de son billet pour honorer la personne qui dansait, et eux ça leur faisait une notoriété.
La cuisine et la musique ne sont pas les seules expressions d’une fidélité identitaire qui peut se manifester aussi au plan vestimentaire et surtout cultuel. Lorsqu’en 1936 M’Rhaïma Alzerat de Bône – ville pourtant largement européanisée – vient rejoindre les plus âgés de ses fils installés en France métropolitaine depuis quelques années, elle arbore une tenue indigène. Les retrouvailles avec son aîné, René, sont du coup plutôt fraîches : La honte de mon frère que ça a été, ce jour là, quand il a vu ma mère en bas de chez lui, au 26, rue de Rivoli, raconte Roger Alzerat. Il lui a fait un scandale en lui disant, ‘Comment tu peux venir habillée comme ça en France !’ Elle ne comprenait pas. […] Elle l’a regardé et lui a demandé ce qui lui arrivait […]. Lorsqu’elle est arrivée habillée à la mode algérienne comme ça, ça a choqué même les amis au début. Elle s’est habillée pendant quatre mois comme ça. Rue de Rivoli et rue François Miron où elle habite par la suite. Mais elle n’était pas la seule, il y en avait plusieurs comme elle. Il y avait trois ou quatre femmes et même les hommes qui étaient plus ou moins habillés à l’européenne.

Entrée de la synagogue de la rue Pavée, devant laquelle passe une femme avec un sac et une bouteille de vin. Edition : Projections Molteni. Photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.
“Comme il ne savait ni lire ni écrire, quand il allait à cette synagogue, pour compter le nombre de stations qu’il fallait – parce qu’il prenait le métro à Pont-Marie pour descendre au métro Cadet –, ma mère ou mes sœurs lui mettaient autant de pois chiches qu’il fallait de stations, et à chaque station, il prenait le pois chiche et le mettait dans l’autre poche du pantalon.”
Les fidèles originaires d’Afrique du Nord n’ont pas alors de lieu de culte attitré à Paris. Les familles fréquentent aux grandes fêtes les synagogues de la rue de La Verrerie, aujourd’hui disparue (31), de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, de la rue des Tournelles selon les cas, mais plus souvent, à l’instar des Gharbi et des Assuli, celle de la rue Buffault, dans le 9e arrondissement (32). C’est ce dernier choix que fait Messaoud Benichou, domicilié rue de Jouy. Il était quand même assez religieux, selon son petit fils André Cohen, il allait à la synagogue à la rue Buffault, parce qu’elle était réputée comme réunissant le plus d’Oranais, tous les gens de ses origines. Et comme il ne savait ni lire ni écrire, quand il allait à cette synagogue, pour compter le nombre de stations qu’il fallait – parce qu’il prenait le métro à Pont-Marie pour descendre au métro Cadet –, ma mère ou mes soeurs lui mettaient autant de pois chiches qu’il fallait de stations, et à chaque station, il prenait le pois chiche et le mettait dans l’autre poche du pantalon. Et comme ça, il allait tous les jours à la synagogue rue Buffault. D’ailleurs cette synagogue est restée très très longtemps notre synagogue pour les fêtes, parce que nous étions dans notre famille pas très religieux, mais traditionalistes, ça veut dire que toutes les fêtes nos parents faisaient Kippour, Pessah, etc.
C’est ce même temple de la rue Buffault qui, aux premiers temps de l’Occupation, a les faveurs de la communauté originaire d’Algérie pour les fêtes de Tichri, comme le remarque le journaliste Jacques Biélinky (33). Dans le petit monde du quartier Saint-Gervais, c’est Yahyia Chetrit qui fait office de rabbin, de shohet et de mohel tout à la fois (34). Nombre d’enfants dans ces familles ont été circoncis par ses soins. Il prépare également les garçons à la bar-mitsva. Yahyia Chetrit est natif d’Erfud ou du Tafilalet au Maroc, son épouse, Aïcha, de Mostaganem dans l’Oranie. La famille quitte l’Algérie pour la France vers 1935 et s’installe au 5 de l’impasse Putigneux, dans « un meublé plein de rats, pas d’ascenseur, les toilettes sur le palier, l’horreur totale ! » témoigne leur fille (35). La veille de Kippour, c’est lui qui pratique les kaparoth (36). Les familles chargées de volailles se rassemblent autour du shohet dans la cour intérieure d’un immeuble de la rue des Rosiers pour l’exécution du rituel, à l’instar de la famille Cohen qui a acquis quelques jours auparavant quatre poulets parqués dans ses toilettes. Du 12e arrondissement, rue de Charenton, les Touitou se rendent également à Saint- Paul pour l’occasion : On achetait les poulets vivants pour les fêtes, se rappelle encore Gilette Amram. On allait à Saint-Paul faire les commissions, c’était souvent maman parce que mon père travaillait, ma mère avec ses grandes filles, on faisait venir le rabbin à la maison, il y a eu rebbe Yahyia, il y en a eu un autre. On achetait les gras-doubles sales, on les nettoyait à la maison, alors ça quand maman achetait les gras-doubles et les poulets à la maison, nous on se disait « Ça va être toute la nuit avec les poux, enlever les plumes », on se mettait par terre et on plumait les poulets, on n’était pourtant pas si vieilles que ça (37) !
Une image de « Juifs arabes » mais aussi de gros bras face aux antisémites
Qu’en est-il de leurs contacts avec les populations yiddishophones ? Ils restent au mieux limités. Pour nombre de ces Juifs d’Afrique du Nord, c’est la difficulté, voire l’animosité, qui caractérisent leurs rapports ordinaires. « On avait des difficultés de vivre entre les Juifs polonais et les Juifs pieds-noirs, explique Raymond Chamak, parce qu’ils nous traitaient d’Arabes. Pour eux on était des Arabes, quand ils parlaient de nous, ils disaient “Les Juifs Arabes” ! ». Ces amabilités fleurissent naturellement dans les cours d’écoles, véhiculées par les petits camarades, juifs ou non : On était pour eux les Arabes, pour les Français, raconte Pierre Allouch ; les petits Juifs polonais on les ignorait, ils étaient du côté de la rue des Rosiers, nous on était là-bas, rue Grenier sur l’Eau. Il y avait les Juifs algériens, il y en avait quelques-uns quand même et puis ceux qu’on appelait « les Français ». Et c’est vrai qu’il n’y avait pas une animosité, mais deux clans bien séparés où d’ailleurs les grands frères défendaient les petits frères, nous étions plus que pauvres puisque pour avoir un 4 heures on le prenait aux petits Français, de force.
Pour André Cohen, la difficulté de communiquer expliquerait en partie cette absence de contact : Ma belle-mère, se souvient-il, parlait assez mal le français, elle avait un fort accent, elle parlait plutôt en yiddish quand elle s’adressait à ces enfants, mais elle comprenait et elle parlait quand même français avec un fort accent. Eux effectivement les Juifs ashkénazes, avaient beaucoup plus de mal si voulez à s’intégrer que nous côté séfarade. Ma mère écrivait et lisait, mon père lisait, écrivait, donc de ce côté là il n’y avait pas de problème et puis ils n’avaient pas d’accent, si ce n’est que ma mère avait un accent pied-noir un peu prononcé.
Les rares projets matrimoniaux entre les deux communautés ashkénaze et séfarade suscitent des réticences, voire la méfiance. Quand Hélène Birman envisage, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, d’épouser Maurice Lévy, natif des Attafs en Algérie, sa mère Feiga Birman, la boulangère du 27 de la rue des Rosiers, s’en étonne : « Comment, tu vas te marier avec un Arabe ? (38) ». « Nous les [les originaires d’Afrique du Nord] regardions de haut », confirme Akélé Danan, née Birman, la soeur d’Hélène. Ce qui ne l’empêche pas d’épouser en 1948 Roger Danan, le neveu de Maurice Lévy (39). Lorsque les unions se réalisent, la convivialité peine un peu, dit-on, à s’installer entre convives des deux cultures (40). Ashkénazes et séfarades du quartier Saint-Gervais sont cependant périodiquement la cible dans l’entre-deux-guerres de menées antisémites de toutes sortes (41). En septembre 1935, des Arabes auraient même été enrôlés par des militants du mouvement d’extrême droite la Solidarité Française dans une de leurs expéditions « punitives » dans le quartier Saint-Paul, en l’occurrence au Café Georges, 51 rue Vieille du-Temple, où de nombreux Juifs du quartier ont leurs habitudes. L’enquête révéla, aux dires du journaliste qui rapporte l’incident, que le rassemblement des membres de la ‘Solidarité’ était concerté. Aux stations de métro Sully et Pont-au-Change, des émissaires recevaient les arrivants et lesdirigeaient sur la « Maison Bleue », café de la rue des Archives, où se réunissent les fascistes. Il en vint ainsi 150, parmi lesquels de nombreux Arabes. On leur distribua matraques et revolvers […] (42).

Vue de la rue des Rosiers, au niveau du numéro 54, en regardant vers la rue Vieille du Temple. Photo issue de l’ancienne collection du critique d’art et écrivain Charles Fegdal-Mascaux (1880-1944). Héritage de sa veuve Suzanne Decugis, artiste peintre, à la famille Levantal. Don de Jean Levantal au MAHJ.
“Les Juifs polonais venaient chercher du secours chez nous, les Juifs pieds-noirs.”
À la veille de la Seconde Guerre mondiale et dans les premiers mois de l’Occupation, les incidents se multiplient : À un moment donné, il y a eu une bande de fascistes qui allaient chercher des histoires à tous les Juifs polonais qui avaient des barbes pendant la guerre, se souvient Raymond Chamak. Il y avait des groupes de jeunes fascistes qui venaient chercher la bagarre avec les Juifs polonais, et les Juifs polonais venaient chercher du secours chez nous, les Juifs pieds-noirs. C’était des vieux, les pauvres types, ils venaient nous chercher, ils étaient en sang, ils arrivaient rue François Miron et ils disaient, « Voilà, ils nous ont traité de sales Juifs ! » Ils venaient ensanglantés, parce qu’ils les battaient, ils leur coupaient la barbe, ils leur faisaient des vacheries. Ils venaient chercher des jeunes Juifs assez costauds, et on allait faire le coup de poing rue des Rosiers, rue des Écouffes, dans toute cette zone là.
L’utilisation malaisée du français, sa prononciation écorchée faisaient des Juifs polonais des cibles toute désignées pour l’extrême droite. Selon Raymond Chamak, « on les reconnaissait tout de suite. Rien qu’à leur accent ou à leur manière de parler ». Ce problème linguistique revient à maintes reprises dans les témoignages. Jeannine Bouhanna par exemple, qui habite 43 rue Vieille-du-Temple, se souvient que la concierge refusait de croire à l’appartenance juive de sa famille en raison de son absence d’accent. Lors de la rafle du Vel’ d’Hiv, poursuit-elle, cette même absence d’accent contribua à lui éviter l’arrestation, ce qui acheva de persuader la concierge de leur non judéité. Plusieurs témoins ashkénazes ont assisté à ces coups de main répétés consentis par les séfarades. Marthe S., domiciliée sur l’Ile Saint- Louis, se souvient encore des renforts recrutés rue François Miron pour disperser la manifestation aux relents antisémites qui se déroulait aux abord de son immeuble (43). Pour Maurice Waniewitz qui vit rue des Rosiers, ces Juifs orientaux sont des caïds, « des gars bagarreurs, qui avaient la frappe, n’admettant pas qu’on dise du mal des Juifs. C’était des Juifs et ils y tenaient ». « Heureusement, nous confie-t-il, qu’on les avait ! ». Il donne en exemple les deux frères Brakha du 5 de la rue des Nonnains d’Hyères, toujours prompts à apporter leur concours en cas de coups durs si fréquents place des Vosges (44).
Jean Laloum
Étude publiée dans la revue “Archives Juives, revue d’histoire des Juifs de France” n°38/2 (2005) © Belles Lettres, reproduite avec l’aimable autorisation de son auteur et des Éditions Les Belles Lettres
Notes
1. ACIP, B 107, Consistoire 1919, Chemise : Consistoire (correspondance).
2. Yad Vashem / CDJC, Collection Georges Epstein. Ce document se présente sous la forme d’un épais carnet microfilmé, dressant par nom de rue, pour chaque arrondissement, l’état de la population juive parisienne en 1941. En vis- à-vis de chaque numéro de rue se trouvent le nom et la profession de la personne. Parfois, le patronyme est accompagné de la lettre « M » entre parenthèses à laquelle est souvent associé un numéro ainsi que diverses précisions telles que « gratuit », ou « Mai 10 francs » ou encore « reçu 30 le 22 octobre », faisant supposer que ces listes servirent à répertorier les personnes soumises à cotisation dans le cadre d’une affiliation obligatoire, par exemple l’Union générale des israélites de France (UGIF), créée par la loi du 29 novembre 1941. Figurent également, mais beaucoup plus rarement, certaines indications qui témoignent des mesures prises à l’encontre des Juifs : ainsi la mention « son mari à Drancy » au regard du nom de Mme Danziger, finisseuse, domiciliée 4 rue de l’Ave Maria. Je remercie Shmuel Bunim de m’avoir signalé l’existence de ce microfilm au CDJC.
3. Familles Mouchi, Ben Ivny, Boukaya, Benolliel, Teboul, Benkemoun, Safar,Allouche, Benhamou, Bouskila, Oliel, Moha, etc.
4. Entretien avec Roger Gharbi, Paris, le 9 juin 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Gharbi proviennent de cette source.
5. Entretiens avec Pierre Allouch, Paris, le 11 mai 2004 ; Jacques Zekri (par téléphone), le 12 juin 2005 ; Raymond Chamak, Le Perreux-sur-Marne, le 28 mars 2005 ; Jean Dana, Paris, le 11 juin 2005 ; Louise Jaïs née Fhal, Paris, le 31 mai 2004 : la famille Fhal, a-t-elle précisé, est partie de Khenchela en 1937. Les autres familles sont de Constantine. Sauf mentions contraires, toutes nos informations sur les familles Allouche, Zekri, Chamak, Dana et Fhal proviennent de ces sources.
6. Entretien avec Huguette Touboul née Assuli, Paris, le 7 juin 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Assuli proviennent de cette source.
7. Entretien avec Jeanne Arous, Paris, le 25 novembre 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Arous proviennent de cette source.
8. Archives nationales (désormais AN), AJ38, 2580, dossier 23 132 (section VB R) : dossier d’aryanisation établi au nom de la Vve Halphen Alice – immeuble – 10- 12, rue des Deux-Ponts Paris (4e).
9. Entretien avec Jeannine Bouhanna née Sebbane, Paris, le 10 janvier 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Sebbane proviennent de cette source.
10. Entretien avec Roger Alzerat, Paris, le 9 avril 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Alzerat proviennent de cette source.
11. Entretien avec Mardochée Ohnona, Paris, le 31 avril 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur les familles Ohnona et Suissa proviennent de cette source.
12. La loubia est un plat traditionnel juif, à base de haricots.
13. Entretien avec Lucienne Bibi-Roubi née Vidal, Paris, le 31 mai 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Vidal proviennent de cette source.
14. Entretien avec André Cohen, Paris, le 26 février 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Cohen proviennent de cette source.
15. AN, AJ38, 1192 à 1222, Fichier topographique des entreprises du département de la Seine. Classement par nom de rue sans distinction entre Paris et la banlieue.
16. Le « document Georges Epstein » mentionne la profession de 141 originaires d’Afrique du Nord (sur 168 répertoriés) dans 23 rues du quartier Saint-Gervais. Les métiers le plus souvent pratiqués sont les suivants : marchand de quatre saisons (18), manoeuvre, manoeuvre en usine, ouvrier d’usine, journalier, manutentionnaire aux Halles (18), marchand forain, marchand ambulant, brocanteur, colporteur (13), tailleur, ouvrier tailleur, modiste, couturière, commerçant en bonneterie, fourreur (5), coiffeur, ouvrier coiffeur, garçon coiffeur (7), peintre, peintre en bâtiment, peintre dans l’aviation (6), aide-comptable, employé de bureau, employé dans un ministère, employé à la Ville de Paris, fonctionnaire de la Ville de Paris (5), maçon, ajusteur, marbrier, soudeur, plombier (5), menuisier, ébéniste, ouvrier ébéniste (4), cordonnier, ouvrier cordonnier (4), garçon de café, garçon de restaurant, garçon livreur (4), infirmier, aide infirmier, employé dans une pharmacie, brancardier (4) ; employé de commerce (4) ; chauffeur, chauffeur de camion, chauffeur de taxi (4), concierge, bonne (3), vendeur (3). Outre celle de marchand de quatre saisons, les professions liées au secteur alimentaire sont représentées de la façon suivante : café et restaurant (6), boucher (1), épicier (1) et enfin marchand de cacahuètes (1). Toutefois ces désignations d’activité sont à considérer avec la plus grande prudence, car certains des métiers consignés dans ce document établi durant l’Occupation résultent des interdictions d’exercice professionnel prises par Vichy ou ordonnées par l’occupant. Ainsi Albert Allouche qui exploitait une boucherie au 74 de la rue François Miron y figure comme ouvrier d’usine ; de même Mimoun, tenancier du café situé 13, rue de Jouy, y est mentionné comme « fonctionnaire VP [Ville de Paris] ».
17. AN, AJ38, 154, Direction du Statut des personnes, Dossiers individuels. 1941- 1944 – AR à ARZ.
18. AN, AJ38, 187, Direction du Statut des personnes, Dossiers individuels. 1941- 1944 – RT à RZ.
19. Là Hébarek : expression arabe qui signifie « Que Dieu te bénisse ».
20. Les administrateurs provisoires ou commissaires-gérants sont des personnes chargées par le CGQJ d’aryaniser par vente ou liquidation les biens juifs {(Voir plus loin)}.
21. AN, AJ38, 3190, dossier 16 423 (section VIII NR), Dossier d’aryanisation établi au nom de Vve Boukhalter – épicerie – 68 rue François Miron Paris (4e).
22. Lou Helvasser, « Habits, chiffons, ferrailles à vendre… ou la chine dans le Pletzl », dans « le Pletzl », Bulletin de l’Association des Amis du 4e arrondissement, n° 3 octobre 1988, p. 2. Ce témoin cite entre autres Simon Kalfon, les frères Melki et les Chamak.
23. Toujours suivant le « document Georges Epstein », la profession de coiffeur est exercée par les personnes suivantes : Ben Soussen domicilié au 20 rue Charlemagne ; Boukaya au 12 rue des Écouffes ; Boumendil au 30 rue François Miron ; Cohen au 20 rue de Jouy ; Cohen au 13 rue Geoffroy l’Asnier ; Mlle Assouline au 10 rue des Jardins Saint-Paul.
24. Sur le coiffeur Albou, voir AN, AJ38, 2318, dossier 3 996 (section III R), Dossier d’aryanisation établi au nom de Albou – salon de coiffure Mary – 52 rue du Roi de Sicile Paris (4e). Le fonds de commerce, créé en septembre 1919, est tenu par son épouse, Mary Arnaud. « Cette dame est aryenne », note dans son rapport en 1941, l’administrateur provisoire.
25. Ronde d’entrées et d’amuse-gueule, traditionnellement servis en Afrique du Nord à l’heure de l’apéritif.
26. Le berbouche ou barbouche : couscous préparé à base de grosse semoule, abondamment épicé, arrosé de loubia, de chkembey (ou chkaimba), gras-double en sauce rouge, accompagné de viande, d’une tranche de hasbanne, farce constituée de viande, d’épices et de tripes, emmaillotée dans une poche de panse de boeuf ou de mouton, assorti de boutons d’or (petits navets jaunes) et de la moitié d’un oeuf dur ayant préalablement été cuisiné dans la sauce même de la préparation.
27. Entretien téléphonique avec Perlette Pons née Draï (Antibes), le 15 juillet 2005. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Draï proviennent de cette source.
28. Shamès : bedeau.
29. Târ : tambourin fait d’une peau tendue sur deux cerceaux de bois et entouré de cymbales.
30. Le haïk est une épaisse couverture en laine constituée de bandes multicolores.
31. Cette synagogue était située à l’étage, en face du Bazar de l’Hôtel de Ville, dans un local aujourd’hui transformé en annexe du BHV.
32. Ce temple de rite portugais inauguré en 1877 est affilié à l’ACIP depuis 1906.
33. Jacques Biélinky, Journal, 1940-1942. Un journaliste juif à Paris sous l’Occupation, présenté par Renée Poznanski, Paris, Éditions du Cerf, 1992, pp. 59, 61-62.
34. Le shohet est chargé de l’abattage rituel ; le mohel pratique la circoncision rituelle.
35. Entretien avec Marie-Josette Chetrit, Paris, le 12 mai 2004.
36. Littéralement « expiations », singulier Kaparah. « Coutume observée la veille de Yom Kippour en début de matinée ou dans la nuit qui le précède et qui consiste pour tout Juif adulte à prendre une volaille (un coq pour les hommes, une poule pour les femmes) et, la tenant par le cou, à la passer trois fois autour de sa tête, en disant : “Ceci est mon expiation, ceci est mon rachat, ceci est ma substitution. Ce coq (cette poule) ira à la mort, tandis que moi j’irai vers une vie longue et heureuse”. Puis on égorge la volaille que l’on donne directement aux pauvres à moins de verser la somme correspondant à sa valeur à une oeuvre charitable ». Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme, publié sous la direction de Geoffrey Wigoder, Paris, Éditions du Cerf, 1993, pp. 616-617.
37. Entretien avec Gilette Amram née Touitou, Paris, le 20 février 2005. La mention des poux vient de ce que les volailles, à cette époque, étaient extrêmement pouilleuses. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Touitou proviennent de cette source.
38. Propos rapportés par une autre fille de Feiga Birman, Anna, dite Akélé, Danan. Entretien, Paris, 13 avril 2005.
39. Ibid.
40. Entretien avec Lucette Bouchoucha et son frère cadet André Cohen, présent à ses côtés, Paris, le 26 février 2004. Sauf mention contraire, toutes nos informations sur la famille Cohen proviennent de cette source.
41. Le Droit de Vivre, organe de la LICA, et d’autres périodiques font régulièrement état de ces exactions dans le quartier Saint-Paul : inscriptions injurieuses
(Le Droit de Vivre – section du IVe –, n° 24, février 1935), insultes publiques et quotidiennes (Le Journal Juif, n° 40 du 4 octobre 1935), expéditions « punitives » de mouvements d’extrême droite (Le Journal Juif, n° 40, op. cit. ; Le Droit de Vivre n° 31 (nouvelle série), 5e année, mercredi 10 juin 1936).
42. Le Journal Juif, n° 40 du 4 octobre 1935, p. 5.
43. Entretien avec Marthe S., Paris, le 25 novembre 2004.
44. Entretien avec Maurice Waniewitz, Les Lilas, le 5 mai 2005.
© photos : Collection Louise Jaïs / MAHJ / DR
Article publié le 28 octobre 2019, tous droits de reproduction et de représentation réservés © Belles Lettres / Jewpop 2019
Moshe Mouse Crucifixion, l'album Jewpop de Michel Magne et Boris Bergman 23 Jan 2023 2:55 AM (2 years ago)
Les fans de musiques de films français des années 60 et 70 connaissent bien le nom du compositeur et arrangeur Michel Magne. Ceux de Bowie, d’Elton John, Iggy Pop, des Bee Gees… ne savent peut-être pas que c’est dans son mythique studio d’enregistrement du château d’Hérouville qu’ont été enregistrés les albums cultes The Idiot, Low, Honky Château, la bo de Saturnay Night Fever, parmi tant d’autres. Ce que l’on sait encore moins, c’est qu’en 1975, Magne y enregistra avec la complicité du parolier Boris Bergman (qui signera plus tard les paroles des plus grandes chansons d’Alain Bashung) un concept-album intitulé Moshe Mouse Crucifixion, où le yiddish y côtoyait pop psychédélique et funk ! Vous avez dit Jewpop ?

Michel Magne au studio d’Hérouville
Le gimmick au banjo qui accompagne les bourre-pifs que Lino Ventura balance allègrement à Raoul Volfoni et son frère dans Les Tontons flingueurs, c’est Michel Magne. Les musiques des mythiques films de Jean Yanne, c’est encore lui, tout comme une pléthore d’extraordinaires bandes originales, arrangements et albums cultes qui furent produits dans son studio d’Hérouville, lieu de rêve où il accueillit le must de la pop des seventies, de Pink Floyd au Grateful Dead.
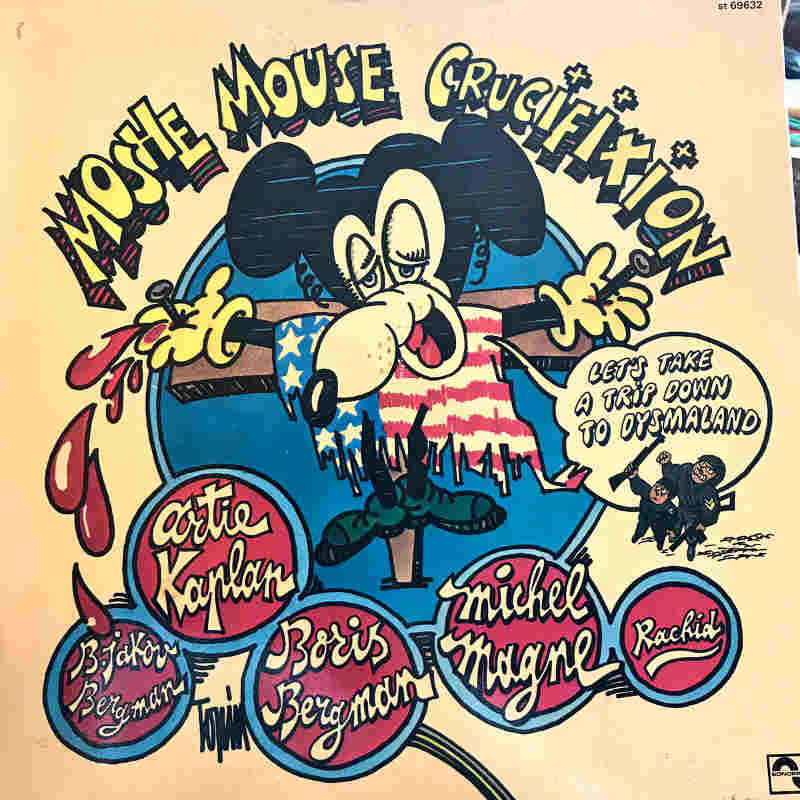
Dans une interview publiée sur le site Parisbazaar, Boris Bergman se souvient de la genèse du projet Moshe Mouse Crucifixion, album OVNI qui sortira en 1975 sur le label Sonopress, rapportant cette phrase de Michel Magne : « Tu vois Boris, quand les choses ne vont pas, il faut être mystique… écris-moi un truc mystique ».
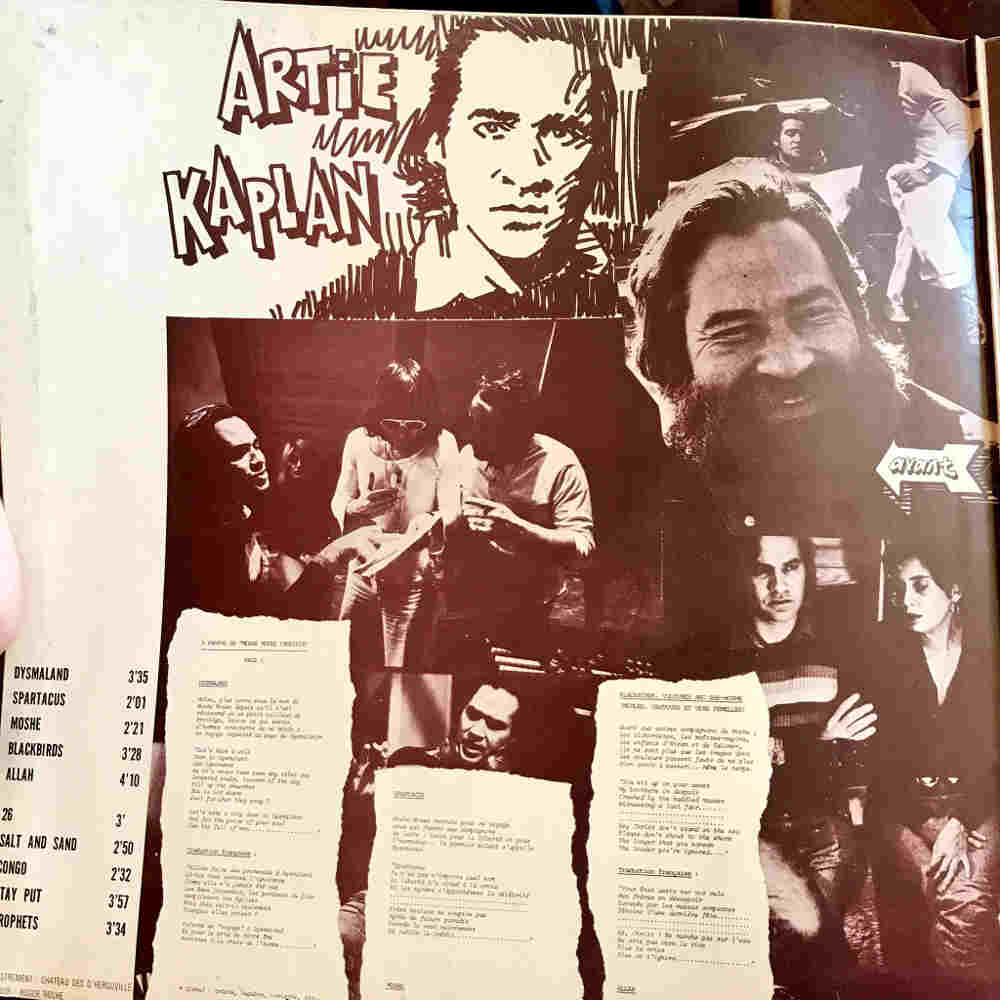
Moshe Mouse Crucifixion, inside
Cette phrase, explique Boris Bergman, sera le déclencheur de cet album devenu culte pour les amateurs de pépites musicales, et dont les exemplaires sont rarissimes. Au casting, le chanteur et saxophoniste américain Artie Kaplan et le père de Boris Bergman, Baruch Yacov, qui fut arrêté pendant l’Occupation, incarcéré à Drancy et échappa à la déportation, y assure les parties vocales en… yiddish ! Dans le titre 26, on l’entend chanter les paroles « Je suis le nombre 26, le grand architecte régit le monde », tandis qu’avec sa voix de stentor tonitruante, Artie Kaplan poursuit en anglais sur le mode spoken words « Écoute sa voix humanité, il est 26 mais il n’est pas n’importe quel nombre, il est le Dieu d’Abraham et de Josué, et nous savons tous les deux que vous êtes allés trop loin. ».
<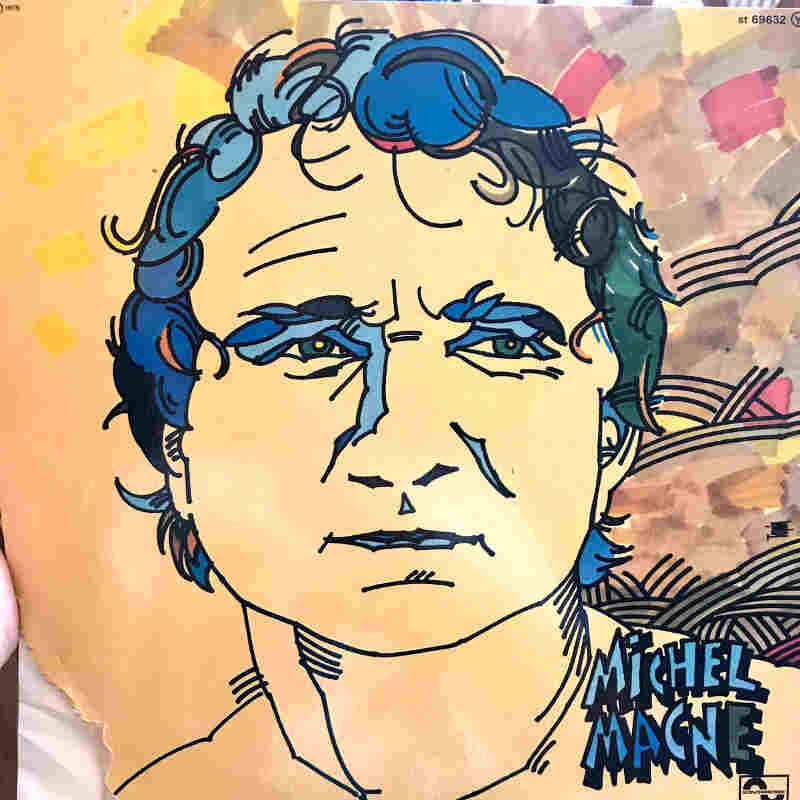
Michel Magne par Tito Topin
La pochette de l’album, figurant un Mickey à papillottes et au nez proéminent qui ferait sans doute hurler les censeurs politically correct d’aujourd’hui, fut dessinée par le graphiste Tito Topin, qui réalisera les affiches des films de Jean Yanne. Boris Bergman qualifie Moshe Mouse Crucifixion de «Michel Magne ascendant Kurt Weil », d’où « émerge un titre jugé par les aficionados comme “Proto Hip Hop”, du Eminem un demi-siècle avant celui qui est à mon sens un des plus fins techniciens du rap. La chanson s’appelle Prophets (et je suis fier de l’avoir annoncé à “l’Oracle”… Olivier Cachin bien entendu…) ».
De même, des décennies avant Socalled et son Jewish Cowboy puis les fusions klezmer-funk d’Abraham Inc., le yiddish se maria alors délicieusement au groove dans le prophétique Moshe Mouse Crucifixion. Grâce à l’alliance magique de deux génies complices dans leurs délires, Michel Magne et Boris Bergman.
Alain Granat
Écouter le titre 26 de l’album Moshe Mouse Crucifixion, et sa face B
Écouter le titre Moshe de l’album Moshe Mouse Crucifixion
Écouter le titre Prophets de l’album Moshe Mouse Crucifixion
© photos et visuels : Olivier Cachin / Twitter / DR
Article publié le 15 janvier 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop
Les Dossiers d'Eve, nom de code SVP 11-11 23 Jan 2023 2:54 AM (2 years ago)
Les réseaux sociaux se révèlent parfois passionnants. La lecture d’un post Facebook d’une lectrice de Jewpop a attiré notre attention sur sa filiation. Son père a marqué des générations de Français. Son nom d’abord, Guy Darbois. Un numéro de téléphone ensuite, SVP 11-11 (vous brûlez, nous sommes dans les années 70). Une émission de télé enfin, Les Dossiers de l’Écran, qui réunissait chaque semaine entre 10 et 13 millions de téléspectateurs au son d’une musique de générique inoubliable. Jewpop a demandé à Eve Samakh, fille de Guy Darbois, de nous raconter son père sous forme d’auto-interview.
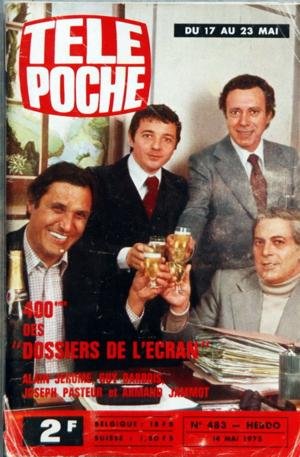
Couverture du magazine Télé Poche figurant l’équipe des Dossiers de L’Écran : Alain Jérôme, Guy Darbois, Joseph Pasteur et Armand Jammot (mai 1973)
– Ton père c’est Guy Darbois donc, il est goy ?
Eve Samakh : Non non, Darbois est un pseudonyme. Mon père est juif et né à Constantine. Tout comme Enrico Macias (Gaston Ghrenassia de son vrai nom) mais avec moins de cheveux. Il a changé de nom à la demande express de Michel Moine, qui dirigeait à l’époque le service Informations de Radio Luxembourg. L’argument explicite : impossible de s’appeler Samakh quand les deux piliers de RTL sont la chrétienté et l’Europe. L’argument implicite : les juifs n’ont pas de place dans le paysage audiovisuel français. Et cela moins de 20 ans après la révélation de la Shoah aux yeux du monde entier… Petite anecdote : mon père était allé à Jérusalem interviewer Golda Meïr qui, quand elle a compris que Guy Darbois était juif, a carrément fait la gueule, elle qui était si heureuse qu’enfin un non-juif se passionne aussi positivement pour Israël. Elle a mis court à l’interview et est partie sans saluer mon père. J’adore cette histoire avec un petit h.
– Pourquoi ce nom, Darbois ?
E.S. : Un journaliste de l’époque lui avait suggéré et mon père l’avait aussitôt adopté. En plus Dar signifie maison en arabe, ce qui plaisait bien à mon sépharade de père. Ce journaliste s’appelait Daniel Sarne, mais de son vrai nom, Daniel Putois…

Photo de plateau des Dossiers de l’Écran
– Tu es fière d’avoir comme père Guy Darbois ?
E.S. : Aujourd’hui oui, d’autant plus que cette relative célébrité a été engendrée par l’exercice d’un beau métier. Mais ce n’était pas le cas quand j’étais petite. Les enfants de mon école pensaient que tous les « enfants de » étaient riches et arrogants et ils les détestaient d’emblée. Je me demande du coup si les mômes n’étaient pas plus cruels dans les années 70 ! Quand des copines venaient à la maison, je cachais sous du scotch marron le pseudonyme collé sur la boîte aux lettres et je retournais les photos de mon père posant aux côtés de Brassens ou encore de Neil Armstrong.
– Allô SVP Guy Darbois… Ton père était le standardiste des Dossiers de l’Écran ?
E.S. : Hahaha (je ris alors que c’est moi qui rédige les questions) ! L’idée de l’émission venait du génial producteur, Armand Jammot, mais la mise en œuvre, c’était mon père. Le choix des films et des invités, ainsi, bien sûr, que le tri des questions posées en direct par les téléspectateurs. Bon, on peut le révéler aujourd’hui, nombre de ces questions étaient inventées par mon père. D’ailleurs, je perpétue cette pratique ici même, dans ce papier, comme par hasard, comme par pas hasard.

Guy Darbois interviewé par LCP
– On ne le voyait jamais, il est moche ton père ?
E.S. : Hahaha (je ris encore, je me trouve drôle), non, il était même plutôt beau gosse. Mais c’était ainsi, un fait établi : pas de caméra dans les coulisses. Mon père s’en fichait, il ne cherchait ni à se montrer ni à se cacher. Et moi ça m’arrangeait qu’il soit l’homme invisible de la télévision. Il pouvait venir me chercher à l’école ou au collège sans être reconnu et donc sans que l’on m’embête. Les rares fois où il apparaissait à l’écran (comme avec Soljenitsyne), j’avais des sueurs froides le lendemain à l’école. Mais finalement, tout s’est bien passé car aucun enfant n’avait assisté à un débat tardif sur la dissidence sous le régime soviétique.
– Je me souviens d’un Dossier de l’Écran qui opposait sur le plateau résistants et collabos.
E.S. : Oui magnifique débat, passionnant et inimaginable aujourd’hui ! À l’époque, les Dossiers de l’Écran étaient une émission phare, ultra populaire. Bon, il faut dire aussi qu’il n’y avait pas 50 chaînes de télévision non plus. Il faut dire également que c’était une émission d’une qualité folle, audacieuse, intelligente, proposant des films de cinéphile suivis d’un débat intense et poli. Quelque chose de dinosaure quoi, une espèce éteinte, un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand ils allument leur télévision. Mon père et Armand Jammot se permettaient tout, protégés par le succès et la considération. Et je me souviens particulièrement d’une émission sur l’inceste où des victimes témoignaient sur le plateau mais filmées de dos. Ce qui faisait froid à cette même partie du corps. À l’époque, je m’étais dit que ça leur ferait du bien de parler (à l’époque, rappelez-vous chers vieux lecteurs, les psys étaient mal vus et réservés aux fous), et que dans la vie ils devaient aussi être de dos tout le temps.
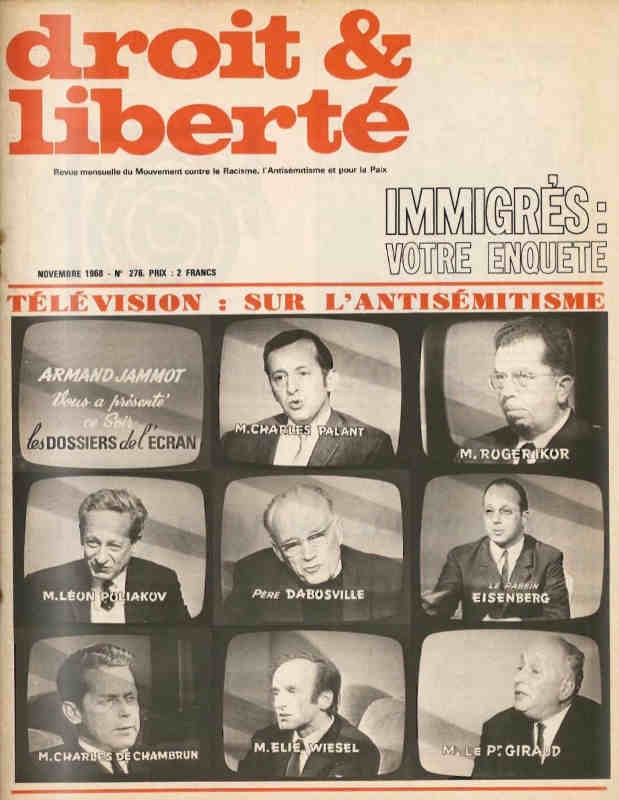
Couverture du magazine du MRAP Droit et Liberté (1968)
– Il n’y a jamais eu de Dossiers de l’Écran censurés ?
E.S. : Oui, mais tellement peu. Il s’agissait essentiellement de censures que mon père appelle « la censure par l’absence ». Exemple : un Dossier de l’Écran sur la torture en Algérie n’a jamais vu le jour, parce que les militaires invités se sont défilés au dernier moment. Autre exemple : un Dossier sur l’Académie Française n’a jamais été réalisé, car mon père avait invité une ou deux femmes écrivaines et les académiciens, tous des connar…euh pardon… des hommes, ont refusé de débattre aux côtés de femmes.
– Et pour sa retraite, ton père regarde la télé toute la journée ?
E.S. : (Cette question… Je ne ferai décidément jamais lire cette interview à mes parents) Mon père vit sa retraite sur l’île de Ré avec ma mère, il bridge (il est champion de l’île), lit un livre par jour (même du Tite-Live), écoute de la musique, cuisine, mate effectivement la télé mais uniquement les concerts, les films et les séries, bref il est redevenu Guy Samakh. Même s’il est connu là-bas sous le nom de Guy Darbois, nom qui lui octroie quelques privilèges et fascine encore quelques Charentais tels le teinturier qui lave ses affaires en priorité, ou encore l’ostréicultrice qui lui fait un prix sur les huîtres.
Propos recueillis par Eve Samakh
© photo et visuels : DR
Article publié le 30 janvier 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop
En Israël, 25% des rescapés de la Shoah vivent toujours sous le seuil de pauvreté 23 Jan 2023 2:52 AM (2 years ago)
Durant des décennies, tous les gouvernements israéliens successifs se sont désintéressés du sort de leurs citoyens rescapés de la Shoah vivant dans des conditions misérables. Il aura fallu des années de campagnes et d’initiatives menées par des ONG, puis l’arrivée de Yair Lapid, fils de rescapé, au ministère des Finances en 2014, pour voir enfin cette scandaleuse situation évoluer. Mais malgré une augmentation significative du budget alloué par le gouvernement Netanyahou depuis, 25% de ces rescapés, soit environ 35 000 personnes, vivent toujours sous le seuil de pauvreté.
Alors que l’on commémore Yom HaShoah depuis hier en mémoire des 6 millions de Juifs victimes de l’Holocauste, 140 000 rescapés vivent aujourd’hui en Israël. Chaque mois, un millier d’entre-eux disparaissent. Leur moyenne d’âge est de 85 ans.
En 2004, le gouvernement israélien allouait un budget de 400 millions d’euros pour les aides financières aux rescapés. Ce chiffre est passé à 750 millions en 2012 et a atteint son record en 2019 avec un budget de 1,5 milliard d’euros (source ministère des Finances israélien, Holocaust Survivor Rights Authority).
Mais il est impossible de quantifier comment ces aides sont réparties, le système d’éligibilité rendant les démarches complexes pour les rescapés y ayant droit, à l’image des méandres et lourdeurs de la bureaucratie israélienne. Selon Galia Aricha, juriste du département du ministère des finances dédié à ces aides, “ Toutes les personnes qui ont été déportées reçoivent des aides. ”
“ De trop nombreux rescapés vivent dans la pauvreté, mais depuis ces 5 dernières années, les choses commencent à évoluer ” explique au Jerusalem Post Aviva Silberman, une avocate qui a fondé l’ONG Aviv for Holocaust Survivors en 2007. Actuellement, 35 000 survivants de la Shoah vivent sous le seuil de pauvreté en Israël, en majorité des immigrants arrivés d’Union soviétique dans les années 80. Ces derniers ne sont pas éligibles à l’ensemble des aides, une législation stipulant que les rescapés ayant fait leur alya après 1953 ne peuvent en bénéficier, et ne sont pas couverts par les accords de réparations négociés en 1952 entre Israël et l’Allemagne.
Les rescapés arrivés avant 1953 touchent une pension mensuelle allant de 500 à 2500 euros mensuels, ceux arrivés après 1953 moins de 1000 euros par an (source Aviv for Holocaust Survivors). La situation dramatique de ces rescapés a commencé à s’améliorer avec l’arrivée de Yair Lapid comme ministre des Finances en 2014. “ Rien n’avait été fait depuis des années. C’était une honte” déclarait à l’agence Reuters l’ex-ministre des Finances, dont la politique a été poursuivie par son successeur Moshe Kahlon.
Lapid avait alors doublé le budget dédié aux survivants de la Shoah et permis leur accès gratuit aux soins, tout en assouplissant les modalités de la législation de 1953. Mais pour Galia Aricha, beaucoup reste encore à faire, de nombreux rescapés ignorant leurs droits ou étant dans l’impossibilité d’effectuer les démarches administratives, complexes, pour déposer leur dossier.
D’autres ONG israéliennes, telle Latet, très active dans l’aide aux personnes âgées en situation de pauvreté, se mobilisent régulièrement pour des campagnes de levée de fonds dédiées aux rescapés, à l’image de celle réalisée par Latet en 2019 pour rénover des appartements en mauvais états ou inadaptés, offrir des lunettes de vue, des appareils auditifs, qui a fait l’objet de ce reportage réalisé par France 24.
Mais Israël n’est pas le seul pays où les conditions de vie de certains rescapés sont dramatiques. Aux États-Unis, parmi les 36 000 survivants de l’Holocauste résidant principalement dans l’État de New York, 40% d’entre-eux vivent également sous le seuil de pauvreté, selon l’UJA-Federation of New York, qui collecte des fonds pour leur venir en aide.
Une situation qui s’est aggravée, tant aux USA qu’en Israël, avec l’épidémie de coronavirus et ses conséquences sanitaires et psychologiques impactant une population particulièrement traumatisée, isolée et fragilisée par le confinement.
Alain Granat
Pour soutenir ces associations en Israël, les liens qui suivent :
Aviv For Holocaust Survivors
Latet
Help For Holocaust Survivors
En France :
Casip-Cojasor
FSJU
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation de Rothschild
Photo de une : Asia Komisarov, israélienne rescapée de la Shoah, dans la chambre qu’elle habitait en 2015 après avoir été expulsée de son appartement. © Association For Immediate Help For Holocaust Survivors / DR
Article publié le 21 avril 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020
Luther Adler, l'acteur juif qui incarna 3 fois Hitler à l'écran 23 Jan 2023 2:50 AM (2 years ago)
Si la performance de Bruno Ganz incarnant Hitler dans La Chute, réalisé en 2004 par Oliver Hirschbiegel, a marqué les esprits, le nom de Luther Adler, acteur juif américain venu du théâtre yiddish qui endossa trois fois le costume du dictateur nazi à l’écran, ne manquera pas d’intéresser les cinéphiles. En particulier pour un film rare réalisé en 1951 et projeté seulement deux fois en France, au Centre Pompidou en 2013 et à la Cinémathèque de Paris en 2018, The Magic Face.
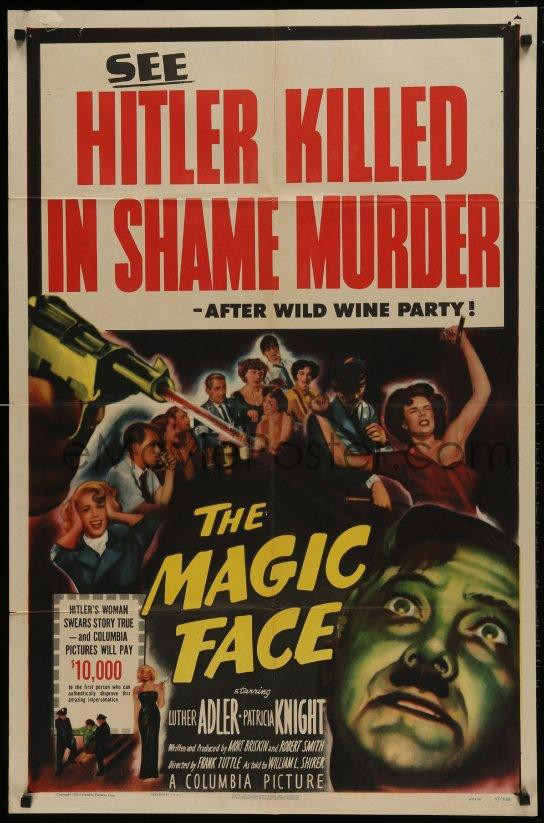
Lutha Adler est né à Manhattan en 1903, dans une famille juive originaire d’Odessa. Ses parents, Jacob et Sara Adler, étaient acteurs, Jacob Adler fut l’une des immenses stars du théâtre yiddish, démarrant sa carrière en Russie avant de l’interrompre en 1883, alors que le genre est interdit par le régime tsariste. Jacob Adler émigre en Grande-Bretagne, devient une vedette du théâtre yiddish de Londres, avant de partir pour New York en 1889, où il crée sa propre compagnie qui connaîtra un immense succès, en particulier avec la pièce Der Yiddisher Kenig Lir (Le roi Lear yiddish), qui se déroule en Russie au XIXe siècle.

Jacob Adler dans le rôle de Shylock, du Marchand de Venise de Shakespeare, théâtre yiddish
La fratrie Adler compte six frères et soeurs, tous « enfants de la balle », parmi lesquels Stella, son aînée de deux ans, qui fonda le « Stella Adler Theatre Studio » à New York en 1949. Elle y enseignera l’art dramatique pendant plus de quarante ans, comptant parmi ses élèves Marlon Brando, Warren Beatty, Mark Ruffalo, Benicio Del Toro, Sydney Pollack, Robert De Niro, Christopher Waltz, Salma Hayek…
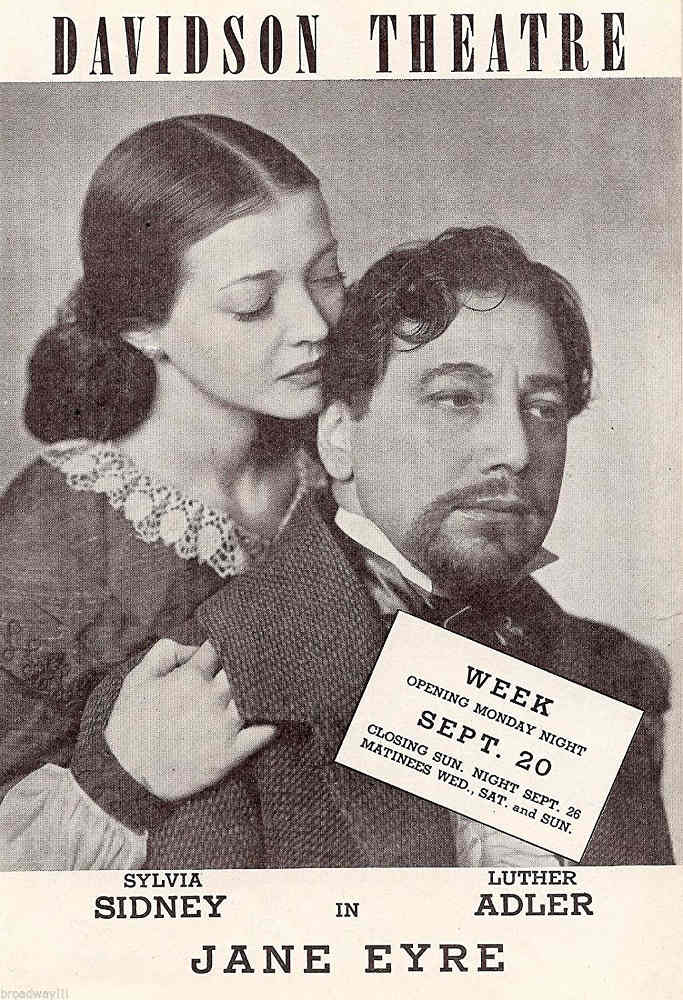
Luther Adler fait ses débuts sur scène à l’âge de cinq ans dans le théâtre de son père, donnant la réplique à sa mère ainsi qu’à ses frères et sœurs. C’est en 1921 qu’il entame réellement sa carrière à Broadway avec «The hand of the potter» d’après Theodore Dreiser. Dans les années vingt, l’acteur se consacre à la scène, son nom s’affichant au fronton de pièces jouées à Broadway. En 1931, il rejoint la troupe du «Group Theatre», qui compte parmi ses membres Elia Kazan, Lee Strasberg et John Garfield. Ce collectif, politiquement marqué à gauche, produira de nombreuses pièces à vocation sociale et humaniste. En 1937, Luther apparaît pour la première fois au cinéma dans «Amour d’espionne» de Gregory Ratoff. En 1938, il épouse Sylvia Sidney, actrice d’origine juive roumaine et russe, à qui Fritz Lang offrira ses plus beaux rôles dans Furie, J’ai le droit de vivre et Casier judiciaire. Luther et Sylvia auront un enfant et divorceront en 1947.

Luther Adler
Jusqu’alors concentré sur le théâtre, Adler revient au cinéma en 1945, au générique du film «Cornered» d’Edward Dmytryk, puis en 1948 où il donne la réplique à Veronica Lake dans «Trafic à Saïgon», à John Wayne dans «Le réveil de la sorcière rouge» et à Rita Hayworth dans » Les amours de Carmen». Les seconds rôles s’enchaînent, de «La maison des étrangers » (1949) de Joseph Mankiewicz, à «M. Le maudit» (1949) de Joseph Losey – remake du film de Fritz Lang de 1931 –, en passant par « Le fauve en liberté» (1950) de Gordon Douglas, «Au royaume de la pègre» (1952) de Joseph Kane et «Les assassins meurent aussi» (1954) de Lewis Foster. Luther Adler est alors une figure du film noir américain.

Mais c’est avec un film aujourd’hui totalement oublié et pourtant étonnant, « The Magic Face », que Luther Adler va frapper un grand coup, dans une performance absolument brillante. Sur un scénario délirant de Robert Smith et Mort Briskin, ce film réalisé par Frank Tuttle (surtout connu pour avoir livré des noms – et s’en être vanté – au Comité des activités anti-américaines, en mai 1951, en pleine « chasse aux sorcières », après avoir avoué son ancienne appartenance au parti communiste) raconte l’histoire d’un comédien-imitateur nommé Janus (il faut absolument voir Luther Adler imitant sur scène Mussolini au début du film !), qui pour se venger d’Hitler qui a séduit sa femme après une représentation, se fait engager comme son valet de chambre dans le but de l’assassiner – ce qu’il réussit à faire, à la veille de la bataille de Dunkerque ! – et le remplace ensuite en se grimant afin de mener le Troisième Reich à sa perte, ruinant les stratégies de guerre nazies. Comble de l’histoire, le film est introduit, façon docu-drama, par le célèbre journaliste américain William L. Shirer, connu aux USA pour sa couverture de l’accession au pouvoir d’Hitler, de la Seconde guerre mondiale et du procès de Nuremberg. Une figure incontournable du paysage médiatique américain d’alors, caution de sérieux absolu. Le NY Times ne s’y trompera pourtant pas dans sa critique du film publiée le 1er octobre 1951, concluant ironiquement sur le mode « on a quand même du mal à gober ça »…
Mais ne boudons pas notre plaisir, car « The Magic Face », s’il reste une curiosité cinématographique, est loin d’être un nanar. Le film est évoqué par Colin McCabe dans un article sur Chris Marker paru dans l’excellente revue Trafic (éditions P.O.L.) en 2012. Le futur auteur de La Jetée aurait vu ce film étrange dans une salle de Los Angeles en 1952, et ne s’en serait pas remis. L’auteur de l’article, notant que The Magic Face avait disparu des écrans et n’avait jamais été distribué en France, écrit alors « On mesurera l’importance que ce film revêtait pour lui au fait que, tandis que je laissais sur son répondeur un message balbutiant pour expliquer que je lui en avais apporté une copie à Paris, Marker (qui filtrait toujours ses appels) décrocha soudain et me lança : “ Vous êtes le Messie ! ”. »
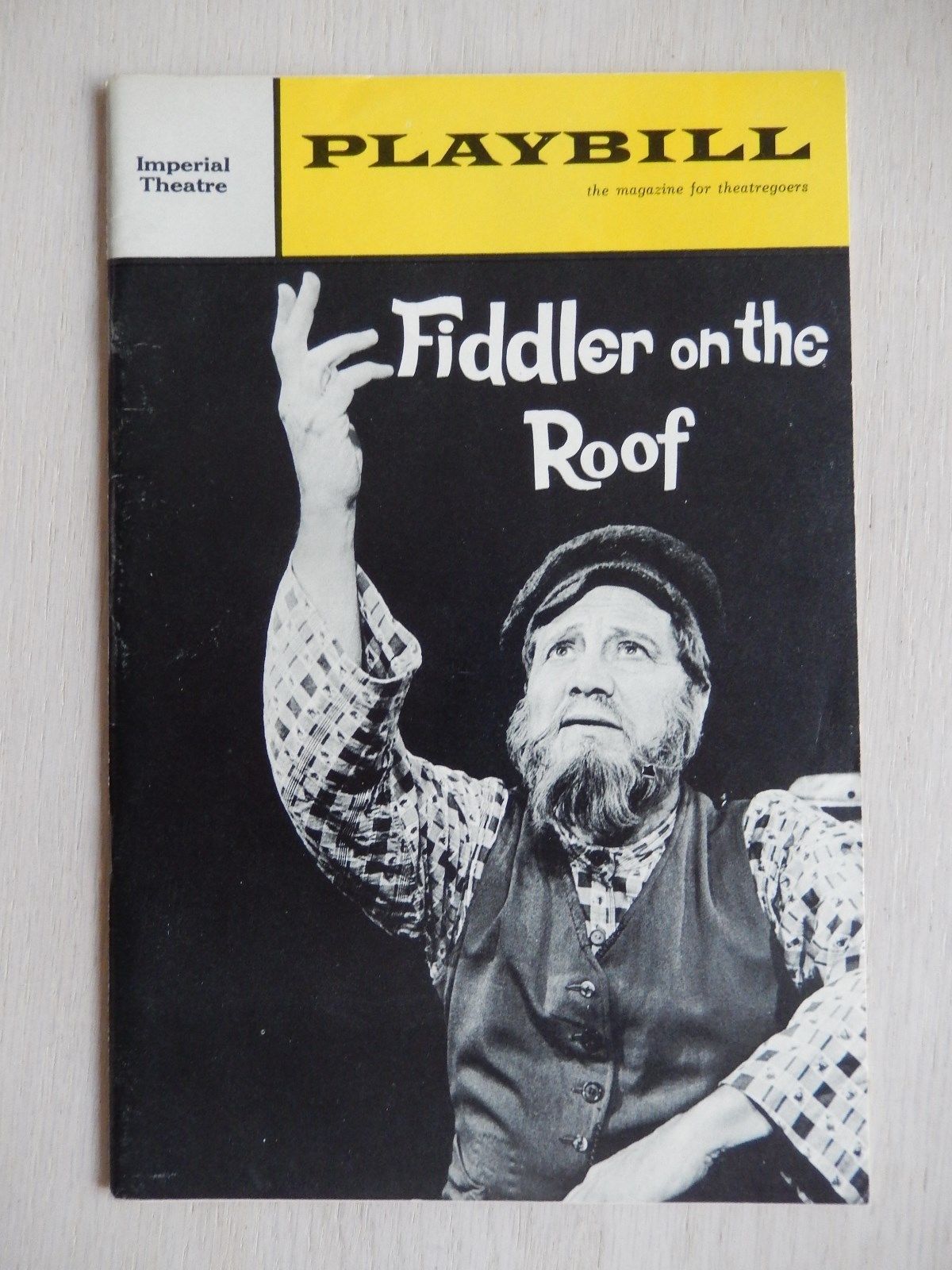
Luther Adler dans « Un violon sur le toit »
Quant à Luther Adler, il aura droit à sa seconde moustache-postiche hitlérienne l’année suivante, en 1951, dans «Le renard du désert» de Henry Hathaway. La scène mémorable qui l’oppose à James Mason (dans le rôle-titre du maréchal Rommel), a sans nul doute inspiré Mel Brooks pour son remake de To be or not to be. La troisième incarnation d’Hitler par Luther sera la dernière, pour la série télé La Quatrième dimension. Au cours des années soixante, il se consacrera essentiellement à la mise en scène de pièces, parmi lesquelles «Vue du pont» (1960) d’Arthur Miller, montera «Un violon sur le toit» en 1965, dans lequel il jouera le rôle de Tévié, et «La valse des toréadors» de Jean Anouilh en 1969. En 1981, pour sa dernière apparition au cinéma, il est l’Oncle Santos dans «Absence de malice» aux côtés de Paul Newman et Sally Fields. Luther Adler est décédé le 8 décembre 1984.
Y-a-t’il une moralité à cette histoire ? Le théâtre yiddish mène vraiment à tout !
Alain Granat
Voir The Magic Face sur YouTube (dans une copie de très mauvaise qualité…)
Voir The Desert Fox (Le Renard du désert) sur YouTube
Commander le dvd The Magic Face sur ebay
© photos : DR
Article publié le 15 novembre 2018. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop
Cara Peters, aux deux obus 23 Jan 2023 2:48 AM (2 years ago)
Surnommée par ses admirateurs “Missile nose cone”, que l’on pourrait traduire par “obus pointants”, Cara Peters a fait les délices des magazines de charme américains des 60s, des clubs de strip-tease de Los Angeles et de Russ Meyer, felliniesque réalisateur juif américain, amateur de jeunes femmes sévèrement galbées.
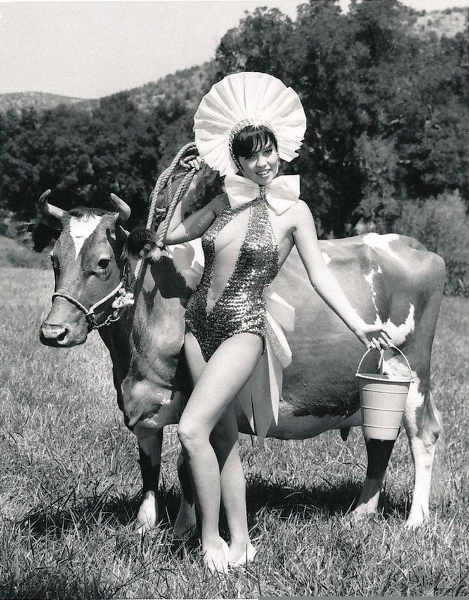
Cara Peters, publicité pour Milka
Née en 1940 à Los Angeles au sein d’une famille juive originaire de Poméranie, Cara Peterson coule une enfance heureuse sous le soleil de Californie. C’est sur la plage de Malibu, au début des années soixante, qu’elle est repérée par Sam Bubetsky, éditeur de la revue coquine French Frills (NDT : Fanfreluches françaises), qui publiera ses premières photos dénudées, lui créant pour l’occasion un personnage affriolant de jeune étudiante parisienne.
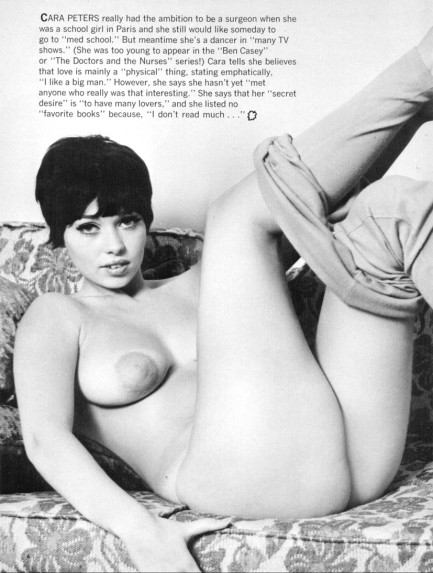

Mais c’est le réalisateur Russ Meyer qui la rendra célèbre en lui donnant son premier grand rôle à l’écran dans Europe in the Raw (1963), un documentaire sur “le monde du vice en Europe” tourné en caméra 16mm entre Amsterdam et Paris, où Cara exerce alors ses talents de stripteaseuse, auréolée de succès sous le pseudonyme de Denise Du Vall. Gageons que les dormeurs n’étaient pas au rendez-vous.

Dès lors, Cara enchaînera les séances photos pour magazines de charme, devenant une égérie du body painting en vogue dans les années pop art, célébrée par le magazine Playboy dans son numéro de mars 1968.
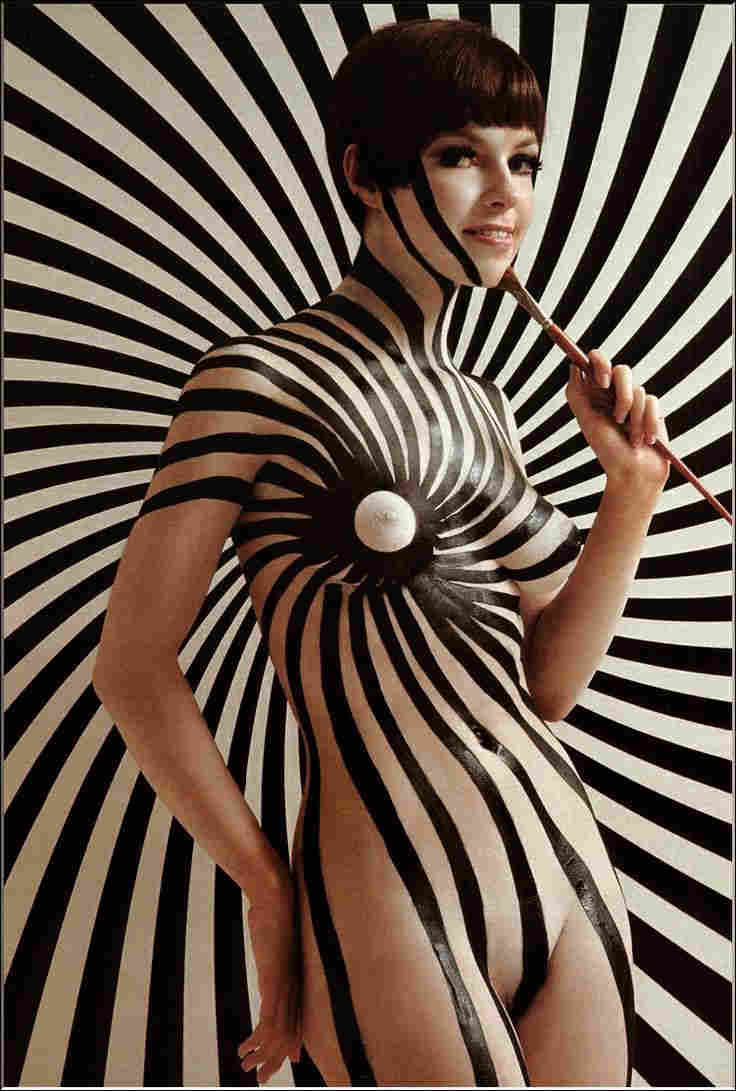
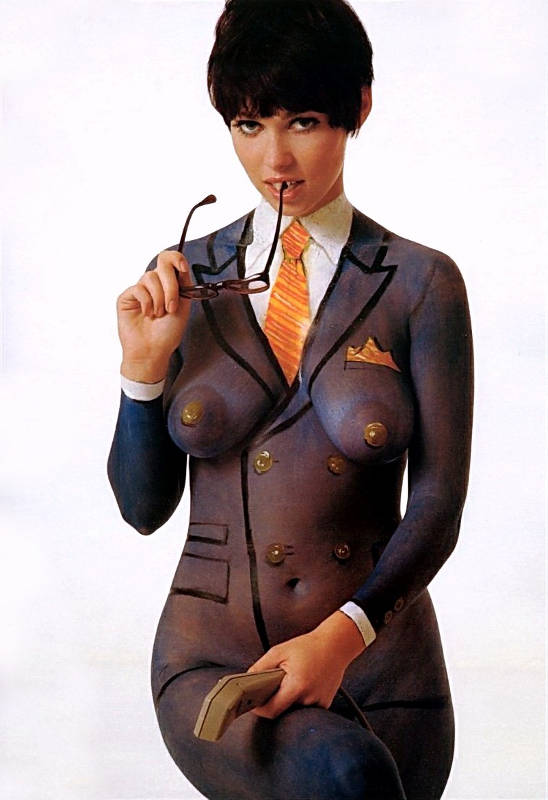
Alternant par la suite shows de cabaret sexy et films plus ou moins recommandables au jeune public. Parmi ceux-ci, on retiendra le remarquable Suburban Pagans (1968) de William Rotsler, un mocumentaire sur la libération des mœurs,version Californication sixties, où son sens du rythme fait des merveilles sur d’endiablées musiques jerk.

Cara Peters dans le film Suburban Pagans (1968)

Cara Peters, Space Thing (1968)
1968 restera sa grande année cinématographique. Cara Peters tournera aux côtés de Dean Martin dans Matt Helm règle son compte, bien que non créditée au générique pour des raisons qui nous échappent. Puis dans Space Thing de Byron Mabe, sans doute le premier film de science-fiction érotique, où elle incarne la capitaine de vaisseau spatial Legs Benedict, menant son équipage de lesbiennes au fouet !

Sa carrière à l’écran se terminera en beauté, par un baiser échangé avec Frank Sinatra en 1970 dans la série tv Make Room from Granddaddy. Depuis, Cara Peters et ses missiles ont hélas disparu des radars.
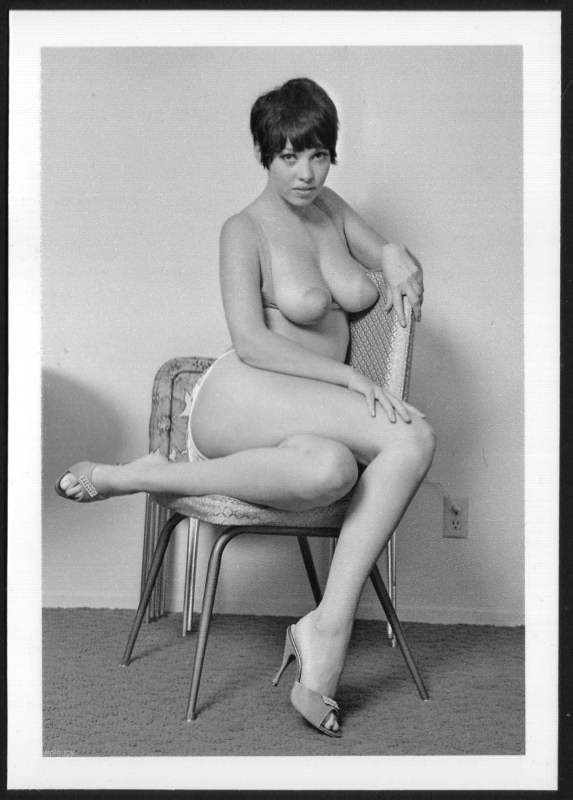
Josée Bénazeraf
© photos : DR
Article publié le 4 décembre 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop
Les frères Tharaud, Zemmour des années folles 23 Jan 2023 2:48 AM (2 years ago)
Des titres de livres tels que Bar-Cochebas, L’Ombre de la Croix, La Rose de Sâron, Un Royaume de Dieu, Quand Israël est roi, L’An prochain à Jérusalem !, Petite histoire des Juifs… ne vous disent absolument rien ? Pas plus que les noms de leurs auteurs, Jérôme et Jean Tharaud ? Tous deux membres de l’Académie française et lauréats du prix Goncourt, cette fratrie littéraire tombée dans l’oubli fut pourtant le duo star des éditions Plon dans les années 20 et 30. Avec une pléthore d’ouvrage traitant pour beaucoup des mondes juif et arabe, dont les scores de vente feraient pâlir d’envie Eric Zemmour. Une littérature ouvertement antisémite et à la gloire de la colonisation, reflet d’une époque.
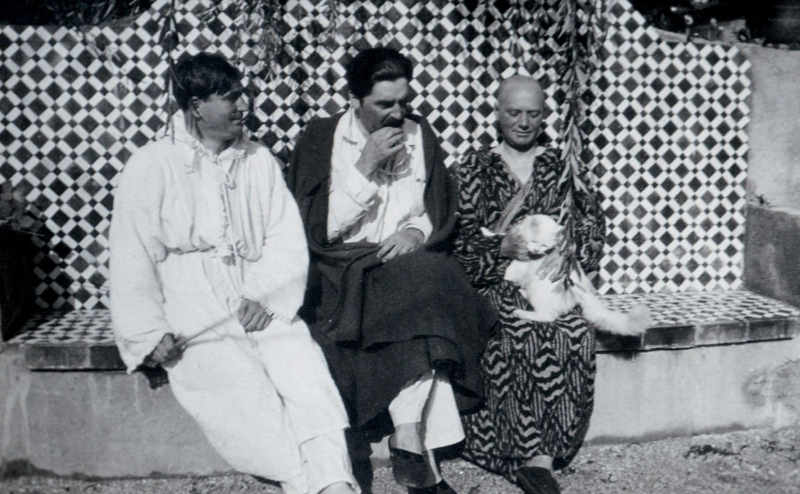
Photo de Jean Tharaud (à gauche) et Jérôme Tharaud (à droite) au Maroc (non datée)
« Nous n’avons jamais écrit une ligne l’un sans l’autre »

Jérôme et Jean Tharaud, qui passeront leur vie ensemble jusqu’à habiter sous le même toit durant plusieurs décennies, et cosigneront une cinquantaine de livres et de très nombreux articles comme journalistes, de la Revue des Deux Mondes au Figaro, «offrent une illustration sans équivalent d’une singulière symbiose : la fusion entre deux esprits, deux styles en un seul.» comme le souligne la quatrième de couverture de la passionnante biographie que leur a consacré l’historien Michel Leymarie, spécialiste de l’Action française et de Maurice Barrès, La preuve par deux (CNRS Éditions, 2014).
Débarquant de leur Limousin natal à Paris à la fin des années 1890, ils se lient d’amitié avec Charles Péguy qu’ils suivent au moment de l’affaire Dreyfus et des Cahiers de la Quinzaine. C’est Péguy qui les rebaptisera Jérôme et Jean, comme les apôtres. Adoubés par l’auteur de L’Argent, puis séduits par les thèses de Maurice Barrès, ils se placent rapidement sous le patronage de l’écrivain et figure de la droite nationaliste et antisémite, devenant secrétaires littéraires de ce dernier. C’est avec leur roman dont le personnage principal est Rudyard Kipling, Dingley, l’illustre écrivain, prix Goncourt 1906, que les frères Tharaud deviennent célèbres (mais qui se souvient aujourd’hui d’Ernest Pérochon, prix Goncourt 1920 pour Nêne ?). Journalistes globe-trotters et romanciers au style empreint de classicisme, leur petite entreprise littéraire va croître avec une régularité métronomique, jusqu’au grand prix de littérature de l’Académie française, dont ils seront lauréats en 1919, avant de confirmer leur statut d’auteurs de best seller.
Pendant près de vingt ans et sans discontinuer, avec des ventes dépassant parfois les 200 000 exemplaires, au point que leur éditeur Plon les gratifiera d’à-valoir colossaux et de pourcentages alors jamais vus dans le monde de l’édition, ils font figure d’écrivains incontournables dans les devantures des librairies. Les frères Tharaud seront définitivement consacrés par leurs pairs en devenant membres de l’Académie française. Les académiciens ne pouvant élire simultanément la fratrie, Jérôme y sera accueilli en 1938, Jean en 1946. Les deux frères décèdent à une année d’intervalle, le cadet Jean en 1952, Jérôme en 1953. Leur œuvre sombrera ensuite dans l’oubli, si ce n’est pour être étudiée par des chercheurs et historiens, ou recherchée chez les libraires d’occasion par des nostalgiques de littérature antisémite d’avant-guerre et quelques curieux de « littérature coloniale ».
Le « filon juif », une niche très rentable dans la littérature française des années 20
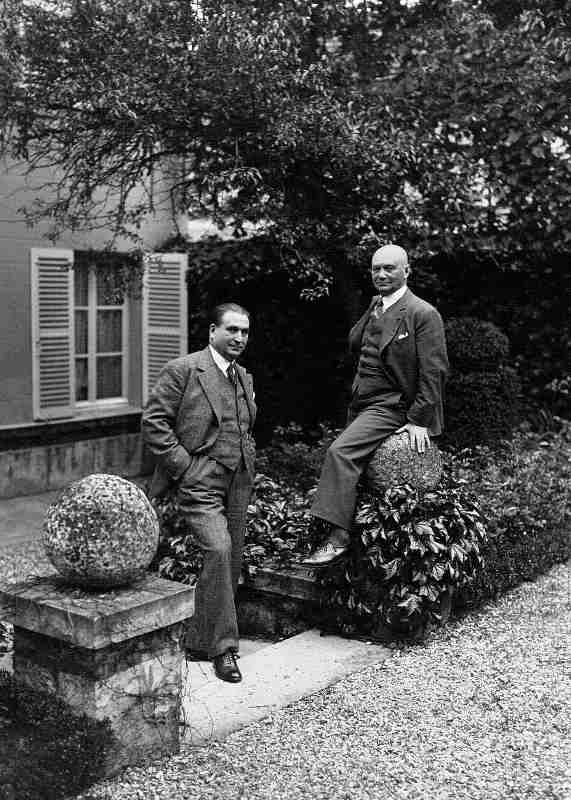
Jean et Jérôme Tharaud (1932, dans leur maison de Versailles)
L’expression « filon juif » est celle qu’utilise à juste titre Michel Leymarie dans un article qu’il a consacré aux frères Tharaud dans la revue Archives juives (2006), soulignant la place importante que la « vie juive » prit dans la littérature produite par la fratrie, et l’exploitation de ce « filon » éditorial très juteux dans leur œuvre, et dans celle d’autres auteurs durant la même période (alors que sont publiés en juin 1921 les Protocoles des Sages de Sion, dans le même temps paraissent des ouvrages comme Le Péril juif de Georges Batault ou le Règne d’Israël chez les Anglo-Saxons et L’Impérialisme d’Israël de Roger Lambelin, que publie Bernard Grasset ). Une œuvre française, pour parodier le nom du parti d’extrême-droite du très peu regretté Pierre Sidos. Et emplie d’ambiguïté du côté des Tharaud, entre fascination ethno-journalistique et « message indubitablement antisémite », comme le souligne l’historien.
Les Tharaud sont des globe-trotters. Ils ont côtoyé le maréchal Lyautey au Maroc durant la Grande Guerre et sont les chantres d’une France forte et éternelle, résolument colonialiste. Mais seraient aussi, selon le professeur de littérature Cheikh M. Ndiaye, qui livre dans la revue Voix Plurielles (2019) une analyse de leur roman de guerre La randonnée de Samba Diouf (Plon, 1922), des « précurseurs ou avant-gardistes du projet de décolonisation de l’Afrique occidentale française. » Dans son article « Les frères Jérôme et Jean Tharaud : avant-gardistes de la Négritude ? », l’auteur insiste sur le travail de « restauration de la mémoire et de l’imaginaire africains » accompli par les Tharaud dans ce roman. S’ils seraient donc à « l’avant-garde de la négritude », étaient-ils également le chaînon manquant entre les écrits antisémites de Barrès et ceux de Céline ?
« Je venais de poser la main sur un nid chaud, et j’en éprouvais à la fois une sensation de tiédeur et de dégoût. » Cette citation de Jérôme Tharaud datée de 1924 que produit Michel Leymarie, relative aux sentiments qu’éprouve alors le co-auteur d’une série de romans et chroniques ayant pour cadre la « vie juive » en Europe de l’Est, ne laisse aucun doute sur la fascination doublée de répulsion qu’exercent les populations juives sur la fratrie, lorsqu’elle les découvre au cours des ses périples en Hongrie et en Pologne, puis au Maroc. De leur roman Bar-Cochebas, publié en 1907 dans les Cahiers de la Quinzaine, aux thèses antisémites de Barrès auxquelles ils adhèrent, les Tharaud ne manifestent aucune ambiguïté sur leurs sentiments à l’égard des juifs, qu’ils soient français depuis des générations, habitants des Carpathes ou d’un mellah.
Durant la Grande Guerre, ils ne se privent pas de se moquer, dans des correspondances privées avec Barrès (qui, au passage, sera de ces nationalistes qui exhorteront à la lutte tout en restant soigneusement éloignés des tranchées, ainsi que le notait le philosophe Alain, de 5 ans cadet de Barrès, tout aussi antisémite, mais engagé volontaire en 1914 et qualifiant ce dernier de « lâche ») des soldats juifs de la Légion étrangère, en souhaitant que les juifs « autochtones » soient d’un niveau plus combatif, tandis que la révolution bolchévique de 1917 leur inspire ces mots : « La révolution russe est, pour une bonne part, une révolution juive. Personne ne connaît mieux que nous la question. »
Si ces propos ne choqueraient pas écrits par un historien contemporain tel que Yuri Slezkine, auteur du magistral Le Siècle juif, ils sont de la part des Tharaud l’une des multiples manifestations de leur antisémitisme « bon teint » et de leur haine du « judéo-bolchévisme » qui sera l’une des marques de fabrique de leur entreprise littéraire. Une entreprise qui séduit autant les lecteurs non-juifs que nombre d’israélites français, attirés par leurs peintures « pittoresques » de ces juifs miséreux, si éloignés des lumières du « réveil juif » en vogue au cours des années 20 dans les sphères intellectuelles juives d’alors.
Tintin au shtetl
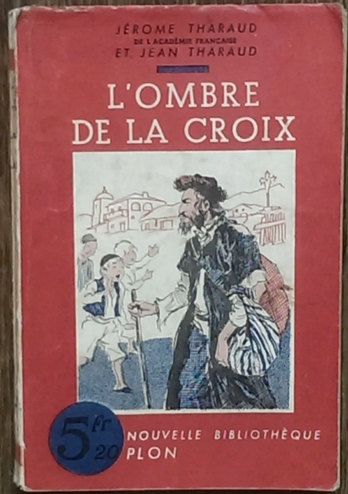
En 1912, rapporte Michel Leymarie, Jean Tharaud se rend en Hongrie et en Galicie, à Strij, puis à Bels, « forteresse de la foi juive », qu’il décrit ainsi : C’est une sorte d’Algérie, de Maroc à l’envers, où les burnous sont des cafetans noirs, où la boue noire, et épaisse d’un demi-mètre, remplace la poussière, et que couvre un ciel chargé de pluie. Une misère inimaginable encore. Une saleté pour laquelle il faut renoncer à chercher une épithète. Les deux frères se rendent par la suite à Budapest, qu’ils appellent parfois « Judapest », pour documenter ce qui sera leur premier « roman juif », L’Ombre de la Croix, publié d’abord en feuilleton en avril 1914 dans L’Opinion, puis chez Plon en 1919. Le succès en librairie est immédiat, les ventes totaliseront 216 800 exemplaires.
Dans L’Ombre de la Croix, un cabaretier juif d’un village des Carpathes va en Pologne commander une Torah copiée de la main du Tzadik de Bels, un des quatre rabbins miraculeux de l’Europe orientale. Son séjour est prétexte à de longues descriptions de « baroques personnages d’un autre âge et d’un autre climat », descriptions qui virent rapidement aux stéréotypes antisémites : Les mains, les longues mains nerveuses, s’agitaient avec une rapidité folle, en mille gestes qui exprimaient à merveille toutes les nuances des pensées qui traversaient les esprits. Chacun de ces longs doigts minces, terminés par des ongles noirs, se démenait devant les visages comme autant de marionnettes, autant de petits personnages doués d’une vie particulière ; et si par hasard les mains s’arrêtaient un instant d’expliquer et de convaincre, elles se plongeaient fiévreusement dans les barbes, pour aller y chercher un pou ou une idée, tandis qu’une soirée de shabbat où est présentée la carpe farcie traditionnelle devient ainsi un repas où les fidèles se baffrent, l’humour des banquets d’Astérix écrits par Goscinny en moins : Les mains aux ongles noirs fouillaient dans le poisson, déchiquetaient les carpes, se plongeaient dans la sauce qui coulait sur les caftans et les barbes. […] Maintenant, c’étaient les nouilles qui pendaient à tous les doigts, glissaient le long des barbes, sur la lustrine ou la soie des caftans.
La deuxième partie du roman a pour protagoniste un jeune garçon, Ruben, qui se fait couper les papillotes par des chrétiens alors qu’il regardait, fasciné, la cérémonie de Noël. En s’échappant, il tombe malade pour avoir regardé une croix à un carrefour. Le symbole est transparent : bien que juif et élevé selon les plus strictes prescriptions de sa religion, le garçon est attiré par le catholicisme. Après qu’il eut recouvré la santé, son grand-père, un vieux copiste, est à son tour malade et Ruben offre sa vie pour prolonger cette vie en déposant dans l’Aron Hakodesh, L’Arche sainte aux Torah, un parchemin qui consigne sa décision. On eût été étonné de ne pas trouver évoquée dans l’œuvre l’histoire du sacrifice rituel des enfants auquel se livreraient les Juifs au temps de la Pâque ; elle ne manque pas d’être présentée, mais ici le narrateur s’efface derrière les chrétiens du village qui rapportent l’histoire, comme le note Michel Leymarie.
Le ton est quasiment identique dans les parutions suivantes des Tharaud, exploitant ce « filon juif » sous toutes les coutures. Et si les critiques s’accordent, à la lecture des premiers « romans juifs » des Tharaud, à louer l’indéniable talent de conteurs des auteurs, leurs peintures de ces populations reste dénuée de toute empathie. Le sthetl et ses habitants, pour les frères Tharaud, c’est Rendez-vous en terre inconnue revu et corrigé façon “Bienvenue chez les youpins !”.
Les Tharaud “historiens” : Zemmour des années folles
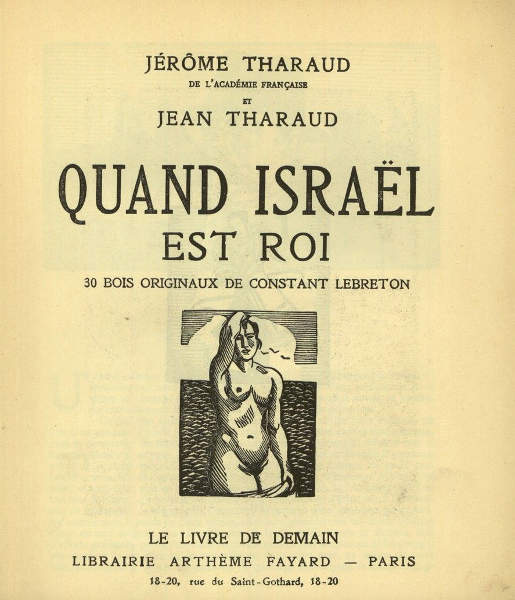
Avec Quand Israël est Roi, les Tharaud se veulent davantage historiens, mais leur vision de la révolution et de la contre-révolution en Hongrie décrite ici est digne des inepties proférées par Éric Zemmour dans ses ouvrages à prétention historique. Écrit en 1920 à la suite d’un nouveau voyage en Hongrie, le livre est grassement payé par la Revue des Deux Mondes, où il paraît d’abord en feuilleton sous le titre de Bolchevistes de Hongrie ; dédié à Maurice Barrès, il est publié chez Plon en juin 1921. Là encore, le succès est fulgurant. Deux traductions anglaises sont proposées, puis une américaine et une roumaine. Le tirage de Quand Israël est roi, toutes éditions confondues, s’élèvera à 101 000 exemplaires.
Le livre compte trois parties, centrées autour des figures du comte Tisza, de Karolyi et de Bela Kun. De Karolyi, président de la République provisoire de Hongrie d’octobre 1918 à mars 1919, les auteurs font une sorte de Kérensky hongrois manipulé par des conseillers juifs qui installent, jusqu’en août 1919, un pouvoir bolchevique, « une Jérusalem nouvelle » « sortie du cerveau juif de Karl Marx et bâtie par des mains juives sur de très anciennes pensées ». Pour « masquer le caractère sémitique de ce mouvement communiste » – sur vingt-six commissaires du peuple, dix-huit sont juifs –, un chrétien est placé à la tête du mouvement par Bela Kun, dont le portrait est édifiant : La tête ronde, complètement rasée, de vastes oreilles pointues, les yeux gros et saillants, le nez court, les lèvres énormes, une bouche largement fendue, pas de menton, l’air d’un lézard, tel apparaît Bela Kun. Au moral, un petit employé juif, débrouillard et rusé, comme on en voit des milliers à Budapest.
Comme les Tharaud n’ont pu se rendre en Russie « pour étudier sur place l’activité d’Israël dans cette grande aventure », ils expliquent qu’ils s’en sont fait « une idée par une autre révolution, calquée sur le modèle de la révolution russe. » Les auteurs prétendent ainsi expliquer le rôle révolutionnaire de certains Juifs, « sortis pour la plupart de quelque ghetto campagnard », par leurs croyances religieuses passées. Autrement dit, les ghettos seraient des nids de révolutionnaires et le mouvement bolchevique, réduit à une cause unique, s’expliquerait par le rôle des Juifs. C’est sans compter que ni Marx ni Lassalle ne sont sortis d’un ghetto polonais… Les Tharaud affirment que le mouvement bolchevique à Budapest – comme à Moscou – est un assaut de « l’Orient chassé, il y a deux siècles, de la forteresse de Bude » et constitue une nouvelle attaque des barbares asiatiques contre la civilisation. Vous avez dit Zemmour ?
Dans Quand Israël est roi, œuvre au titre-programme, les Tharaud se font les adeptes d’une théorie du complot juif qui les inscrit dans une droite extrême. Léon Daudet ne s’y trompe pas qui, marquant la filiation des auteurs, écrit que leur livre, « exposé d’un grand et fier courage », est « un enseignement » et « démontre cette vérité, signalée par Drumont, creusée par lui – avec cette vision dantesque qui lui appartenait : LA RÉVOLUTION, C’EST LA GUERRE JUIVE. […] La révolution, ou guerre juive, est une guerre d’extermination et d’expropriation. Elle veut l’argent, la peau, le sol. »
Au début de leur ouvrage, les Tharaud déplorent l’oubli dans lequel est tombé l’effort qu’a soutenu pendant des siècles « pour la Chrétienté tout entière » la vieille citadelle d’Occident de Bude. Les dernières lignes donnent la parole à « la voix du Chrétien » qui, après l’assaut des Turcs, voit dans le mouvement dirigé par Bela Kun « le dernier assaut de l’Asie », et, en quelque sorte, un choc de civilisations, la menace tangible de la corruption d’une identité nationale et occidentale par des éléments étrangers. Sans s’interroger sur l’existence ou non de croyances religieuses chez les révolutionnaires russes ou hongrois, les Tharaud invoquent un lien entre judaïsme et bolchevisme. Selon eux, Karl Marx et Bela Kun, « las de chercher au ciel ce royaume de Dieu qui n’arrive jamais, […] l’ont fait descendre sur terre ». La version définitive de Quand Israël est Roi dit d’une façon caricaturale : « Le Capital de Karl Marx, c’est du Talmud encore ! » Vous avez dit grand remplacement ?
L’An prochain à Jérusalem !, best seller 1924
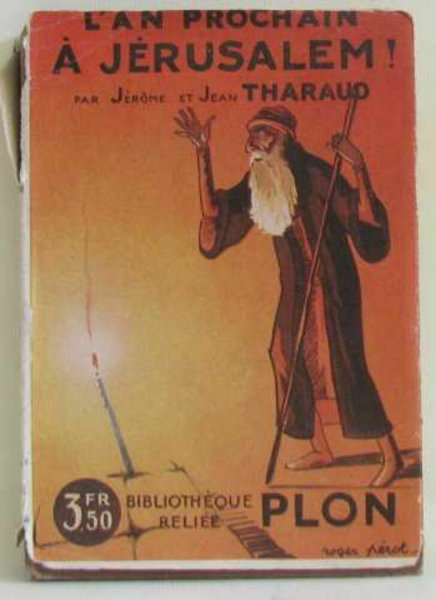
Les Tharaud publient en 1924 L’An prochain à Jérusalem !, d’abord en feuilleton dans la Revue des Deux Mondes puis chez Plon la même année. Dès septembre 1924, c’est « le livre, selon leur éditeur, qu’on continue à vendre le plus à l’heure actuelle sur Paris ». Toutes éditions confondues, il est publié à plus de 106 000 exemplaires.
Nos Tintin et Milou se sont par la suite rendus en Palestine, avec les recommandations de l’écrivain, poète et militant sioniste André Spire. Il s’agit ici d’un travail de journalistes, une suite de portraits de personnalités, de Théodore Herzl au baron Edmond de Rothschild, en passant par Ben Yehouda, artisan de la renaissance de l’hébreu, d’interviews et de reportages in situ. Pour eux, le projet de Herzl en Palestine est justifié par le fait que « les Juifs étaient au milieu des autres peuples une sorte de corps étranger qui troublait les vies nationales » et qu’eux-mêmes « s’y trouvaient mal à l’aise. », tout en doutant des capacités d’adaptation des pionniers qu’ils rencontrent, notant que « c’est une idée folle, de vouloir rassembler dans ce pauvre pays toute la juiverie de l’univers. »
Ici encore, les frères Tharaud recherchent le « divertissement », trouvant une fois encore à Jérusalem une source d’exotisme juif. Source qui ne se tarira pas, l’obses-sion des auteurs les conduisant ensuite en Afrique du Nord. Ainsi dans Rabat, ou les heures marocaines, le(s) narrateur(s) se trouve(nt) « tout à coup dans un autre univers, à mille lieues d’ici, en pleine Galicie, au pays des caftans noirs » : au Maroc, ils retrouvent des « juifs vêtus de souquenilles », « sous une autre lumière, toujours pareils sous tous les cieux ». Dans Marrakech, ou les Seigneurs de l’Atlas, un chapitre entier est consacré – sous le titre « un ghetto marocain » – au mellah, « un des lieux les plus affreux du monde ».
La Petite Histoire des Juifs, version Tharaud
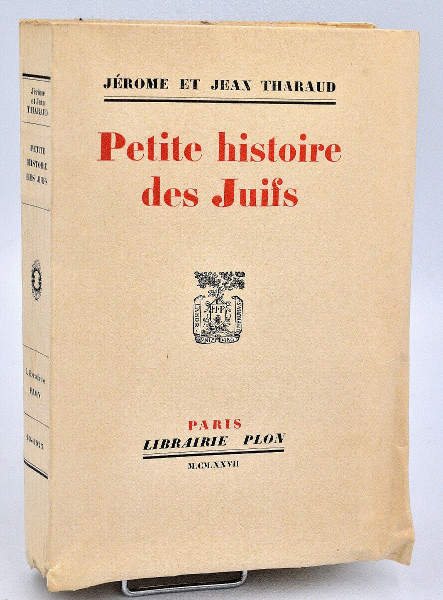
La Petite Histoire des Juifs paraît d’abord dans la maurrasienne Revue Universelle avant d’être publiée chez Plon en 1927. L’ouvrage se veut historique et l’œuvre de « spécialistes » du « fait juif ». On y trouve pêle-mêle des portraits de Moïse, de Maïmonide et de… Chaplin ! Ici encore, préjugés et clichés antisémites côtoient prétentions d’historiens. Ils poursuivront dans la même veine avec avec Quand Israël n’est plus roi, où ils reprennent le thème selon lequel les Juifs, pourtant persécutés, menaceraient les sociétés occidentales.
Le succès de leurs ouvrages ne se démentira pas jusqu’à la fin des années 30, qui verra nos infatigables globe-trotters parcourir l’Indochine, la Syrie, l’Espagne et l’Éthiopie en guerre… Le « filon juif » s’épuisera, avant de connaître une nouvelle forme, encore plus virulente et destructrice, dont Céline sera l’épitomé. Dans leur autobiographie publiée après la Deuxième Guerre mondiale, ils affirment avoir, des Carpathes à Jérusalem, bénéficié d’informations fournies par des amis juifs ou par d’autres rencontrés sur place, et n’avoir pas à choisir entre philosémitisme ou antisémitisme, ces termes n’ayant pour eux aucun sens, se plaçant juste en terme « d’observateurs »… Des observateurs en voyage en Allemagne en 1933, qui ne manqueront pas de minimiser l’antisémitisme en action, de même que les mesures antijuives prises en Italie en 1938, alors qu’ils y effectuent un reportage.
Leur attitude durant l’Occupation sera toute aussi empreinte de ces sentiments de fascination-répulsion, entre leur admiration d’anciens combattants et de nationalistes affichée pour Pétain, le refus de voir leurs écrits antisémites utilisés par les médias collaborateurs, et leur souhait de victoire des Alliés.
Que faut-il alors retenir de l’œuvre des frères Tharaud ? En 1923, l’auteur de Belle du Seigneur, Albert Cohen, les compte parmi les romanciers français les plus notoires à avoir « découvert les Juifs » : Ils sont les peintres officiels des fantoches à papillotes, en caftans verdis et couverts de taches que cachent les barbes vierges saupoudrées de tabac râpé. Enquêteurs excellents, ils vont sur place chercher leur documentation ; à leur retour, ils montrent les marionnettes frénétiques des synagogues et les crânes féminins que les perruques de satin recouvrent chastement., tandis que François Mauriac écrivait à propos de la fratrie Tharaud « un violent instinct raciste se délivrait ici par le pittoresque ».
Leur antisémitisme obsessionnel, qui constitue une tache indélébile sur leur carrière d’écrivains et de journalistes, a été soigneusement rayé de la carte par l’Académie nationale, qui sur son site Internet se garde bien de mettre en lumière les ouvrages les plus populaires des frères Tharaud, ce « filon juif » et surtout antisémite qui fit leur richesse et contribua à leur notoriété.
Dans la biographie qu’il leur consacre, Michel Leymarie constate qu’ils furent le « baromètre » d’un lectorat, certes non homogène, et le reflet d’une partie des passions de la société française d’il y a près d’un siècle. Toute ressemblance avec…
Alain Granat
Sources : Les frères Tharaud, de l’ambiguïté du « filon juif » dans la littérature des années vingt, de Michel Leymarie (Archives juives, 2006)
Commander la biographie des Frères Tharaud La preuve par deux, de Michel Leymarie (CNRS Éditions, 2014) sur le site leslibraires.fr
© photos : DR
Article publié le 10 septembre 2020. Tous droits de reproduction et de représentation réservés © 2020 Jewpop