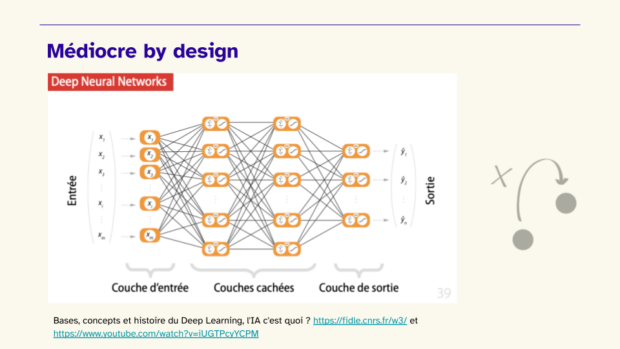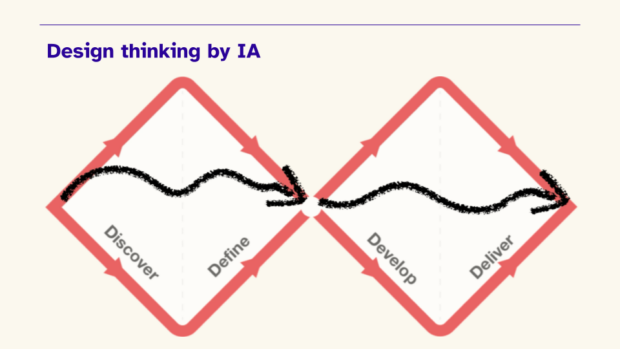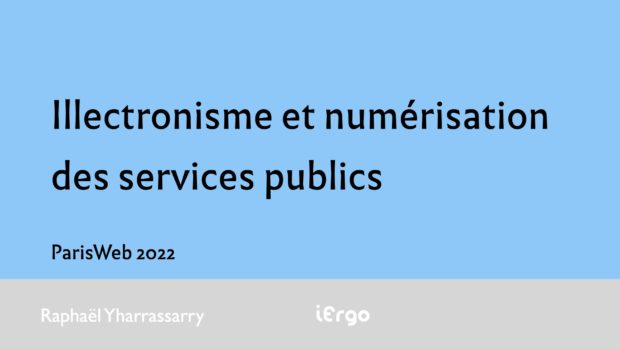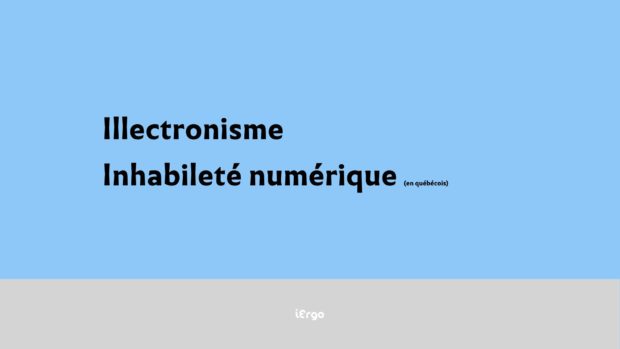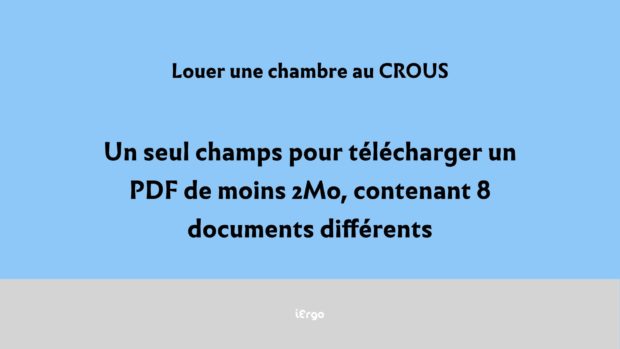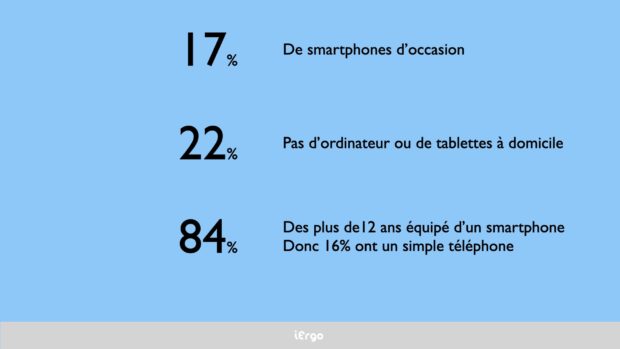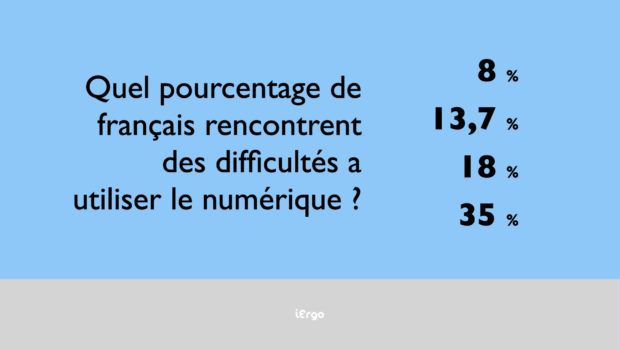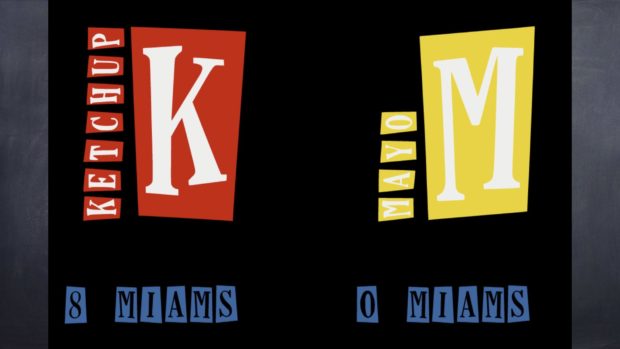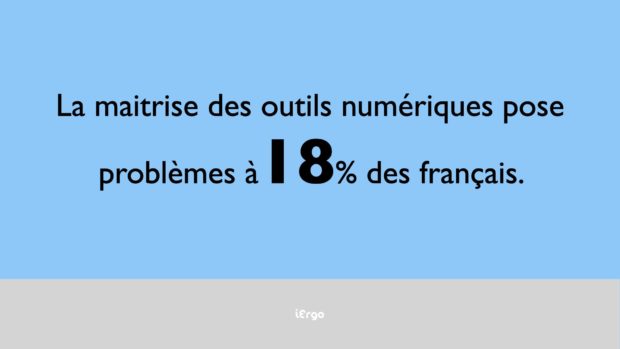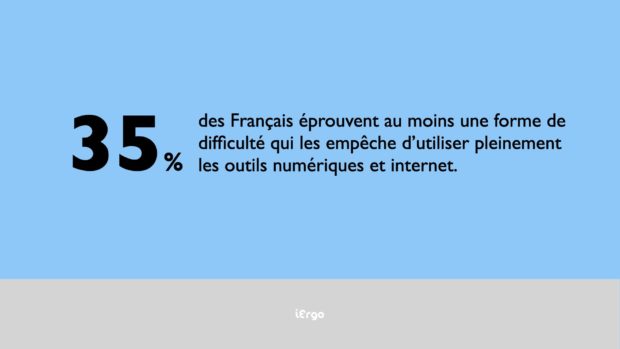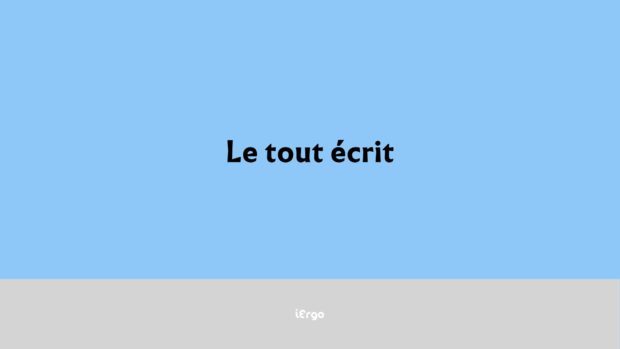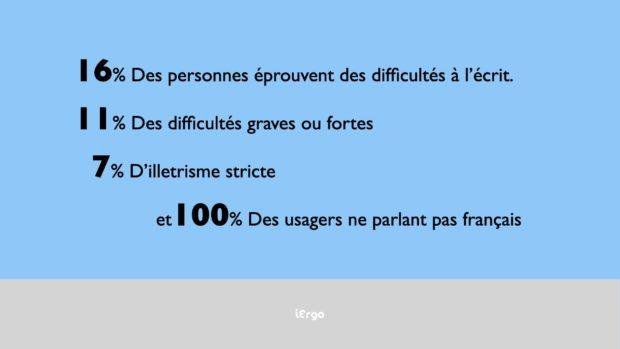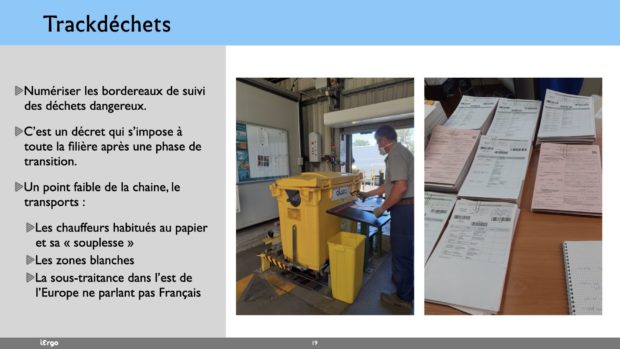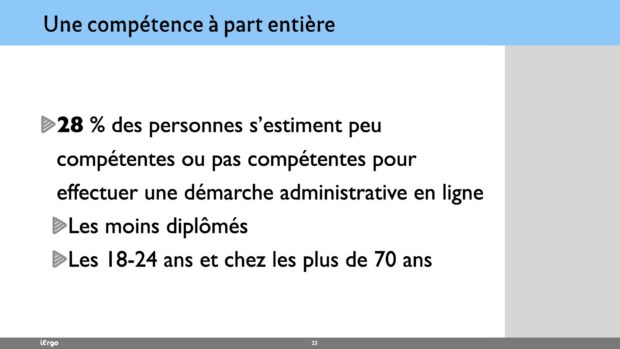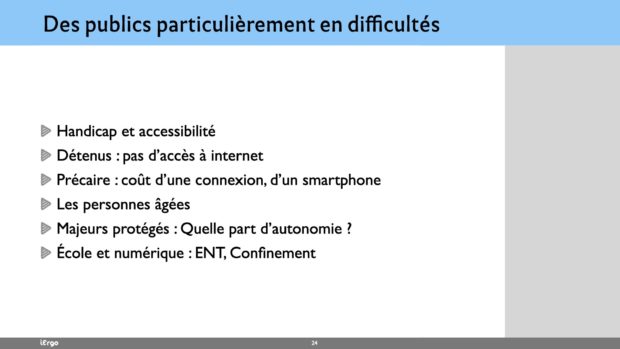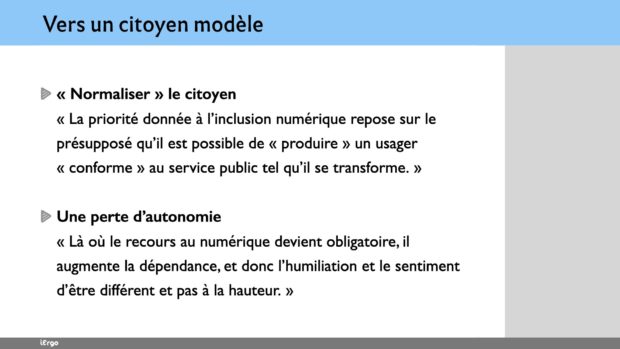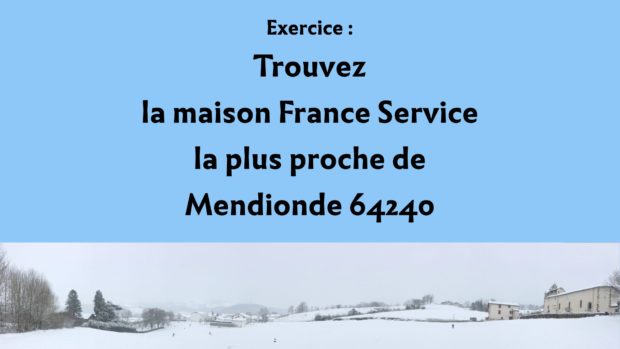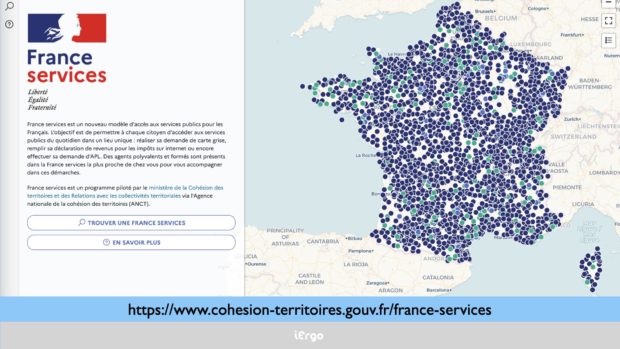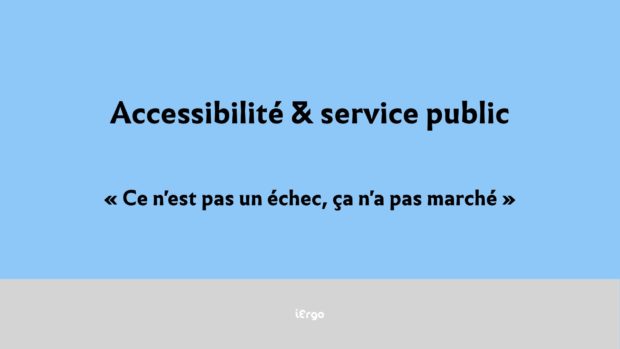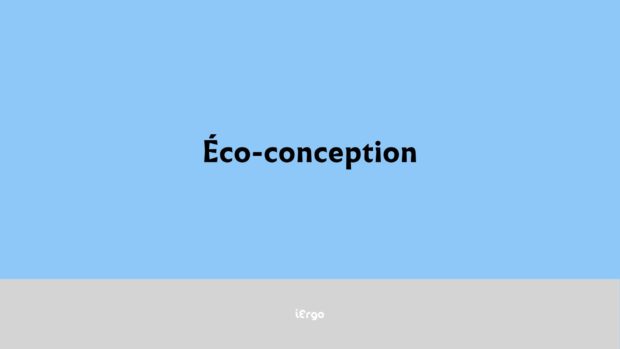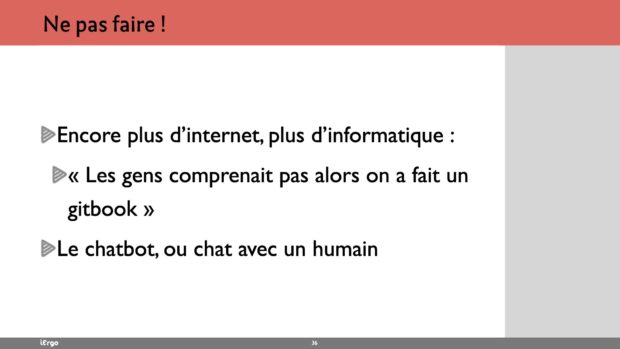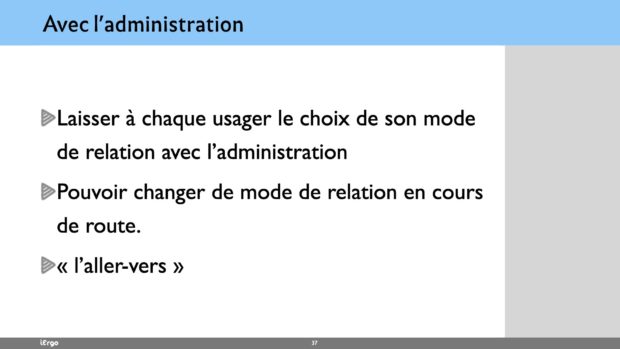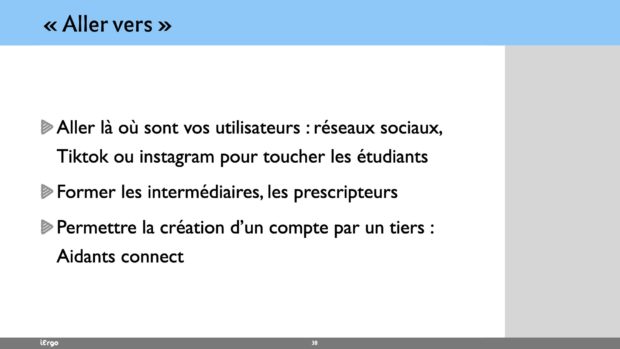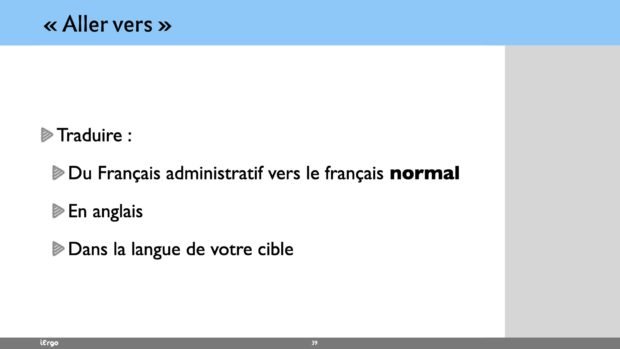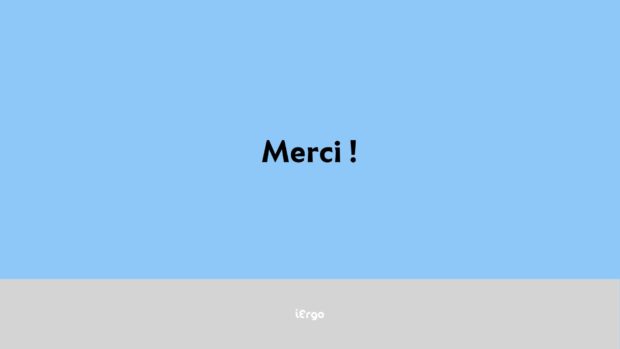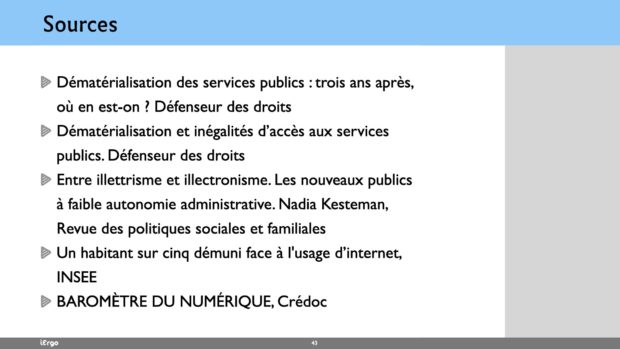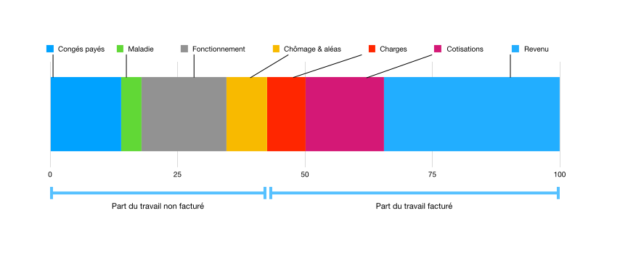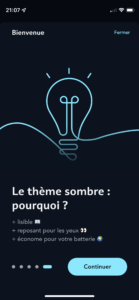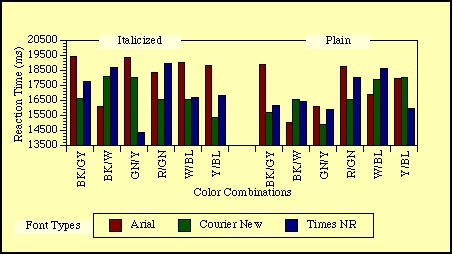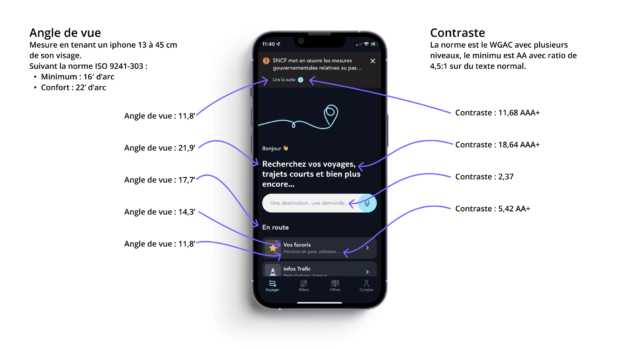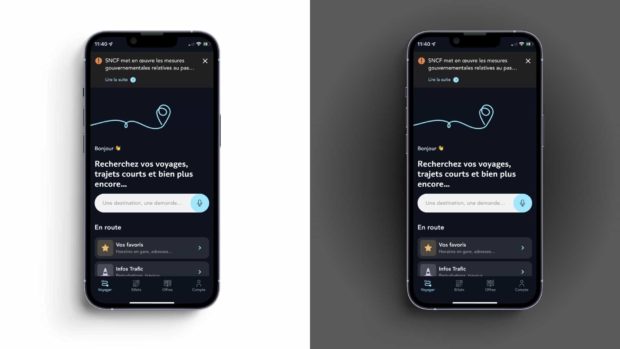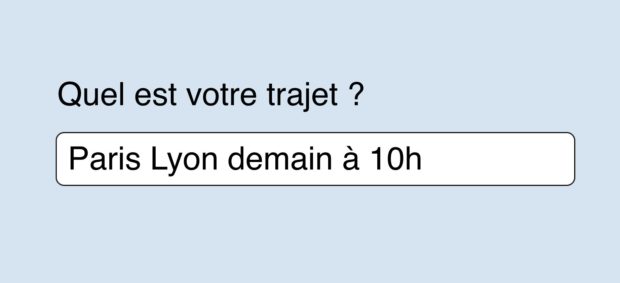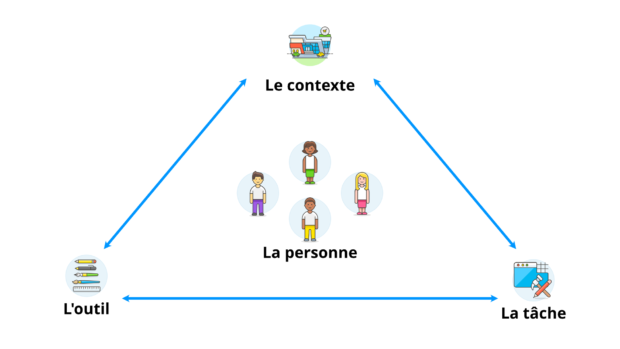Le bloc-notes, UX & Design d'expérience utilisateur View RSS
L’impact psychosocial de l’IA sur nos métiers du numérique 3 Oct 5:24 AM (22 days ago)
Lors de Parisweb 2025, j’ai donné cette conférence sur l’impact de l’IA sur nos métiers du numérique. Je vous propose donc la présentation et les notes associés, donc à peu près ce que j’ai raconté. La vidéo sera disponible bientôt.
Le fichier PDF L’impact de l’IA sur nos métiers du numériques (PDF, 4 mo)
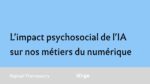
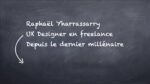









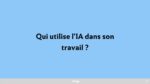


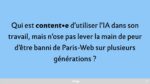

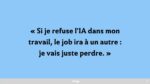







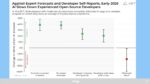
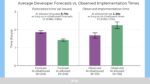
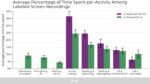







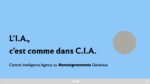













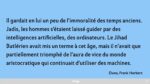

Mes notes brutes :
- Donc, je vais vous parler de l’impact psychosocial de l’IA sur nos métiers du numérique
- Déjà, je vais me présenter brièvement, je travaille comme ux designer depuis le dernier millénaire. Personnellement, j’ai une formation initiale en psychologie sociale et en ergonomie, d’où le fait que je vais parler des risques psychosociaux liés à l’intelligence artificielle.
- Au début, je ne voulais pas parler de l’IA, car ça a toutes les caractéristiques d’une technologie zombie :
- Ce n’est pas nouveau, c’est des technos qui existent depuis les années 60.
- Ça buzz de temps en temps, quand il y a un changement de techno, puis ça disparait.
- C’est une technologie qui n’est pas viable dans le monde fini que nous habitons. Donc il y a un moment ou il va falloir choisir entre conduire des SUVs électrique ou utiliser l’iA. Les deux consomment les même ressources, de l’electricité et des terres rares.
- Donc je reste persuadé que c’est une bulle qui va éclater, mais en attendant ça un impact sur nos métiers, nos organisations. J’ai donc essayé de trouver quelques études pour regarder ce que ça donne. Pour l’instant elles sont assez peu nombreuses.
- Avant d’attaquer avec nos métiers, je vous propose un pas de côté dans un métier où l’IA est déjà bien implanté depuis un certain temps.
- Donc, je vous propose de commencer par une étude ergonomique par Tamari Gamkrelidze, La mise en œuvre de l’IA dans un service de radiologie. Deux usages de l’IA sont faits : la détection automatique des fractures sur les radios et la reconnaissance vocale pour la transcription des comptes rendus.
- Impacts : Les secrétaires médicales ne retranscrivent plus les comptes-rendus oraux de médecins, c’est automatisé, mais c’est au médecin de vérifier l’exactitude de la retranscription. Cette étape de transcription va donc être “supervisé” par le médecin au lieu d’être faite par les secrétaires.
- Pour la reconnaissance vocale, en positif, on note le gain de temps dans la production.
En négatif, un appauvrissement du rôle de la secrétaire qui ne relie plus les comptes rendus et pouvaient éviter des erreurs aux radiologues. - En positif, la détection joue un rôle de vérification et peut guider notamment les internes. Mais ce guidage à des conséquences négatives si on s’appuie trop dessus, notamment dans l’apprentissage, et risque de lui faire trop confiance et de passer à côté de fractures “atypiques” mal détectées.
- Moins de coopérations, moins de contrôles, plus d’erreurs et Trop d’assistance ralentie les apprentissages
- On va, maintenant, aborder un premier aspect qui concerne le consentement…
- Qui utilise l’IA dans son travail, de manière régulière hors test ?
- Qui est contraint d’utiliser l’IA ?
- Qui est content d’utiliser l’IA ?
- Qui est content d’utiliser l’IA, mais n’ose pas lever la main ? (Pour ceux qui n’ont pas oser répondre, venez me voir on va monter un groupe de parole pour les IA anonymes )
- Pas besoin de faire un dessin, vous l’avez vu vous-même. Il y a de l’IA qui nous est fourguée dans tous nos outils, que ça soit pour nos usages pros, ou même les outils du quotidien. Bien sûr, on ne nous a pas demandé si on en voulait ou pas. Au mieux, on vous laisse le choix de ne pas partager votre travail pour que ça soit digéré par une IA.
- Il y a aussi un impensé sur l’IA. Une injonction a utilisé l’IA, on ne sait pas trop pourquoi faire ? Mais une injonction à l’intégrer dans nos métiers, sans qu’il y ait un besoin qui ait émergé de nos pratiques. Voir ça crée une concurrence malsaine entre collègue, y ‘en un qui commence à l’utiliser puis l’autre est obligé de suivre. Une espèce de FOMO (fear of missing out) vis-à-vis de l’IA. Une peur de passer à coté.
- Et ça commence par le recrutement. Et en fait il y a déjà un vrai risque sur la phase de recrutement avec le traitement automatisé de ceux-ci. Il n’y a pas ou peu de contrôle sur ces outils destinés au ressources humaines. Le constat qui est fait, c’est que ça amplifie les discriminations. Et les entreprises se cachent derrière l’outil pour ne pas assumer leurs responsabilités.
- La réalité est déjà, Albert, l’IA de l’état, pourrait servir à organiser les affectations de poste et pour éviter les conflits. Je vous laisse imaginer les conséquences de l’usage d’un algorithme dans ces conditions.
- J’ai un peu trainé dans des conférences agiles ces derniers temps et ce qu’on proposait comme futur “désirable” ça ressemblait à ça : un backlog trié par IA, avec une attribution automatique et une évaluation de la complexité, comme ça, on est sûr vous ne glandez pas dans un coin et on surveille votre productivité.
- Donc, je vous pose la question, vous consentez à ce que votre travail soit organisé avec votre équipe ou par une intelligence artificielle.
- Le grand argument de l’IA c’est aussi la productivité… vous allez gagner du temps … (ou pas)
- Très bien gagner du temps. Alors, quand j’ai commencé à travailler comme ergonome IHM à l’époque, j’ai un mentor qui m’a dit “Si tu conçois un logiciel qui permet de faire le travail deux fois plus vite, combien il restera d’utilisateurs dans 6 mois ? Probablement deux fois moins, mais si on peut se trouver l’excuse qu’ils ont avoir à faire des choses plus intéressantes ? Oui, mais quoi ? Un traducteur va faire quoi de plus intéressant que de traduire ?
- Alors, je vous propose de vous pencher sur une expérience récente. Des chercheurs ont demandé à 19 développeurs expérimentés de soumettre un certain nombre de tâches de développement classiques plus de 250 au total. Puis ils ont redistribué ses tâches aux autres développeurs et ils ont demandé une estimation du temps nécessaire pour faire la tâche avec ou sans IA et puis de réaliser la tache.
- Brièvement, ce qui en ressort, c’est que les développeurs estiment le temps gagné avec l’IA à 20% alors qu’en réalité ils mettent 20% de temps en plus ! Et ils maintiennent cette estimation même après avoir vu les résultats de l’étude. Une autre fois je vous parlerai des biais de confirmation !
- Si on regarde dans le détail, sans IA, le temps estimé est assez proche du temps observé de réalisation de la tâche. Avec IA, le temps estimé est largement inférieur au temps sans IA, mais surtout, il est largement inférieur au temps réel observé.
- Qu’est-ce qui change entre les deux situations ? En fait les développeurs sous-estiment complètement le temps qu’ils passent à interroger l’IA, à attendre qu’elle réponde et à relire le code fourni. Donc ça fait gagner un peu de temps de code, sur la lecture de la documentation et les tests, mais pas assez pour compenser le temps perdu avec l’IA.
- Donc vous préférez : passer du temps à écrire du code propre, de qualité, documenté et maintenable ou corriger du code de piètre qualité produit par une IA et dont vous n’avez aucune idée de la manière dont il fonctionne ?
- On la vue dans le cas de radiologie, un des risques c’est l’expertise, comment l’acquérir et la maintenir…
- Qu’est qui fait la différence entre un novice et un expert : C’est les métaconnaissances, c’est-à-dire les connaissances sur les connaissances. La capacité à développer de nouvelles connaissances, de nouvelles procédures. Bien sûr si vous prenez une IA, elle n’a aucune connaissance et encore moins des métaconnaissances. Elle a juste des données. On y reviendra.
- Donc l’expertise, dans la vraie vie, ça s’acquiert par, l’apprentissage, pour dessiner un personnage, on apprend les proportions, et l’anatomie. (C’est qu’une IA générative ne connaît pas), l’expérience de l’imitation quand on est bébé à l’expérience pro. La collaboration avec ses collègues : Pour résoudre un problème, vous préférez demander à collègue ou à une intelligence artificielle ? Et bien sûr la transmission de ces connaissances…
- Et donc le risque identifier est double, moins d’interactions au sein des équipes avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l’ambiance et des difficultés pour les novices à passer certains seuils de compréhension sans recourir à l’expertise de leurs pairs.
- Donc vous préférez, partager vos connaissances entre humains ? Ou éduquer des intelligences artificielles ?
- On va parler aussi un peu de Design
- Alors, petit rappel, l’IA c’est comme dans CIA, la CIA, ce n’est pas l’agence centrale de l’intelligence, mais du renseignement. En France on parle des renseignements généraux. Pas d’intelligence générale, ça se serait… Donc l’IA n’est pas intelligente, mais a des données liées entre elles par un modèle probabiliste.
- Il faut bien comprendre que, derrière toutes les intelligences artificielles, il y a un réseau de neurones. Ce n’est absolument pas nouveau, ça date des débuts de l’informatique dans les années 60. Chaque neurone va avoir des valeurs en entrée qu’il va pondérer pour donner le résultat le plus probable. Cela, maintenant dans des proportions gigantesques. Donc, par conception, ces modèles sont bons voir très bon quand ils sont dans la zone “médiane”. Plus on s’éloigne de cette zone médiane, moins les résultats vont être bons ou pertinents, plus ça risque d’halluciner. Donc l’IA est performante pour aller d’un domaine connu à un autre, de l’oral au texte, d’une langue à une autre. Elle est performante pour distinguer et classer des schémas connus : détecter des cancers sur des radios (6,7 avec IA pour 5,7 /1000 femmes cancers du sein) Classer des commentaires.
- Elle est aussi très performante pour vous refourguer des stéréotypes et des biais. Donc, quand je vois des designers qui se servent de l’IA pour explorer des pistes créatives, non, ce n’est pas des pistes, c’est des autoroutes ! Une fois sur ces autoroutes, ça être très difficiles d’en sortir.
- J’avais croisé ce post sur LinkedIn (oui, je sais c’est mal de perdre son temps sur LinkedIn). Concrètement si on traduit, ça veut dire j’écris un cahier des charges exhaustif pour chacune des pages et ça me produit les maquettes ou mieux le logiciel… Sauf que écrire un cahier des charges exhaustif, c’est qu’on faisait au dernier millénaire et aujourd’hui c’est n’est pas très agile. Donc, perso, je ne rêve pas d’écrire des cahiers charges, je préfère aller taper la discute avec des utilisateurs ou dessiner des écrans.
- (même slide que la précédente)
- donc concrètement à quoi ça peut servir dans un processus de design ?
- Ce qui marche bien, en gros c’est qui tourne autour du langage écrit ou oral. Petit point d’attention, les fonctions de résumés, de synthéses vont négligé les signaux faibles qui nous intéresse.
- Donc ce qui ne marche pas :
- Pour la stratégie UX, si vous demandez à Chat gpt, ça va vous sorti un processus bateau, donc si vous êtes un peu expert… bah c’est poubelle.
- Pour faire l’état de l’art ? Perplexity est fiable à 50% donc là c’est juste mort, faite une recherche dans une bibliothèque en ligne (Cairn ou ACM), ça sera plus sur.
- Pour le design UI, faites un petit exercice demander à une IA de générer un logo, puis faits une recherche par image dans google avec le logo généré. Grosse rigolade en perspective.
- Pour l’étape des maquettes, le résultat est niveau débutant, et en plus, ça ne respecte pas les bonnes pratiques en terme de composants et d’organisation du fichier. Soit tu écris un cahier des charges,
- La mesure de l’UX, c’est des méthodes précises qui ne laissent pas de place aux aléas, donc si tu ne sais pas, tu ouvres le livre de Carine Lallemand Méthodes de design UX
- Alors, non, ce n’est pas parce que tu prends des décisions, mais c’est parce que tu essayes d’expliquer ton métier à un système qui n’apprend rien et qui interprète de façon aléatoire tes demandes. Même un étudiant en première année ferait mieux !
- Pour en revenir aux risques psychosociaux qu’on peut identifier. Pour moi il y a le risque de la médiocrité, de la rapidité qui ne va pas laisser le temps nécessaire à la maturation d’une bonne idée. Perso, mes meilleurs idées, je les ai en courant dans la montagne pas dans un ordi. Donc ça va entrainer une lassitude cognitive, en épuisement plus rapide, et l’absence de construction des méta-connaissances vu qu’il y a absence de réflexion, d’essai-erreur. Deuxième point, quand vous adressez à une IA pour « challenger » une idée, vous ne vous adressez pas à des humains, pas des experts d’un métiers que soit des développeurs ou des juristes. Donc perte de lien avec les collègues… Et donc aussi probablement une moindre prise en compte des utilisateurs finaux, vous savez le U de UX et donc une perte de sens, de valeur.
- Parlons maintenant d’un futur désirable pour nos métiers…
- Donc, si on veut un futur désirable pour nos métiers, j’aurai quelques propositions à vous faire :
- Limiter l’usage aux tâches chronophages ! : Transcription, Sous-titrage (et l’accessibilité), reconnaissance d’écriture (oui les post-its à saisir) ou la classification de contenus
- Préférer les petits modèles spécialisés : Langage, Détection, optimisation, en appui à une expertise humaine
- Vérifier les résultats, vous connaissez le départ et l’arrivée : Dont on connaît le domaine de départ et celui d’arrivée
- faite tourner ça sur votre ordi ! : Et pas sur celui de quelqu’un d’autre dans les nuages !
- Le risque est réel, notamment sur l’apprentissage et le transmission de connaissance. Il y a un risque de perte de sens dans nos activités et donc une lassitude qui peut arriver plus rapidement d’où la nécessité de prendre soin de nous et de nos relations aux autres.
- Si vous voulez aller plus loin, ou avoir des arguments pour convaincre dans votre entreprise, vous pouvez aussi vous appuyez sur ces deux guides qui montrent de bonnes pratiques autour de l’IA.
- Une dernière citation tirée de Dune, un petit livre de science-fiction écrit par un humain.
- Merci.
Ça va bien se passer : la product conf 18 May 10:56 PM (5 months ago)
Je viens de tomber sur le programme de la product conf et ça fait rêver ! Oui, ça fait rêver toutes ces conférences avec une thématique unique qui parle d’éthique et de responsabilité sociétale !
Ha, zut j’ai confondu avec une autre conf avec éthique dans le nom. Bon, disons, que la product conf pourrait facilement devenir l’IA conf que ça choquerait personne. Littéralement 50% du programme est consacré à ce sujet. Je vous rassure tout de suite, à aucun moment l’impact écologique, social ou néocolonialiste n’est évoqué. Ça va bien se passer, aucune de vos convictions néolibérales ne risque d’être ébranlé par la vue d’un graphique sur le nombre de centrales nucléaires qui va falloir construire ou les photos des mines de cobalt en Afrique de l’Est et leurs impacts sur l’environnement ou les conflits armés.
J’adore aussi les sujets zombies, qui apparaissent à intervalles réguliers, puis flop, comme « Interface ZERO (UI0) » donc l’interface sans interface, c’est tellement 2001 l’odyssée de l’espace ? Ça me rappelle un truc, une startup qui a vendu un truc 7 ou 800 balles récemment et qui a mis la clef sous la porte un an après. Bon du coup, c’était vraiment zéro UI pour la peine. Si vous avez un doute, pour un autre exemple, chercher « Google glass » sur les autoroutes de l’information.
Puis quand même, il y a des sujets à la pointe de l’actualité « Accessibilité is the new RGPD : comment l’IA peut-elle faciliter la mise en conformité en 2025 ? » ce n’est pas beau ça de parler d’accessibilité et d’IA en 2025, pour une loi qui a juste 20 ans ? Ça prouve bien, une prise en compte de la diversité et de l’inclusion digne des standards du gouvernement des USA.
En parlant des USA, vous aurez la joie d’écouter une conférence « L’Utopie Libertarienne » qui vous permettra d’avoir en avant de goût de ce qu’est une politique d’extrême droite ! Oui, ça parle bien du trafiquant de drogue gracié par Trump début janvier.
Pour en revenir à la diversité, je vous ferais quand même remarquer qu’il y a 7 oratrices qui interviennent à cette conférence et elles ont le luxe de pouvoir s’exprimer dans les salles les plus intimes afin d’être proches de leurs publics. C’est quand même difficile pour les 13 orateurs de devoir subir la pression de s’exprimer dans la plus grande salle face à la majorité du public ! Je ne voudrais pas être à leur place. 7 femmes sur 23 orateurs c’est quand même un beau score en 2025 pour parler produit et design, un secteur où elles sont majoritaires !
Allez, bonne conf les winners !
Quel futur désirable pour nos métiers du numérique ? 25 Feb 8:47 AM (8 months ago)
À l’occasion de la journée de l’écoconception numérique, j’ai pris le temps d’approfondir le sujet de l’impact psychosocial de l’intelligence artificielle sur nos métiers du numérique. Je vous propose donc une version enrichie de ce que j’ai pu raconter lors de cette présentation.
Vous pouvez retrouver le support de la présentation. La première partie (1 à 11) est d’Anne Faubry et la deuxième (12 à 17) est d’Anaëlle Beignon, dont le travail est disponible sur limites numériques. Pascal Courtois et Stéphanie Vachon ont travaillé sur la conclusion.
Déjà, je n’étais pas super chaud pour aborder le sujet de l’IA. Je pense sincèrement qu’on peut très bien se passer de cette technologie de par son coût écologique, comme l’a évoqué Anne dans le début de la présentation. J’assimilerai bien l’IA à la vague des cryptomonnaies, avec sa mode puis son effondrement, à l’instar d’autres technologies zombie qu’on voit revenir régulièrement comme la réalité virtuelle. Mais il me faut bien reconnaitre que la bulle a tendance à durer déjà trop longtemps.
Donc j’ai commencé à chercher des études dans le champ de l’ergonomie qui portent sur le sujet de l’intégration des intelligences artificielles dans des métiers. Pour tout dire, ça ne court pas les rues. Il y a quand même quelques personnes qui travaillent sur le sujet, notamment Tamari Gamkrelidze qui a fait une étude portant sur la place de l’IA dans un service de radiologie.
Dans ce service de radiologie, l’IA est utilisé pour détecter des fractures sur les clichés radio et pour la reconnaissance vocale afin de retranscrire les comptes-rendus oraux des médecins. Donc les secrétaires médicales ne retranscrivent plus les comptes-rendus, c’est automatisé, mais c’est donc au médecin de vérifier l’exactitude de la retranscription.
Si je résume très vite, pour la reconnaissance vocale, en positif on note le gain de temps dans la production et en négatif, un appauvrissement du rôle de la secrétaire qui ne relie plus les comptes rendus et pouvait éviter des erreurs aux radiologues. Pour l’usage de la détection de fractures, le gain de temps est mitigé. La détection joue un rôle de vérification et permet de guider les internes en radiologie. Dans les conséquences négatives, il y a plusieurs risques. Le premier est lié à l’apprentissage qui peut être ralenti en s’appuyant trop sur la détection automatique. Paradoxalement, il y a un risque de perte de temps et enfin un risque de surconfiance. Pour contrecarrer ces deux risques, il faut que le médecin garde le contrôle dans la discussion avec le patient et l’établissement du diagnostic.
Dans cet exemple, il est intéressant de voir que l’intelligence artificielle remplace une tâche fastidieuse, la transcription, mais qu’elle pose des limites. Il faut un humain et son expertise pour vérifier le résultat de l’IA, avec le risque de trop s’appuyer dessus notamment pour les utilisateurs novices.
Un parallèle peut être fait entre l’arrivée de l’IA et l’arrivée de la robotisation dans les années 70 ou 80. Les robots industriels, ça marche bien pour les tâches répétitives dans un environnement dangereux. Mais les tâches demandant de l’adaptabilité ne sont pas robotisées. Il y a toujours des petites mains pour monter les iPhones en Chine ou des femmes de ménage.
Le consentement
J’ai un peu trainé dans des conférences Agiles ces derniers temps. Ça parlait donc souvent d’organisation du travail et d’intelligence artificielle, avec des projections sur un futur fantasmé pour les métiers du numérique. Ce futur « désirable » ressemblait à ça : Un backlog trié par IA, avec une attribution automatique et une évaluation de la complexité. Il n’est pas très compliqué d’imaginer l’étape suivante qui sera le contrôle du travail dès que le salarié sortira de la prédiction.
Un exemple concret envisagé est l’usage de l’IA Albert (une IA développée par l’état) pour piloter la phase de mobilité des enseignants et « éviter les contentieux ». Je vous laisse imaginer les conséquences de l’usage d’un algorithme dans ces conditions et la réponse qui sera apporté à ceux qui ne sont pas contents de leur affectation.
Donc, je vous pose la question, vous consentez à ce que votre travail soit organisé avec votre équipe ou par une intelligence artificielle ?
La productivité
C’est le grand argument qui va avec l’IA, la productivité ! Vous allez gagner du temps, encore et encore.
Alors quand j’ai commencé à travailler comme ergonome IHM à l’époque un mentor m’a dit « Si tu conçois un logiciel qui permet de faire le travail deux fois plus vite, combien restera-t-il d’utilisateur 6 mois plus tard ? » Probablement deux fois moins, même si on peut trouver l’excuse qu’ils vont avoir des choses plus intéressantes à faire. Oui, mais quoi ? Un traducteur va faire quoi de plus intéressant que de traduire ? Certes, une solution serait de passer le temps de travail à 17h30 par semaine pour tout le monde. Plus globalement, pourquoi chercher toujours plus de productivité dans un monde où il faudrait viser la décroissance ?
Toujours dans le concret, les impôts avec l’aide de l’IGN ont mis en place un système de détection des piscines, pour vérifier les déclarations des particuliers. Conséquence, les fonctionnaires passent plus de temps sédentaire et au final c’est l’équivalent de 300 temps pleins qui vont être supprimés ou “déplacé”. L’objectif est de limiter la fraude, mais est ce qu’on gagne en qualité de vie au travail pour les fonctionnaires et en qualité de service pour les citoyens ?
Du côté du design, je constate qu’il faut toujours un temps de maturation avant d’arriver à une solution élégante. La première solution est souvent médiocre, c’est-à-dire qu’elle va satisfaire le client, mais elle ne sera probablement pas pérenne et créera à terme une dette design ou technique.
Donc vous préférez :
- Passer du temps à écrire du code propre, de qualité, documenté et maintenable ?
- Ou corrigé du code de piètre qualité produit par une IA et dont vous n’avez aucune idée de la manière dont il fonctionne ?
L’expertise
On l’a vue dans le cas de la radiologie, un des risques c’est l’expertise et comment l’acquérir et la maintenir.
Qu’est qui fait la différence entre un novice et un expert ? C’est les métaconnaissances, c’est-à-dire les connaissances sur les connaissances. Bien sûr si vous prenez une IA, elle n’a aucune connaissance et encore moins des métaconnaissances. Elle a juste absorbé des données pour en faire une immense matrice de valeurs.
Donc l’expertise, dans la vraie vie, ça s’acquiert par différents moyens :
- Par l’apprentissage. Pour dessiner un personnage, on apprend les proportions, et l’anatomie. C’est justement ce qu’une IA générative ne connaît pas et qui donne des personnes bizarres.
- L’expérience, c’est de l’imitation quand on est bébé, des essais, des erreurs et des réussites professionnelles.
- La collaboration avec ses collègues, ses pairs : Regarder et comprendre comment les autres font, échanger, critiquer et être critiqué. Pour résoudre un problème, vous préférez demander à collègue ou à une intelligence artificielle ?
- Et dernier point, la transmission de ces connaissances qui oblige à les rendre explicites et structurées.
Si ces différents moyens sont remplacés par une IA qui va donner directement une solution, le processus cognitif de créations des connaissances et des métaconnaissances va être perturbé. La conséquence, c’est qu’il va être plus difficile de devenir expert et donc d’être en capacité de trouver des solutions innovantes pour répondre à des situations nouvelles ou complexes.
Donc vous préférez :
- Partager vos connaissances entre humains ?
- Ou éduquer des intelligences artificielles ?
La médiocrité by design
Un dernier point important. Je lis souvent des commentaires sur la créativité des IA évoquant quelques images spectaculaires issues d’une IA générative d’images à partir d’un texte. Mais revenons aux fondamentaux, par conception l’IA n’a pas d’imagination, c’est même le contraire.
Petit rappel, l’ « I.A. », c’est comme dans C.I.A. l’agence centrale du renseignement et non de l’intelligence. En français c’est les renseignements généraux, les flics, et non l’intelligence générale. Donc l’IA est basé sur un corpus d’informations. Elle n’est pas capable de produire un résultat en dehors de ce corpus.
Mais donc ça a un impact très concret, si je vous demande d’imaginer une licorne ou un éléphant rose ? Vous avez l’image en tête, vous pouvez imaginer plusieurs versions possibles, les faire tourner. Maintenant je vous dis la même licorne, le même éléphant avec des ailes sur le dos ? Vous avez l’image ? Oui. Maintenant, demander la même chose à une IA générative d’image ? Il est très probable qu’elle y arrive pour la licorne et pas pour l’éléphant. Certes, ça va dépendre du modèle et de son apprentissage. Elle fera un éléphant rose, mais sans ailes, même si vous le précisez explicitement dans le prompt. Juste parce que sur internet, il y a peu d’éléphants roses avec des ailes. C’est valable aussi pour les verres de vin, qui vont être toujours à moitié remplis même si vous précisez la quantité « à ras bord ».
Donc ne comptez pas sur l’intelligence artificielle pour sa créativité, par contre, pour vous refourguer du « déjà vu », c’est parfait !
Il faut bien comprendre que derrière toutes les intelligences artificielles, il y a un réseau de neurones. Ce n’est absolument pas nouveau, ça date des débuts de l’informatique dans les années 60. Chaque neurone va avoir des valeurs en entrée qu’il va pondérer pour donner le résultat le plus probable en sortie. Et cela, maintenant dans des proportions gigantesques. Donc par conception, ces modèles sont bons, voire très bons quand ils sont dans la zone “médiane”. Plus on s’éloigne de cette zone médiane, moins les résultats vont être bons ou pertinents, plus ça risque d’halluciner.
Donc l’IA est performante pour aller d’un domaine connu à un autre, de l’oral au texte, d’une langue à une autre. Elle est performante pour distinguer et classer des schémas connus : détecter des fractures, des cancers sur des radios (6,7 pour une IA contre 5,7 pour un humain pour 1000 femmes sur la détection du cancer du sein).
Elle est aussi très performante pour vous proposer des résultats très probables, donc des stéréotypes et des biais. Donc quand je vois des designers qui se servent de l’IA pour explorer des pistes créatives, non, ce n’est pas des pistes, c’est des autoroutes ! Une fois sur ces autoroutes, ça va être très difficile d’en sortir.
un futur désirable
Parlons d’un futur désirable pour nos métiers.
Je rêve d’une IA génératrice de maquettes haute fidélité, capable de s’interfacer avec un Design System et de digérer un brief complet de type « contenu + data + interactions » de chaque écran d’une application.
J’avais croisé ce post sur LinkedIn (oui, je sais c’est mal de perdre son temps sur LinkedIn). Concrètement si je traduis, ça veut dire j’écris un cahier des charges exhaustif pour chacune des pages et ça me produit les maquettes ou mieux le logiciel… Sauf que écrire un cahier des charges exhaustif, c’est qu’on faisait au dernier millénaire et aujourd’hui c’est n’est pas très agile. Donc, perso, je ne rêve pas d’écrire des cahiers de charges, je préfère aller taper la discute avec des utilisateurs, sur le terrain, au cul du camion.
Donc concrètement nous faisons quoi avec l’IA ? Je propose de l’utiliser avec discernement, pour les tâches chronophages notamment. En sélectionnant des petits modèles spécialisés, dont il est possible de vérifier les résultats en cas de doutes et qui peuvent tourner sur un ordinateur perso, voir un smartphone. Ça permet aussi de voir et d’entendre combien ça demande de ressources !
Je conseille de limiter les usages de l’IA :
- Aux tâches chronophages : Transcription, Sous-titrage (et l’accessibilité), reconnaissance d’écriture (oui les post-its à saisir) ou la classification de contenus
- Basé sur des petits modèles spécialisés : Détection, optimisation, en appui à une expertise humaine
- Des résultats vérifiables : Dont on connaît le domaine de départ et celui d’arrivée
- Qui tourne sur votre ordinateur : Et pas sur celui de quelqu’un d’autre dans les nuages !
Pour que le futur reste désirable, notons que :
- Le risque psychosocial est réel. Imposer de l’IA partout sans le consentement des utilisateurs va nécessairement créer des tensions. Cela aura des conséquences qu’il est difficile de prévoir en l’état actuel de nos connaissances.
- Nos tâches qui nécessitent un poil de réelle intelligence, une réelle créativité, une réelle adaptabilité ne sont pas en danger.
- Les relations entre les humains doivent rester centrales.
L’IA ne vous fournira qu’un rêve médiocre,
prenez le temps de rêver les vôtres.
La méthode des petits pas 27 May 2024 7:32 AM (last year)
Ou comment mettre en place des cycles très courts dans un projet UX.
Depuis quelques années, je suis amené à travailler sur des cycles de conceptions de plus en plus courts. Alors quand je dis court, ça ne veut pas dire bâclé. C’est plus dans l’idée de découper la conception en étapes plus succinctes avec pour chacune des étapes l’implication des utilisateurs et un livrable.
À l’origine, les cycles de conceptions pouvaient être assez longs si on parle des schémas en double diamant ou même de design thinking. Même dans les méthodes agiles, l’accumulation de cycles entre le début de la conception et le résultat pouvait s’éterniser un peu et donc on perdait le fil. C’était globalement compliqué à vendre. La méthode des petits pas est basé sur le principe de faire des étapes qui ont un début et une fin sur temps maitrisé, court, qui soit très accessible, très faisable.
Concevoir un site pour une communauté d’agglomération
Je vais vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Il y a quelque temps déjà, j’ai participé à la conception du site d’une communauté d’agglomération. La demande initiale dans l’appel d’offres était du type « Produire X templates, pour x parcours, livrer les pictos, etc… ». Un appel d’offres à l’ancienne ! Et j’ai répondu à côté de l’appel d’offres en proposant 5 cycles courts de conception d’une dizaine de jours à chaque fois. Les cycles sont les suivants :
- Existant et architecture de l’information
- Page d’accueil et base UI
- 2 parcours clefs
- 3 ou 4 parcours secondaires
- Voiture balai. Oui je vends vraiment ça comme ça.
En regardant un peu plus dans le détail pour chaque cycle, je vais impliquer des utilisateurs d’une manière ou d’un autre.
- Sur le premier cycle, j’ai listé les contenus existants et travaillé avec le client pour identifier l’orientation qu’il voudrait prendre. Il avait déjà fait un gros travail en interne de recueil des besoins. Donc on a pu établir la liste des rubriques et réaliser un tri par cartes en ligne en recrutant les utilisateurs sur le site actuel. Avec 90 réponses, on a pu établir l’architecture de l’information du futur site. Assez classiquement, on est passé d’une organisation par services à une organisation du point de vue utilisateur.
- Sur le deuxième cycle, il fallait attaquer la conception de l’interface. C’est passer par un atelier de co-conception avec une dizaine de personnes, internes et externes à la communauté d’agglomération. L’atelier a permis de dégager des lignes directrices en terme « d’envie » et d’avoir une première structuration de la page d’accueil. Une UI designer a transformé cela en une page d’accueil et un début de piste graphique.
- Sur le troisième cycle, la page d’accueil a été stabilisée. J’ai fait un test des 5 secondes auprès d’une vingtaine de personnes pour m’assurer qu’elle était bien comprise comme elle devait l’être. Dans le même temps, 2 parcours principaux ont été déclinés, par exemple « Trouver les horaires de la déchèterie la plus proche de chez vous ». Ça permet de décliner plusieurs templates : une liste de lieu, le détail d’un lieu. Que ce soit une déchetterie, une piscine ou une bibliothèque, on aura les mêmes templates de page.
- Sur le quatrième cycle, les parcours secondaires sont réalisés ce qui permet d’avoir une maquette Figma pour faire des tests utilisateurs sur 5 parcours dans le site. Dans ce cas j’ai utilisé un outil en ligne, Maze, pour réaliser les tests en ligne et en présentiel. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur dépouillement des tests même si ça a certaines limites.
- Le cycle de voiture-balai va permettre de faire les corrections et de livrer proprement l’ensemble des éléments, de finaliser les templates manquants et de prendre le temps de communiquer sur le projet auprès des services qui devront « remplir » le site.
Dans chaque cycle, on essaye de concilier du recueil d’informations, de la conception et de la validation auprès des utilisateurs, pas forcément dans cet ordre-là. Un cycle étant basé sur une dizaine de jours de travail, c’est assez court vu le travail à effectuer, mais en réalité, ça évite de se disperser.
Faire évoluer une application professionnelle
Un autre exemple de petit pas, dans un contexte d’application professionnelle. Je devais faire passer un tableau de bord d’une version ancienne à une version moderne sans casser les habitudes des utilisateurs. Ça s’est déroulé sur un temps long, environ 6 mois, mais au final avec assez peu de jours de travail côté design sur le sujet. C’est les devs qui avaient le plus de boulot !
- Déjà en amont, j’ai mesuré l’expérience utilisateur sur la version ancienne avec questionnaire MeCue qui m’a permis d’avoir un score juste supérieur à la moyenne et un peu négatif sur certaines échelles. Le questionnaire a été publié sous la forme d’un bandeau dans l’interface.
- Après, on a mis en place un déploie progressif, avec à chaque fois un questionnaire pour recueillir les retours des utilisateurs. Le déploie progressif c’est fait auprès de 200 puis 1000 utilisateurs, puis tous en gardant en l’ancienne version par défaut, puis la nouvelle par défaut puis suppression de l’ancienne. Et donc à chaque étape, j’ai pu établir un top 10 des irritants qui ont été résolus au fur et à mesure des cycles.
- Paradoxalement, je pense aussi que le questionnaire a servi de « pot de miel » pour les utilisateurs les plus réfractaires au changement évitant ainsi au support de recevoir quelques demandes véhémentes pas forcément liées aux interfaces d’ailleurs.
- Une fois la nouvelle version du tableau de bord en place, j’ai remesuré l’expérience utilisateur toujours avec le MeCue, avec une progression des résultats, ouf !
Donc là encore, on est dans une logique de cycles courts, 3 semaines, avec de la conception, de la mesure, de l’implication des utilisateurs avec l’idée qu’on ne va pas tout changer d’un coup, mais que l’on améliore de manière incrémentale.
La méthode des petits pas
Si je résume, l’idée est de réfléchir à une stratégie sur des cycles simples avec un début et un objectif clair en impliquant d’une manière ou d’un autre les utilisateurs. Ça permet de construire les briques une par une et de construire comme ça un projet à la fois solide, mais aussi agile. Rien n’empêche de faire évoluer les briques au cours du projet si les premiers résultats montrent des directions différentes à celle initialement envisagée.
Encore récemment, je travaillais sur un projet numérique pour promouvoir l’éducation artistique et culturelle (EAC). L’idée première était de faire un « le bon coin de l’EAC » afin de mettre en relation les différents acteurs. Le premier cycle d’entretien a mis en évidence que la solution numérique ne convenait pas. Donc pour la suite, j’ai réorienté le projet vers du design de service et comment créer une « communauté de l’EAC » ?
Ça rejoint aussi la méthode FOCUSED proposée par Tristan Charvillat et Rémi Guyot qui se base 7 cycles avec pour chacun un livrable à la fin. On est dans cette logique de faire bien, de dimensionner ce qu’on fait en fonction des moyens disponibles et de ne pas essayer d’en faire trop sur certaines étapes.
Équivalence salaire du numérique versus TJM 21 May 2024 1:35 PM (last year)
Dans la famille, je fixe mon TJM, je propose une comparaison entre salaire et TJM avec toutes les précautions et pincettes qu’on peut prendre pour cela.
La méthode :
- Je suis parti du référentiel publié par l’état sur les métiers du numérique. Ce référentiel donne la rémunération brute pour 55 métiers avec des fourchettes pour chaque niveau d’expériences. Je suppose que « rémunération brute » signifie « salaire brut » et non rémunération charges patronales comprises (Je n’ai pas trouvé d’élément disant le contraire)
- De là je calcule le salaire net annuel avant impôt soit : rémunération brute x 0,79
- Je transforme le salaire net annuel en TJM avec la formule suivante : TJM = Salaire net annuel x 1,7 (charges et cotisations) /120 (jours facturés dans l’année) L’explication est dans l’article sur les TJM
Le tableau faisant la synthèse de ces calculs est dispo sur googledocs.
Petit extrait du tableau
|
Tarif Journalier Moyen |
||||||||
| Si Exp < 5 ans | Si Exp < 10 ans | Si Exp > 10 ans | Si Exp>20 ans | |||||
| Poste | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Technicien(ne) support utilisateurs |
361 € | 468 € | 410 € | 529 € | 524 € | 677 € | 524 € | 849 € |
| Data analyst | 505 € | 652 € | 609 € | 788 € | 685 € | 886 € | 685 € | 1 071 € |
| Développeur(euse) | 495 € | 640 € | 590 € | 763 € | 704 € | 911 € | 704 € | 1 059 € |
| Intégrateur(trice) | 505 € | 652 € | 628 € | 813 € | 685 € | 886 € | 685 € | 936 € |
| Designer | 514 € | 665 € | 619 € | 800 € | 714 € | 923 € | 714 € | 1 145 € |
| Chef de produit | 571 € | 739 € | 657 € | 849 € | 818 € | 1 059 € | 818 € | 1 416 € |
| Scrum master | 533 € | 689 € | 628 € | 813 € | 780 € | 1 009 € | 780 € | 1 157 € |
| Coach Agile | 704 € | 911 € | 875 € | 1 133 € | 961 € | 1 243 € | 961 € | 1 367 € |
Un canvas pour devenir freelance 27 Mar 2024 7:02 AM (last year)
L’année dernière, j’ai donné un atelier à Parisweb, sur la thématique « Faire les bons choix pour devenir freelance » et donc comme support de cet atelier j’avais fait un petit canvas et des cartes pense-bête avec les points clefs à prendre en compte.
Les versions PDF :
Pour comprendre comment s’en servir vous pouvez relire les articles récents sur le freelancing :
La présentation du déroulé de l’atelier :
Les livrables de la méthode F.O.C.U.S.E.D 7 Dec 2023 5:12 AM (last year)
Bon, dans le cadre d’un atelier, j’ai testé la méthode FOCUSED proposé par Tristan Charvillat et Rémi Guyot dans Discovery Discipline: La méthode radicale pour exceller en Product Discovery Sauf que je n’ai juste pas trouvé en ligne les livrables. Il y a un notion avec ces livrables mais pas de version imprimable. Donc j’ai pris un petit moment pour les faire et les partager.
Petite réflexion sur les conférences 6 Dec 2023 12:18 PM (last year)
Ces derniers temps, plusieurs conférences que j’avais appréciées, ont partagé leurs difficultés et les solutions qu’elles ont mises en place. Il faut dire que la période du Covid a été un gros jeu de massacre dans le monde des conférences liées au numérique. Quelques exemples :
- Parisweb : Après des années difficiles, avec moins de participants que lors des années fastes, le format a été revu pour passer sur une conférence mono-cession dans un lieu central à Paris. Le prix a été revu à la hausse. Au final, une belle série de présentation et évènement qui retrouve un deuxième souffle.
- Mix-IT : Pas de gros changements sur le format et les thématiques de la conférence, mais un changement de lieu et une réduction du nombre de participants attendus. Résultat, une belle conférence à taille humaine.
Ces jours-ci, deux poids lourds ont publié des annonces dans directions très opposées :
- Blendwebmix : Ils ont lancé un crowndfunding (qui ne marche pas) pour éponger leurs dettes après une série de gros loupés pendant la période Covid (annulation, report, édition réduite,…) sur une conférence qui s’essoufflait déjà avant le Covid. [Màj, Mars 2024 ] Le site ne répond plus, l’hébergement n’a pas été payé vraisemblablement.
- Web2day : A priori aussi des soucis d’équilibre financier. Mais là, ce qui envisagé c’est de changer le format et la thématique pour aller vers « Un festival éphémère à taille (un peu plus) humaine, un temps suspendu où imaginaire positif et pragmatisme se rejoignent pour façonner un futur soutenable. » Ça me paraît plus constructif comme démarche.
J’ai bien l’impression, que, à l’exception des conférences techs purs, les conférences doivent se repenser afin de mieux répondre aux enjeux de notre société.
Pour compléter sur le sujet :
- Sudweb a tenté de se relancer et a du abandonner.
- Interaction 2024 (La grosse conférence internationale sur le design d’interaction) par IxDA qui devait avoir lieu à Sydney a été annulé. Là, c’est un peu prévisible, avec un public nord américain et européen, personne va 24h d’avion pour aller à une conférence.
- Les grosses conférences orientées sur un métier (Devs ou UX par exemple), ou sur une thématique technique ne rencontre pas de problèmes, … , pour l’instant ? J’étais à BDX/IO et c’était complet. Pareil pour les UXdays à ma connaissance.
L’UX Design en 2023, son marché et ses tendances. 6 Sep 2023 12:10 PM (2 years ago)
À intervalle régulier, environ tous les 4 ans, je vous propose de faire un point sur le marché de l’UX design. L’idée étant d’avoir un panorama du secteur et de voir les tendances et les évolutions qui émergent.
Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez retrouver les saisons précédentes :
- Le marché de l’ergonomie en 2008 (résumé d’un mémoire de fin d’études)
- Le marché de l’UX en 2012
- Le marché de l’UX en 2016
- Le marché de l’UX en 2020
- De l’avenir de l’expérience utilisateur en 2019
Crises
Je vais commencer par les choses qui fâchent et donc parlons Covid et ralentissement économique.
Covid
Il se trouve qu’entre début 2020 et maintenant il y a eu une crise sanitaire qui n’a pas été sans conséquences sur l’économie, les entreprises et les personnes et donc sur le secteur du design.
Cette crise a eu un impact sur les personnes travaillant dans le secteur informatique. Elles ont pris conscience que leur cadre de vie était très contraignant quand ce genre de situation se présentait et qu’il était parfaitement possible de télétravailler.
Il y a eu donc très clairement des départs de la région parisienne vers les grandes agglomérations comme Lyon, Nantes, Bordeaux et de ces agglomérations vers la campagne ou le bord de mer, que ce soit le Pays basque ou la Bretagne. Clairement, le covid a fait plus pour le télétravail que toutes les tentatives précédentes.
C’est bien beau, mais ça qu’est-ce que ça a voir avec le design ? Et bien je ne sais pas vous, mais de mon côté ça a fait évoluer certaines de mes pratiques. Là où les tests utilisateurs en présentiel étaient la norme, et bien les tests à distance sont maintenant majoritaires, car tout le monde ou presque est équipé pour faire de la visioconférence. À un autre niveau, il y a une prise de conscience des changements au niveau climatique et éthique et donc une proportion non négligeable de designers ont décidé de quitter des entreprises toxiques pour s’orienter vers des projets en accord avec leurs valeurs.
Les entreprises ont du aussi s’adapter et réorganiser leur fonctionnement, pour certaines passer en télétravail complet, d’autres trouver des modes hybrides et surtout changer les modes de management. Pour le recrutement, présentiel ou télétravail est devenu un critère clef des offres d’emploi.
Du côté des agences et même des freelances, les structures ont certes senti les effets de cette crise. En 2020, les entreprises avaient commencé à intégrer les designers dans leurs services, limitant la sous-traitance. Le ralentissement de l’activité a fini d’achever le travail d’intégration. Mais globalement le secteur n’a trop souffert de cette crise au pire la croissance c’est ralenti et les cartes ont été un peu rebattu.
Ralentissement du marché en 2022 – 2023
Par contre, de manière un peu plus préoccupante, le marché global des prestations informatiques, c’est contracté en 2022 et 2023. Je ne suis pas économiste et donc j’aurai du mal à en expliquer les causes profondes, mais le fait est que plusieurs agences de design ou des designers travaillant dans des grands groupes m’ont fait le même retour sur un marché se contractant avec globalement moins de missions. Sans doute plusieurs facteurs rentrent en compte, si on regarde du côté des États-Unis :
La guerre en Ukraine, les problèmes de logistique et tout particulièrement d’approvisionnement, ainsi que la pandémie de covid-19 qui impacte toujours fortement plusieurs pays et de fait, les marchés, sont autant de facteurs qui se répercutent sur les marchés publics et privés. S’ensuivent des inquiétudes liées à l’inflation, la hausse des taux d’intérêt qui ont contribué à un marché boursier en dents de scie.
Le monde informatique et aussi des prévisions
À voir comment ça va évoluer dans les mois à venir, mais la période risque d’être chaotique encore quelque temps. Oui, je ne m’avance pas trop en disant ça.
Les 5 tendances de l’UX, la 7e vous étonnera
Après ces bonnes nouvelles, revenons au design. Qu’est-ce qui s’est passé depuis trois ans ? C’est quoi le nouveau le titre qu’il faut afficher sur son profil LinkedIn pour remplacer celui d’ergonome IHM ? Je vous divulgâche la réponse tout de suite, c’est « Product designer ».
Les tendances qui ont émergé sont pour moi dans l’ordre d’importance ou d’apparition :
- Le product design
- L’UX writing
- L’écoconception et référentiel
- Le design management
Le product design
Le product design, c’est clairement la tendance majeure de ces 3 dernières années. Cela se concrétise sur plusieurs axes différents, dans les titres des designers et les offres d’emplois, dans les formations disponibles et dans le développement d’une organisation orientée « Product design » au sein des entreprises.
Un exemple assez flagrant, sur ce dernier point, est expliqué par Thomas Vidal dans sa conférence aux UXDays, « Retour d’expérience de Thomas VIDAL : passer de 20 à 120 designers en un an » chez Décathlon. Ce qui est intéressant de voir c’est l’ampleur de la transition, le nombre de personnes recrutées ainsi que la méthode. Là, une agence de conseil externe a collaboré activement à amplifier la culture du design en plaçant des gens aux postes clefs. Ces personnes ont évangélisé, organisé, structuré les équipes. Puis ils ont accompagné la montée en puissance en participant au recrutement de nouveaux designers dont des leads designers qui viendront les remplacer à terme.
Plusieurs scale-up (Start-up devenue des entreprises) comme Payfit, Qonto, Alan, BlaBlaCar ont aussi clairement suivi ce chemin en construisant des équipes « énormes » orientées vers la production d’un produit ou service numérique afin d’améliorer l’expérience client. C’est dans la ligné du design ops qui est émergeait en 2018, afin de permettre de faire du design en production.
On retrouve sur ce créneau, le livre de Tristan Charvillat et Rémi Guyot (qui est passé chez Thiga) « Discovery discipline » , mais aussi des organismes de formation comme The design crew. L’école Hetic, pour laquelle j’interviens régulièrement, a créé un mastère Product manager qui connait un franc succès.
Ce qui est important de comprendre derrière cela, c’est l’ampleur du mouvement et la taille des équipes design constituées au sein de ces entreprises. Là on ne parle plus de 3 ou 4 designers, mais plus de dizaines, voire de centaines de designers dans diverses spécialités pour des entreprises dont la taille reste « moyenne ». Décathlon ou Orange ont toujours eu des designers, des ergonomes pour travailler, mais dans une entreprise de 100 à 200 000 personnes, une centaine ça fait toujours moins de 1%, ou 1‰. Aujourd’hui, on se rapproche d’un ratio de l’ordre 4 à 10% des effectifs, avec un designer pour 4 à 5 développeurs. Ce n’est plus du tout la même échelle.
L’UX Writing
Bon alors ce n’est pas une révolution, ça existait avant, mais ça été mis au gout du jour. Avant, ça s’appelait de la rédaction web, maintenant c’est en anglais et c’est beaucoup plus clair « UX Writing » et complètement différent. Enfin, non. Il faut repositionner dans le contexte actuel. Vu que le nombre de designers et designeuses a fortement augmenté dans les entreprises, une certaine spécialisation s’est développée avec une segmentation des tâches. C’était déjà le cas dans les grosses agences, ou même dans des entreprises comme Orange il y a dix ou vingt ans, mais la tendance se généralise. Maintenant, l’UX Writing fait sa place dans les scale-up comme Qonto et les start-up.
Donc on voit revenir en force des personnes chargées de donner le ton, de s’adresser aux utilisateurs, de rédiger les contenus, souvent en lien avec l’identité de la marque.
Il faut voir que les parcours des personnes faisant l’UX writing sont assez différents des designers. Si les designers sont issus du graphisme, de l’ergonomie ou du design, dans l’UX writing, on rencontre surtout des profils issus de métiers comme le juridique ou le journalisme ayant l’habitude de rédiger avec un certain formalisme.
Ce renouveau donne aussi lieu à de nombreux podcasts comme User Story ou Design journey sur le sujet ainsi que des livres.
L’écoconception
L’écoconception est un sujet émergeant depuis au moins 3 ans. Dans le cadre de beta.gouv.fr, j’avais participé à l’organisation d’une journée sur cette thématique avec le bon coin, l’agence Lunaweb et les designers éthiques en avril 2022. Cette année, le Référentiel général d’écoconception de services numériques (RGESN) a été publié.
Bien sûr, dans ce référentiel, on retrouve les préoccupations environnementales et la nécessité de revenir à des choses plus épurées, plus sobres en termes de conception et de développement. Le toujours plus de fonctionnalités, le toujours plus de dépendances à des technos a atteints ses limites. En 2019, j’avais participé à une conférence orientée développement et un des orateurs faisait la démonstration de comment créer son CV avec un stack technique énorme derrière. Il y avait de centaines de mégaoctets de librairies pour afficher une simple page HTML/CSS. Ça soulève aussi la question de la dépendance à ces librairies et ces outils qu’il faut sans cesse mettre à jour afin de ne pas présenter de vulnérabilités, sachant que certaines sont maintenues par une personne depuis des décennies. Tout cela a un coût aussi bien financier, qu’humain ou environnementale.
Donc aujourd’hui, les appels d’offres des marchés publics comportent ce volet écoconception. Des sites ou des CMS sont développés afin de répondre à cette demande, avec une démarche centrée utilisateurs pour épurer avant de développer. Quelques exemples sont visibles :
– Grenoble métropole
– Mairie de Ciboure
Au-delà de ces sites, la démarche d’écoconception se retrouve de plus en plus dans le design avec des thématiques connexes comme le design systémique ou design des communs.
Le design management
Augmentation de la taille des services de design, multiplication des entreprises embauchant des designers, recrutement, multiplication des rôles et des spécialisations, prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux… Naturellement, ça débouche sur un besoin d’organisation de tout ce petit monde.
En 2018, on parlait de design ops, de discovery & delivery, un peu de stratégie UX. La maturité des entreprises continuant a progresser aujourd’hui, on passe un cap avec un vrai besoin d’expertise pour accompagner la structuration des services de design. On en revient à la vidéo de Thomas chez Décathlon, mais c’est aussi le travail qui a été fait par l’équipe des designers transverses chez beta.gouv.fr.
Des formations sur cette thématique, chez The design crew ou au laptop émergent ainsi qu’un besoin d’accompagnement soit sous la forme de coaching soit sous la forme d’un accompagnement des équipes en interne.
Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent notamment sur le nombre de tendances.
Les agences qui émergent
Avant de parler d’agences, je pense qu’il faut se pencher sur un phénomène émergeant dans le design, mais aussi globalement dans le monde du numérique et je pense que ce courant a été renforcé par la crise du covid et un besoin de sortir du salariat classique. Je parle donc des collectifs et des coopératives.
Je vois émerger donc de plus en plus de designers qui s’organisent en collectifs, soit en étant en freelance, soit en créant des coopératives (ou toute autre forme juridique égalitaire). Le salariat, l’organisation classique des entreprises et leurs valeurs consuméristes ne correspondent plus aux valeurs de ces designers qui ont donc décidé de prendre leur travail en main et de faire évoluer la relation à celui-ci. Si travailler en freelance peut être une première étape, l’envie de travailler en collectif sur des projets ou de partager des connaissances les pousse souvent à vouloir se regrouper.
On peut noter l’existence de coopérative comme Praticable, Où sont les dragons ou Telescoop , des agences comme Liip. Toutes ces structures ont évoluées positivement ces dernières années, sans forcément grossir, mais en privilégiant leurs valeurs et la qualité.
Les agences
L’évolution au niveau du marché est sans doute assez clivante. Auparavant, il y avait une diversité de tailles dans les agences avec une certaine continuité. De 2015 à 2020, les agences moyennes à grosses, Fjord, Axance, Nealite se sont fait racheter par de grands groupes comme Accenture, Devoteam, PWC ou Cap Gemini. Plus récemment UXRepublic a rejoint le groupe Smile. Donc, là on se retrouve aujourd’hui avec un secteur bipolaire : d’un côté des petites agences de moins de 10 ou 15 employés et de l’autre des grandes agences de plus de 100 personnes affiliées à des grands groupes.
Les petites agences sont positionnées sur des secteurs spécialisés et essayent de conserver leurs valeurs et leurs proximités pour se démarquer des poids lourds qui fournissent la chair à canon aux grands groupes.
Mais, je vais vous donner plusieurs exemples histoire d’illustrer.
Une première agence qui se démarque dans le monde du design. C’est Vraiment, Vraiment une agence spécialisée dans le « design d’intérêt général » composé d’une quarantaine de personnes. Cette agence travaille avec les services publics au sens large avec une expertise reconnue et un certain savoir-faire pour répondre aux appels d’offres. Au-delà des missions réalisées, Vraiment, Vraiment communique sur leurs actions, sur le design et les personnes sous la forme d’un blog et d’un podcast. On retrouve là deux aspects importants : un secteur précis de design en accord avec leurs valeurs et un partage sur ses sujets. On note au passage la multiplication des podcasts.
Bien sûr je vais évoquer le cas Thiga vu que je l’ai cité déjà deux fois. C’est une société de conseil, avec 200 à 300 salariés qui mettent en place des équipes produits en conseillant, en plaçant du monde en renfort et en formant. Ils proposent aussi de nombreuses ressources et livres autour des thématiques produits. C’est aussi eux qui organisent la product conf chaque année. Ce qui est intéressant ce qu’il y a 4 ans, ils n’étaient pas du tout visibles sur le secteur du design, là où ils sont en passe de prendre le lead sur le marché du product design.
On remarque aussi une agence comme l’agence Lunaweb qui est composée d’une équipe d’une quinzaine de personnes sur Rennes. Cette agence existe depuis longtemps, mais a gardé une taille familiale et est bien implantée dans le tissu local. Elle a attaqué la problématique de l’écoconception un peu « sur un malentendu » et c’est maintenant devenu un de ses axes de développement.
À côté de ça, on observe de très petites agences ou collectifs qu’il est difficile de dénicher, car ils communiquent peu ou ont suffisamment de revenus par rapport à leurs choix et à leurs organisations :
- Le collectif co : 3 femmes qui ont décidées de travailler ensemble afin de s’orienter vers le conseil et la transmission, sur des projets de grandes envergures dans le temps.
- Pigwii : Alice, Clément et Raphaël, on fait leurs études ensemble à Bordeaux avant de décider de travailler ensemble au Pays basque. Ils ont fait le choix de ne pas grandir et préfèrent travailler avec des partenaires locaux.
On note aussi, le grand classique, toutes les agences rachetées qui avaient gardé un temps leur identité, ont joyeusement disparu, fondu dans la masse des acquéreurs. Adieu, Fjord, Axances, etc.
Les outils
Autres secteurs du marché de l’UX design qui a pris son envole, c’est celui du marché des outils à destination des designers. Il y avait historiquement quelques outils comme optimalworkshop ou lookback.
Aujourd’hui, il y a une vraie explosion des outils spécialisés. On peut citer :
- Maze un outil généraliste pour faire différents types de tests à distance.
- Condens ou Dovetail pour organiser et analyser votre recherche utilisateur.
- Tandemz qui facilite le recrutement des utilisateurs.
Mais cette petite liste est loin d’être exhaustive, de challengers arrivent pour attaquer des marchés tenus par de gros acteurs. Figma a été racheté par Adobe, mais Sketch existe toujours et Penpot essaye de se démarquer du lot.
Lookback a dû proposer d’autres services que simplement l’enregistrement d’entretien vidéo, ce que fait très bien zoom. Il a dû renforcer les outils d’analyse en intégrant une reconnaissance vocale ou le découpage de la vidéo, etc.
L’aire de la maturité
Quand un secteur fini de se concentrer et que les gros ont fini de manger les petits, c’est général que le secteur arrive à un certain stade de stabilisation. La période de croissance exponentielle est passée. Le marché va atteindre un stade de « vache à lait » où chaque acteur essaye de tirer profit de sa position et de faire en sorte qu’elle ne se dégrade pas trop.
Aujourd’hui, on observe des clients matures en termes de design, qui font des demandes déjà qualifiées et éclairées. L’air du coloriage ou de la couleur de la moquette sont dernière nous pour l’essentiel. Alors pour tirer son épingle du jeu, il faut donc se spécialiser ou ouvrir de nouveaux marchés collatéraux.
Illectronisme et numérisation des services publics 9 Oct 2022 6:30 AM (3 years ago)
Vous trouverez ci-dessous ma présentation pour Paris-web concernant l’illectronisme et la numérisation des services publics.
La vidéo du live Paris-web (à 14h) en attendant les vidéos découpées.
Le fichier PDF de la présentation illectronisme et numérisation des services publics.
La transcription de la présentation :
- Bonjour, je vais vous parler d’Illectronisme et de numérisation des services publics.
- Je suis Raphaël Yharrassarry et je suis UX designer en freelance depuis le dernier millénaire. Et depuis le 1er jour du 1er confinement j’ai travaillé comme designer transverse au sein de beta.gouv donc sur des projets de numérisation de services publics
- Une petite définition pour commencer : Difficulté que rencontre une personne à utiliser les outils ou les services numériques soit par une connaissance insuffisante de leur fonctionnement, soit parce qu’ils n’ont pas accès à ces services ou à ces outils. Elle est une conséquence indirecte du fossé numérique et est souvent source d’exclusion et d’isolement.
En Québécois on parle d’inhabileté numérique, ce qui a l’avantage d’être plus facile à prononcer. - Un exemple, que j’ai rencontré, pour la location d’une chambre au CROUS, on doit remplir un dossier et renvoyer tous les documents : contrat, caution, pièce d’identité, RIB, etc.… dans un seul document de moins 2 Mo. Bizarrement quand on est allé chercher les clefs, la personne du CROUS à préciser « à pour une fois, vous, votre dossier est complet, c’est bon ».
C’est complet parce que j’ai le matériel informatique pour scanner, les compétences en informatique pour faire un PDF léger et les compétences « remplissage de dossiers administratifs » - Donc on voit émerger trois problématiques différentes :
- Est-ce que la personne est suffisamment outillée ?
- Est-ce qu’elle a les compétences pour utiliser ces outils ?
- Et dans le cas qui nous intéresse, est ce que l’administration à demander clairement les choses et donne les moyens à la personne pour y répondre.
- Dans ce dernier cas, vous remarquer que la problématique doit être portée par l’administration et non par le citoyen. Pour vous donner une idée de l’ampleur du problème, je vous propose un petit quiz.
- Petit quiz rapide avec quelques chiffres.
- Oui quelques chiffres :
Alors- 8 % des Français n’ont pas d’e-mail
- 9 % n’ont aucun équipement pour accéder à internet
- 10 % n’ont pas d’imprimantes (donc sans doute pas de scanner)
- 15 % n’ont pas d’internet à domicile
- Un peu de rab…
- 17 % de la population utilisent des smartphones d’occasion
- 22 % pas d’ordinateur et de tablette à la maison
- 84 % des 12 ans équipés d’un smartphone, donc 16 % sont équipés d’un simple téléphone.
- Alors la question qui vient, c’est comment contourner ces problèmes techniques ? Comment ne pas créer pour les utilisateurs ? Un exemple :
- Un service de beta.gouv permet au bénéficiaire de prendre rendez-vous sur des créneaux disponibles, à la doctolib. Pour contacter les bénéficiaires on utilise le SMS, ce qui permet de joindre tout le monde et de là on redirige vers le site de prise de rendez-vous et on permet de téléphoner au secrétariat. C’est au bénéficiaire de choisir le mode de contact qui lui convient le mieux. Au passage, le message envoyé est neutre et non condescendant contrairement aux habitudes dans l’administration…
Par rapport à un courrier avec un horaire fixé à l’avance, ça permet d’avoir 4 fois moins de lapin et plus d’autonomie pour les bénéficiaires.
Donc on emploie un moyen qui touche tout le monde, et on laisse le choix du canal pour la réponse. - Un deuxième petit quiz pour les compétences numériques
- Alors quel est le pourcentage de Français qui rencontrent des difficultés avec le numérique ? 8 %, 13,7 %, 18 % ou 35 % ?
- la réponse D, non, … regardons les scores ? les mayos, c’est pas ça…
- La bonne réponse est 18 % des Français.
- Au total, on a donc 35 % des Français qui éprouvent une ou plusieurs formes de difficulté qui les empêche d’utiliser le numérique.
- Il faut bien comprendre que ce n’est pas noir ou blanc. Ce n’est pas binaire, ça va de ne maîtrise pas du tout à maîtrise parfaitement avec toutes les nuances possibles. Et il y a bien sur certaines catégories sociales ou certaines classes d’âge qui rencontrent plus de difficultés que d’autres. Bien sûr l’âge, mais aussi un niveau d’éducation faible ou encore la ruralité sont des facteurs aggravant…
- Le numérique porte en lui-même le problème du tout écrit qui est une barrière pour bien des personnes.
- Donc l’illettrisme va de pair avec l’illectronisme, les deux sont liées.
- L’illettrisme concerne donc 7 à 16 % des personnes suivant le niveau de lecture. Et surtout ça touche 100 % des usagers ne parlant pas français ! Vous savez tous les gens qui viennent travailler de l’étranger.
- Un cas concret, je travaille sur un service qui numérise les bordereaux de suivi des déchets dangereux. Vous voyez avec chaque container de déchets, là ce sont des déchets médicaux infectieux, il y a un bordereau papier qui suivait chaque container, du début à la fin et une fois arrivé à la fin, le bordereau retourne au début au producteur. Aujourd’hui, c’est tout numérisé. ET il est obligatoire d’utiliser le service par décret ! Ça, c’est le truc magique qu’en vous travailler pour l’état, vos utilisateurs sont captifs… Par contre il y a un point faible dans la chaîne, le transport avec des chauffeurs habitués au papier, ça souplesse qui permet de se tromper et de corriger, de tricher. Les zones blanches, quand vous allez chercher des déchets au fond de la montagne. La sous-traitance dans les pays de l’Est avec des chauffeurs qui ne parlent pas français, ni anglais… il ne faut pas se voiler la face, sur les conditions de travail…
- Comment on fait avec ça ?
- On prévoit une app destinée aux chauffeurs, centré juste sur leurs usages, la collecte et le transport des déchets. À terme traduire l’app…
- Certaines procédures ont été assouplies pour permettre par exemple de signer dans un ordre différent de celui prévu initialement ou encore en amont de l’enlèvement…
- De fait on observe sur le terrain l’exclusion des sous-traitants qui jouaient un peu trop avec la souplesse du papier, au profit de ceux qui respectent la législation.
- Troisième compétence, l’administratif, oui c’est une compétence à part entière
- Déjà petit rappel ne pas confondre « Phobie administrative » et illectronisme, la phobie administrative ne touche que les élus et les ministres. Si vous n’êtes ni l’un ni l’autre, vous êtes justes considéré comme un fraudeur.
- Donc oui, remplir des formulaires administratifs est une compétence à part entière qui n’est pas donnée à tout le monde. Les jeunes qui découvrent les joies de l’administration ainsi que les plus anciens sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés.
- Certaines situations compliquent aussi l’accès aux services publics, le handicap et l’accessibilité bien sûr.
- Mais par exemple en prison il n’y a pas d’accès internet du tout, alors qu’il devrait possible de réaliser certaines démarches.
- Chez les plus précaire, le coût est un souci…
- Et simplement l’école, je ne sais pas vous, mais tous les devoirs de mes enfants sont maintenant donnés en lignes, donc si je veux leur laisser un peu d’autonomie, il faut une tablette ou un ordi par enfants… On a eu le même problème pendant les confinements, vous faites comment pour assurer la connexion d’une ou deux personnes en télétravail, deux enfants en visio sur une ligne ADSL ?
- Derrière cette numérisation à marche forcée des services publics, il y a le fantasme, la volonté d’avoir un citoyen modèle qu’on va éduquer, former mouler pour s’adapter à une administration digitale. La conséquence directe de ça c’est une perte d’autonomie, un déclassement social, là où vous pouviez remplir un papier, raturé, corriger, prendre votre temps et le renvoyer à l’administration, vous êtes coincés devant un écran à devoir donner une réponse immédiate…
- Alors l’état dans sa grande mansuétude, à inventer les maisons France service. L’idée c’est d’avoir un lieu qui regroupe les services publics, ou plus précisément un lieu qui donne un accès à internet où vous pouvez accéder aux services publics, avec une personne qui peut vous aider à utiliser les outils informatiques.
- Alors petit exercice, dégainer vos téléphones portables, et trouvez-moi la maison France service la plus proche de Mendionde, charmant petit village du Pays basque au pied de l’Ursuïa.
- Oui, il faut chercher sur internet pour trouver une Maison France service et espérer les trouver… les horaires ? hou,là…
- Alors normalement, vous trouvez une maison France à 30 minutes de chez vous en voiture, oui en voiture, donc si vous êtes sans voiture, bobo-écolo en vélo, ou juste peu mobile… c’est compliqué…
- Vous avez trouvé ? Il y a 4 Maisons France service dans le périmètre des 30 minutes, toute à 30 minutes de routes (voir 45 minutes en réalité). Le plus simple en termes de route étant probablement d’aller à Bayonne.
- Et si vous n’avez pas de voiture, vous pouvez tenter en transport en commun, je vous ai mis les lignes. Il faut commencer par 2 à 3 km de marche pour atteindre l’arrêt. Là encore, si vous regardez la fréquence des bus le plus simple c’est d’aller à Bayonne.
- Donc l’idée principale à retenir c’est qu’un tiers des citoyens se retrouve en difficulté face à l’administration numérique, avec un certain nombre de nuances, de niveau de difficultés, de contexte, facteurs aggravants…
- On est bien là ! c’est bien beau mais comment on fait maintenant ?
- Oui, on améliore l’accessibilité… oui bon… mais le constat n’est pas très favorable. Il y a de quoi faire une conférence sur deux jours sur le sujet.
- Une deuxième piste, qui n’est pas incompatible avec la première, c’est l’éco-conception : C’est-à-dire qu’il faut concevoir dans une optique de sobriété. Des pages plus légères, des services centrés sur l’essentiel, sans fioriture. Ça sollicite moins le réseau, ça permet d’être utilisé sur des vieux terminaux, des vieux ordinateurs,… ce qui correspond justement au public qui nous intéresse.
- Par contre on évite, encre plus d’internet et de l’internet de geek… « j’ai un problème avec votre service » « oui, il faut faire une issue sur github pour qu’on regarde » Nan, jamais, …
- Quelques règles simples : laisser le choix à l’usager dans son mode de relation et même si le numérique est privilégié, il faut pouvoir débrailler sur un autre mode en cas de problème ou si le cas n’est simplement pas prévu.
Enfin il faut aller vers, le non-recours au RSA et aux autres aides c’est énorme 30 % - Alors quelques exemples d’aller vers : vos cibles, vos utilisateurs, vos bénéficiaires sont à un endroit précis, aller à leur rencontre que ça soit les réseaux sociaux ou les organisations professionnelles.
- Traduire : déjà du français administratif vers le français normal, déjà. Vers l’anglais, ou vers la langue de votre publique.
- Tester, tester, tester, avec Tous vos bénéficiaires ! Le principal risque que vous avez c’est un biais de recrutement. Un biais de recrutement « c’est demander aux personnes qui ont réussi à utiliser un service, si le service est facile à utiliser ».
Alors il faut recruter ces personnes, Aller vers ces bénéficiaires, ça prend du temps, il faut s’appuyer sur des relais comme les associations et les mairies, c’est compliqué, c’est long. Donc il faut le prévoir longtemps à l’avance, sortir des bureaux parisiens, passer le périphérique ! - En conclusion je vous rappelle les trois points clefs :
- Un tiers des citoyens en difficulté
- Accessibilité et éco-conception sont vos amis
- Aller vers vos bénéficiaires
- Merci
- Sources.
Bibliographie :
- Dématérialisation des services publics : trois ans après,
où en est-on ? Défenseur des droits - Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics. Défenseur des droits
- Entre illettrisme et illectronisme. Les nouveaux publics à faible autonomie administrative. Nadia Kesteman, Revue des politiques sociales et familiales
- Un habitant sur cinq démuni face à l’usage d’internet, INSEE
- BAROMÈTRE DU NUMÉRIQUE, Crédoc
Tu veux te lancer en freelance ? 27 Aug 2022 2:13 PM (3 years ago)
Bon, c’est la rentrée et tu veux te lancer en #freelance ? Que ça soit comme dev, designer, tueur à gage ou coach agile, il va falloir que tu fasses plusieurs choses, notamment choisir un statut et FIXER UN TJM.
Premier rappel : La relation que tu vas avoir avec tes clients est régie par le droit du commerce (c’est une vente entre 2 personnes) et non par le droit du travail. Tu dois donc avoir une relation équilibré avec ton client : argent contre prestation sans lien de subordination. Autant le droit du travail est protecteur pour les salariés, autant le droit du commerce laisse une grande marge manœuvre, même si c’est pas non plus la fête du slip. Par exemple, il y a contrat dès que les 2 parties sont d’accord sur les termes de celui-ci. La conséquence c’est qu’il faut écrire certaines choses pour se protéger. « Cette proposition est valable un mois » pour éviter le client qui revient 1 an après en disant « Ok » sauf que tu n’as plus le temps pour lui et que tes conditions tarifaires ont évoluées. Et il faut des ÉCRITS ! Un échange de mails peut suffire avec des clients honnêtes et réguliers, mais il est préférable d’avoir une proposition commerciale signée par le client (et double tamponné (non, le tampon n’a pas de valeur légale)) et de demander 30 à 50% à la commande. Tu ne bosses pas tant que tu n’as pas le bon de commande signé (et les 30% sur ton comptes). Les ex-futur-clients qui ne respectent pas ces règles ne doivent pas devenir tes clients. Ils ne te payeront pas. Oui, c’est pas plus compliqué que ça.
Bon, mais avant ça il faut déjà créer une entreprise et FIXER UN TJM. TJM : Tarif Jour Moyen, le prix que tu vas demander à tes clients pour une journée FACTURÉE. Attention, petit piège, il y a une différence entre jours facturés et jours travaillés (30% en +).Pour les statuts, il y a en gros le choix entre :
- Auto-entrepreneur (max 72 000€ de CA)
- EI (fusionné avec EIRL) Entreprise Individuel
- SASU (nécessite un comptable)
- Rejoindre une CAE : Coopérative qui te salarie.
- MDA, Agessa : pour les artistes, auteurs
Pour les créatifs, il faut lire http://www.creatif-freelance.com de @JulienMoya Sinon je dirai : – Si tu veux te la jouer perso commence en auto-entrepreneur, puis passe en EI quand tu va faire plus 72 000€ de CA. – Si tu veux la jouer collectif, regardes du coté des CAEs. Mais pour se décider, il faut prendre en compte les charges, les cotisations sociales et les impots que tu vas avoir à payer. C’est ce qui va conditionner ton TJM.
- Pour cela je t’invites à lire cet article : Bien comprendre le TJM d’un Freelance
- Je te conseille aussi lire et de regarder cet article : Parce que vous le valez bien
- Tu as ton entreprise, tu as fixé ton TJM, tu vas voir ton premier client, alors avant ça tu vas lire : Freelances : bien fixer, annoncer et négocier vos tarifs (guide complet)
Donc :
- C’est a toi de faire une proposition commerciale, de donner TON prix. C’est comme l’artisan qui vient chez toi, c’est lui qui fixe le prix.
- N’ouvre pas la négociation.
- Si tu acceptes de négocier, c’est donnant/donnant, fixes les limites et ce que tu veux.
Les pièges grossiers de la négo :
- On a quelqu’un 2 fois moins chère (bah embauche le)
- Si tu fais un prix, on pourra travailler longtemps ensemble (et t’exploiter comme un esclave)
- Nous, notre prix c’est xxx € pour tout le monde. (bah pas moi, bisous)
Pour donner une idée du TJM :
- À moins de 300 € (HT/jour toujours), tu vas être aussi mal considéré et payé qu’un professeur des écoles débutants sans la sécurité de l’emploi.
- En dessous de 400/450 € tu es sous-payé, tu vas avoir un boulot d’exécution sans intérêt.
- À 600 €, ça commence à être viable.
Tu peux aussi négocier une prestation au forfait : « Je vous fais tel site, telle prestation pour tel prix. » sans préciser le nombre de jours, mais globalement tu vas refaire le même calcule du temps passé sur le projet en prenant le risque de te tromper. À éviter quand on débute.
Pour la bande de rigolos qui va couiner sans avoir lu les articles cités au-dessus, je remet une image (et passer votre chemin, je ne vais pas être patient)
Bonne cause et rémunération 23 May 2022 12:38 AM (3 years ago)
Ha, mais c’est pour une bonne cause, ha, mais c’est pour le service public, c’est particulier, c’est normal d’être moins payé.
Ça fait une semaine que j’entends ça dans le cadre de mon boulot quand je parle de TJMs, et ça s’applique aussi dans le cadre associatif ou d’organisations à but non lucratif.
Quand on demande pourquoi ? Pourquoi je devrais être moins payé, voire mal payé, que dans le privé ? la réponse est souvent : « C’est de l’argent public (directement ou par subvention), on n’a pas le droit moral de le dépenser n’importe comment. »
Prenons la santé, la sécu à un coût de fonctionnement de 7 %, les mutuelles de l’ordre de 17% et les sociétés d’assurances de l’ordre 25%. Ça donne 3 catégories :
- Non marchand : Sécu, pas de concurrence, pas d’actionnaire, coût minimum
- Marchand : Mutuelle, concurrence, pas d’actionnaire, coût moyen
- Capitaliste : Société, concurrence et actionnaires à rémunérer, coût maximum
Dans le cadre capitaliste, si on te paye mal, c’est pour maximiser le bénéfice et donc la rémunération des actionnaires. Où alors on te paye bien avec une pression excessive, te conduisant au Burn-out. C’est logique, pas forcément éthique, mais logique.
Dans le cadre non marchand, si on te paye mal, ce n’est pas pour les bénéfices, il n’y en a pas. Pour réduire les coûts, mais le fait, d’être non marchand ou juste marchand réduit déjà les coûts.
On peut prendre la question dans l’autre sens. Pourquoi le capitalisme paye mieux ? Pourquoi je suis mieux payé à travailler dans un cabinet de conseil, une banque que pour une association ou une administration ?
- Une banque me propose de travailler sur un logiciel d’optimisation fiscale. Je vais être très bien payé et en plus ça va permettre de faire perdre de l’argent à l’état.
- Le ministère des Finances me propose de travailler sur un logiciel de contrôle de l’évasion fiscale. Je vais être payé une misère et ça va faire gagner de l’argent à l’état.
Ça ne va pas. Logiquement, si on parle de « bonne cause » ou de dépense publique, je devrais être mieux payé en travaillant pour l’état que pour le capitalisme.
On sait aussi que mal payé va de concert avec mal considéré et mal traité. Donc si cette on suit la logique jusqu’au bout : « C’est pour une bonne cause, c’est normal d’être mal payé et mal traité. »
Je ne suis pas née de la dernière pluie, et je sais bien que c’est ce qui se passe notamment avec tous les métiers du soin. Mais il serait temps d’inverser la logique :
« C’est pour une bonne cause, tu vas être payé à ta juste valeur, ça t’évitera d’aller vendre ton âme au diable »
Une citation qui rejoint ma réflexion.
« Dans le capitalisme, nous ne sommes considéré comme travailleur que lorsque nous avons une activité qui met en valeur du capital.
On est travailleur pas du tout en tant que personne, c’est notre activité qui nous définit comme travailleur. Et ce n’est que si notre activité met en valeur du capital que c’est du travail. »
Bernard Friot
Comprendre le TJM d’un freelance. 17 May 2022 6:24 AM (3 years ago)
TJM : Tarif journalier moyen ou prix à la journée
J’ai eu, encore, une discussion houleuse avec quelques personnes au sujet des TJMs des freelances et certaines idées erronées à ce sujet. Alors je vais prendre le temps d’expliquer plusieurs points et d’éclaircir les choses.
Pour donner un petit aperçu de ce que j’ai entendu comme inepties au sujet des tarifs :
- « Oui, mais à 250€/jour à 20 jours, ça fait 5000€ par mois tu gagnes bien ta vie. »
- « Tu travailles 200 jours par an (sous-entendu tu en factures autant) »
- « Attends, en autoentrepreneur, avec 22% de cotisation sociale tu gagnes plus qu’un salarié. »
- « Oui, mais si tu travailles ou plus 4 jours/semaine sur un projet c’est comme être salarié. »
- « Tu fais partie des 10% des Français les mieux rémunérés. »
En parlant d’inepties, je peux paraitre assez rude, mais ce qui se cache derrière ces propos c’est un certain mépris pour une juste rémunération du travail et des compétences de chacun et en particulier de chacune.
Aparté sur la rémunération des femmes, à chaque fois que j’ai à recruter des freelances, les femmes demandent un TJM inférieur de 20 à 30% aux hommes à compétences égales, voire supérieures. Donc s’il y a bien un point de vigilance à avoir, c’est celui-là et de ne pas hésiter a proposer un TJM supérieur aux femmes.
À retenir
Vu que l’article est un peu plus long que prévu, ce que vous avez à retenir :
- Un freelance facture entre 120 et 150 jours par an, pour 210 jours travaillés
- Les charges sont de l’ordre de 1 000 € par mois.
- Les cotisations sociales sont dépendantes du statut de 22% du CA à 45% de la marge. Il est possible de les simuler sur le site de l’URSSAF
- Un TJM inférieur à 400 € n’est pas viable sur le long terme et entraine la paupérisation du freelance.
- [Màj] TJM = Revenu x 1,7 / 120 (Revenu net avant impôt souhaité, coefficient de 1,7 : charges et cotisations, 120 : nombres de jours facturés/an)
« Ah, le printemps ! La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. »
Kaamelott, Arthur.
Pour comprendre en détail il faut lire la suite !
La problématique
Cette attitude et ces propos conduisent à la paupérisation des freelances, car ils propagent l’idée que ceux-ci seraient trop payés et qu’il faut donc baisser leurs rémunérations.
Du côté des freelances
Ces propos ne sont pas que le fait de personnes salariées, mais aussi de freelances novices qui n’ont pas encore le recul nécessaire, qui se trouvent dans des situations financières favorables (sans enfant, avec un logement peu couteux, vivant de peu) ou cèdent à la pression exercée sur eux. Il faut souvent batailler pour leur faire comprendre que cette situation est une impasse et qu’ils se desservent eux-mêmes, mais aussi les autres professionnels.
En acceptant de baisser ses tarifs ou d’avoir des tarifs bas, par exemple en dessous de 400€, j’y reviendrai, le freelance va enclencher une boucle de rétroaction négative. En baissant son tarif, il se retrouve dans une situation de précarité l’obligeant à chercher toujours de plus missions, faire plus de jours à facturer donc consacrer moins de temps à se former, à monter en compétences, moins de temps pour trouver des missions intéressantes, dépenser plus d’énergie dans la gestion de petits projets et finalement accepter la première mission encore plus mal payée. Financièrement la conséquence est l’impossibilité d’épargner, donc de faire face à un imprévu ou simplement d’acheter son logement, déjà qu’il est compliqué d’emprunter ou de louer avec un statut de freelance. Autre conséquence, si un a un moment le freelance veut prendre un temps long pour se former, se réorienter ou doit modifier sa situation, il n’en aura pas les moyens.
Du côté des clients
Donc les propos cités conduisent à la paupérisation des freelances, car ils propagent l’idée que ceux-ci seraient trop payés et qu’il faut donc baisser leurs rémunérations. Mais on en revient surtout à favoriser une forme d’ubérisation qui considère que les TJMs des freelances sont une variable d’ajustement de la masse salariale afin de maximiser les bénéfices et de dépenser moins.
Sur un marché en tension comme celui des designers ou des développeurs, bien sûr, il y a un hic… C’est qu’il suffit d’aller voir ailleurs pour constater que l’herbe est plus verte, donc ça conduit juste à une fuite des compétences, un turn-over important et des difficultés à trouver des prestataires.
Donc petit rappel, la relation entre un client et un freelance est une relation contractuelle et commerciale. Même s’il peut y avoir négociation au départ, ce n’est pas le client qui fixe le tarif de manière unilatérale. Une discussion entre le freelance et le client doit s’instaurer et si par exemple le client n’a pas les moyens de ses ambitions, il est souvent possible de faire une proposition avec périmètre moindre, donc moins de jours, mais en gardant un tarif raisonnable.
Ceci dit, revenons-en au TJM.
Jours travaillés versus jours facturés
Déjà un premier point d’incompréhension c’est la différence entre les jours facturés et les jours travaillés. En tant que salarié, tout le temps que le salarié passe au travail, voir même le temps de trajet, dans certains cas, lui est payé. Qu’il discute à la machine à café, qu’il aille suivre une conférence à l’autre bout de la France, qu’il mette à jour son ordinateur ou remplisse le formulaire A38 pour que quelqu’un le fasse, qu’il regarde un tuto sur YouTube pour se former, qu’il parte en vacances, il est payé.
En freelance, en gros, tout ce que je viens de citer n’est pas directement facturé au client et en plus il faut faire un certain nombre de tâches que le salarié n’imagine même pas, mais qui sont nécessaire à la bonne marche d’une entreprise : La comptabilité, les déclarations de TVA et de revenu, la facturation, son suivi et les éventuelles relances voir les injonctions de paiement. Il y a aussi l’aspect commercial : faire et maintenir un site, un profil LinkedIn, établir une stratégie commerciale, créer et entretenir un réseau, acquérir une certaine notoriété ou faire du démarchage, établir les propositions commerciales.
Sachant que chaque projet a un temps administratif incompressible, plus vous avez de petits projets, plus le ratio administratif/productif va être défavorable.
Alors combien de jours, un freelance facture, dans une année ?
Il y a 251 jours ouvrés dans une année moins les jours suivants :
- 35 jours de vacances (Convention syntec = 5 semaines de congés + 2 de RTT)
- 12 jours de comptabilité, facturation & administratif
- 12 jours de commercial « passif » (réseau, publication, notoriété…)
- 12 jours de veille, formation & conférence
- 6 jours de « maintenance technique » et autres
- 10 jours de maladie du freelance ou de ses enfants
Déjà là au mieux du mieux un freelance facture 164 jours pour environ 210 jours travaillés.
164 jours, et il faut bien comprendre que c’est s’il n’y a aucune interruption dans les différents contrats, aucun jour de chômage technique ou aucun aléas. Ça veut dire donc probablement plusieurs missions longues qui se chevauchent dans l’année. Mais ça veut aussi dire que quand ces missions finiront, il y a aura une période d’intercontrat qui pourra durer plusieurs mois et qui nécessitera une phase commerciale active.
Dans la réalité, un freelance facture entre 120 et 150 jours par an.
Il peut y avoir des variations suivant les professions, les designers vont avoir plus des missions courtes ou avec une charge de 2 à 3 jours par semaine, là ou les développeurs seront plus sur des missions longues à 4 voir 5 jours par semaine.
165 jours c’est approximativement ce que j’ai facturé en 2021 avec deux missions longues sur toute l’année en parallèle, 2 ou 3 missions plus courtes et une semaine de cours. Fin juillet et début décembre, je suis arrivé à un stade où j’étais exténué, j’ai dû vraiment prendre des vacances, des vraies. Il faut prendre en compte que la charge de travail d’un freelance n’est pas linéaire, mais varie 0 à 200%, en l’occurrence là plus de 100% à 200%.
Cotisations sociales, charges et le reste
Pour la suite, tous les tarifs que j’évoque sont HT. Que la TVA soit reversée ou pas ça revient au même c’est transparent.
Bon une fois qu’on a facturé et reçu le paiement, il y a quelques trucs à payer.
- Les cotisations sociales
- Les charges
- Et de l’argent de côté pour pas mal de choses
Pour les cotisations sociales, ça dépend de la forme juridique, mais c’est compris de 22% à 45%, mais pas sur la même base. Le plus efficace pour comprendre ça c’est d’utiliser les simulateurs disponibles sur le site.
Les charges
Les charges, en fait il y a pas mal de choses à payer en freelance qui s’accumulent et qui forme une somme non négligeable chaque mois.
- Assurance 100 €/mois
- une assurance responsabilité civile pro 250 à 500 €
- une mutuelle : 600 à 1 000 €
- Informatique 275 €/mois
- Un ordi, un téléphone, une tablette : 3600 € amorti sur 3 ans donc 100 €/mois
- Les logiciels, Adobe, Figma, Sketch, Zoom, etc. : 100 €/mois
- Internet et téléphone : 75 €
- Bureau 300 €/mois
- Que ce soit à domicile ou dans un coworking, il faut un local pour travailler dans de bonnes conditions : 250 €
- Du matériel de bureau, c’est un investissement de départ.
- Des fournitures, post-it, crayon, papier, petit outillage, cartouches d’imprimante
- Déplacements 250 €/mois
- Si c’est dans le cadre d’une mission, ça peut être compris dans la prestation
- Dans la pratique, certains déplacements sont difficilement facturables à un client, par exemple quand je vais sur Paris, je loge chez ma sœur et je vois plusieurs clients.
- Formation & veille 100€/mois
- Pour aller une conférence, le billet, le transport et l’hébergement, environ 500 €. Ou beaucoup plus sur une grosse conférence internationale.
- Cours, formations, livres et autres abonnements
- Compta 50 à 150 €/mois
- Service bancaire 15€/mois
- Comptable 1 500 €/an ou association de gestion agrée 250 €/an
Donc au final, il faut compter près de 1000 €/mois de charges pour travailler dans de bonnes conditions. Alors oui, on peut faire durer l’ordi, pirater les logiciels, ne pas se former, ne pas s’assurer… mais ça ne me parait guère pérenne comme attitude.
Tout le reste
Oui, un petit détail, en freelance vous n’avez pas de chômage. Pas de bras, pas de chocolat, pas de travail, pas des sous. Une mission peut s’arrêter plus prématurément que prévu, pour une raison ou une autre. Il y a des moments de creux avec moins ou pas de travail. Il faut alors relancer la machine commerciale. Donc les revenus peuvent fortement varier d’une année sur l’autre. Il faut donc anticiper. Pour donner une idée, mes revenus en freelance depuis le début.
Depuis juin 2021, le freelance est un peu mieux couvert en cas d’arrêt maladie (entre 22€ et 169€ par jour d’arrêt, 1/730e du revenu annuel, 90 jours max) ce qui n’était absolument pas le cas avant. Mais en cas de maladie chronique par exemple, une partie du temps et de la charge mentale est consacrée à se soigner. Ce qui entraine nécessairement une perte de revenu qui ne sera pas compensée par l’assurance maladie. Par exemple 3 séances de kiné par semaine, ça fait 3 demi-journées de perdu, mais pas pour autant 3 jours d’arrêt maladie. J’avais déjà parlé de maladie chronique. De même pour un enfant qui reste à la maison pour suspections de covid en attendant de se faire trifouiller le nez ou pas.
Puis, oui, il n’y a pas de Comité d’Entreprise pour fournir des voyages ou des vacances subventionnés. Pendant, les vacances non seulement le freelance dépense de l’argent, mais en plus il n’en gagne pas.
Donc globalement, il faut mettre de l’argent de côté pour des choses prévisibles et des imprévus, genre une pandémie mondiale, des élections, une guerre aux frontières de l’Europe qui bloque l’économie.
Des chiffres, des sources et des calculateurs
Quand on parle de freelance, une des difficultés est d’avoir des chiffres fiables sur les tarifs réellement exercés et sur le CA obtenu au final.
Si on regarde une plateforme comme Malt ou toute autre plateforme proposant un catalogue de freelances, les tarifs affichés sont biaisés :
- soit le freelance est junior, sans références, sans notes et est donc en concurrence avec plein d’autres freelances dans ce cas et la tendance va être de tirer le prix vers le bas.
- soit le freelance est bien noté, senior, etc. et il peut afficher le prix qu’il veut, il sera toujours sur la première page, mais c’est pas forcément son tarif réel.
- soit le freelance a un vrai réseau, une vraie notoriété et il n’est pas sur ce type de plateforme.
On peut noter que les Designers interactifs font régulièrement des études sur les salaires ou les revenus des freelances, avec le souci que ces études sont faites en lignes et donc le panel qui répond n’est pas représentatif et la taille des échantillons n’est jamais précisée dans les résultats. Dans cette étude « Combien gagnent les designers et designeuses numériques en France ? » par exemple, il y a un millier de répondants, mais seulement 13% de freelances entre autoentrepreneur et entreprise individuelle, soit 130 personnes environs.
De mon côté, j’avais réalisé une étude sur les salaires des designers, mais encore une fois les répondants étaient les personnes que je pouvais atteindre dans mon réseau.
La source la plus fiable que j’ai pu trouver est les statistiques de l’UNASA, les associations de gestions agréées qui ont les vrais chiffres. On peut regarder par exemple la catégorie des designers pour 2019.
Ça permet de voir la répartition des chiffres d’affaires et pour un quartile donné de voir comment sont réparties les dépenses. J’y mettrai encore un bémol, c’est que les catégories correspondent aux codes APE et que les UX designers peuvent être en design, en graphiste, ou dans un sombre code de conseil. C’est une peu la loterie.
Des simulateurs
Feu le site kob-one avait développé un excellent simulateur pour calculé son TJM en fonction d’un équivalent salaire. Heureusement on peut retrouver une version sauvegardée et fonctionnelle sur web.archive.org.
Eric Daspet a aussi construit une google sheet qui permet de jouer avec les différents paramètres et de comprendre ce qui rentre en compte dans un TJM et il y a beaucoup de choses !
Et comme je l’ai déjà cité le simulateur pour les cotisations sociales de l’URSSAF.
Trois situations concrètes
Je propose trois cas pour rendre tout ça concret.
- Le premier est un chiffre d’affaires de 72 000 € ce qui correspond au maximum de ce que peut gagner un autoentrepreneur. Ça correspond à 120 jours facturés à 600 € pour un profil médian, sur une année moyenne, ou ça peut correspondre à 160 jours à 450 € pour un junior à plein temps.
- Le deuxième correspond à un chiffre d’affaires de 120 000 € soit un senior travaillant à 800 € facturant 150 jours. Ça correspond au chiffre d’affaires maximum qu’on peut atteindre en freelance, donc ça reste exceptionnel.
- Le troisième sera un scénario médian, je dirai réaliste pour quelqu’un qui a 4 ou 5 ans d’expérience comme freelance et 7 ans ou plus dans son métier. Ça correspond à un chiffre d’affaires de 94 500 € soit 135 jours payés à 700€
Attention toutefois, j’ai fait des calculs au mieux, sur la base de certains choix. Ça reste un ordre de grandeur réaliste, mais par forcément la réalité comptable exacte.
Pour chaque cas, je propose 4 ou 3 scénarios en fonction de la structure juridique du freelance, sachant qu’il n’est pas possible d’être en autopreneur au-delà de 72 000 €. Je prends pour les charges la somme de 12 000€, soit 1 000 € par mois. C’est un chiffre cité régulièrement qui me parait assez réaliste et que j’ai détaillé ci-dessus.
Les structures sont les suivantes :
- Autoentrepreneur : les cotisations sociales sont calculées sur le CA sur la base de 22% sans prendre en compte les charges.
- Entreprise individuelle : les cotisations sociales sont calculées sur la marge ((CA – charges)x moult taux et seuils)
- SASU : Le calcul est fait avec une part minoritaire de dividendes (bénéfice – 30% d’impôts sur les sociétés) et une part de salaire sur lequel on paye des cotisations sociales.
- CAE, Coopérative d’activité et d’emploi : la CAE prend une part pour son fonctionnement, 15% dans cet exemple, mais c’est très variable suivant la CAE, et verse un salaire sur lequel on paye des cotisations sociales.
Je me suis appuyé sur ces calculateurs de cotisations sociales : Autoentrepreneur, Entreprise individuelle, SASU-Salaire
Le revenu final est revenu net avant l’impôt sur le revenu.
Pour 72 000 € de CA, cela donne les revenus nets suivants :
- Autoentrepreneur : 44 088€ soit 3 674€/mois
- Entreprise individuelle : 40 704€ soit 3 392€/mois
- SASU : En comptant 15 000 € en bénéfice, le reste en salaire : 35 484 € soit 2 957 €/mois
- CAE : 28 369€ soit 2364 €/mois
Si on parle de design, ça correspond globalement au salaire d’un designer junior en sortie d’école ou avec moins de 3 ans d’expérience telle que ma précédente étude sur les salaires des designers l’a montrée.
Pour 120 000 € de CA, cela donne les revenus nets suivants :
- Entreprise individuelle : 75 982€ soit 6 332€/mois
- SASU : En comptant 28 000 € en bénéfice, le reste en salaire : 64 354 € soit 5378€/mois
- CAE : 58 698€ soit 4 892€/mois
Dans le domaine du design, ça corresponds à des postes correctement payés de lead designers seniors, sachant qu’à ce niveau d’expertise les salaires peuvent diverger fortement. Un lead designer ayant une vingtaine d’années d’expérience et ayant bien négocié sa carrière sera a plus de 100 000€ de salaire. Un designer senior avec une carrière plus classique dans un grand groupe sera dans ces tarifs-là autour de 60 à 70 000€ avec une grande variabilité. Mais encore une fois faire 120 000€ de CA et en freelance reste une exception.
Pour 94 500 € de CA, cela donne les revenus nets suivants :
- Entreprise individuelle : 56 594€ soit 4 716€/mois
- SASU : En comptant 22 500 € en bénéfice, le reste en salaire : 49 118€ soit 4 093€/mois
- CAE : 39 223€ soit 3 269€/mois
Si on parle de design, ça correspond effectivement au salaire d’un designer avec une dizaine d’année d’expérience. On reste vraiment dans la moyenne des revenus pour le secteur. C’est un niveau de revenu réaliste pour un bon designer en freelance.
Pourquoi payer un freelance moins de 400 € est problématique ?
Disons qu’un freelance est payé 300€, qu’il facture le maximum soit 150 jours, il va donc gagner 45 000 €. Il est en autoentrepreneur et donc il verse 9990 € de cotisation, il paye 12 000 € de charges, ça ne change pas. Et donc il gagne royalement 23 010 € soit 1917,5 € par mois. Alors 1917,5 € ça correspond à quoi ?
Et bien si on regarde les statistiques de l’INSEE
- le salaire moyen en 2016 est de 2 238 €
- le salaire médian est de 1 789 €,
- le 6e décile à 1 995 €
- le 9e pour être dans les 10% qui gagnent le plus commence à 3 576 €
- le salaire moyen des cadres 4 060 €
Rappel : PAS DE CHÔMAGE, pas de CE, pas de tickets resto…
Avec 1917,5 € il est possible de vivre en couple avec deux revenus, sans enfants, en province. Il ne faudra juste pas vouloir acheter un deuxième vélo électrique tout de suite. Bon à Paris, ça devient plus compliqué, célibataire ou divorcée, ou une envie d’avoir un enfant et autre chose que de louer un studio de 12m carrés à 600€ ?
Donc là, on a quelqu’un qui a fait des études supérieures, qui se retrouve dans une situation qui n’est pas viable.
Il faut recadrer les choses. Un designer sorti d’école peut envisager 3000 € de salaire, un dev au moins autant ou plus en ces temps de disette. Donc il n’est juste pas possible de payer un freelance qu’il soit designer, développeur ou tout autre métier du numérique, moins de 400 € par jour sauf à vouloir le maintenir dans une situation de précarité. C’est le principe de l’ubérisation : « vous êtes libre, indépendant, mais on ne vous paye pas assez pour que vous ayez le temps d’aller voir ailleurs, sauf le jour où on décide de vous jeter ».
Synthèse
Vous êtes arrivé jusque là. Bravo !
Donc pour résumer les points clefs :
- Un freelance facture entre 120 et 150 jours par an, pour 210 jours travaillés
- Les charges sont de l’ordre de 1 000 € par mois.
- Les cotisations sociales sont dépendantes du statut de 22% du CA à 45% de la marge. Il est possible de les simuler sur le site de l’URSSAF [https://mon-entreprise.urssaf.fr/simulateurs]
- Un TJM inférieur à 400 € n’est pas viable sur le long terme et entraine la paupérisation du freelance.
Je vais conclure par un graphique qui synthétise tout cela. Quand un freelance reçoit 100 € cette somme en réalité répartit de la manière suivante :
- Une partie non facturée 43 €
- 14 € pour les congés payés
- 4 € pour les congés maladie
- 17 € pour le fonctionnement de l’entreprise
- 8 € pour le chômage et les aléas divers
- Une partie facturée 57 €
- 7 € de charges
- 16 € de cotisations sociales
- 34 € de revenu net
Au prochain qui me dit qu’un freelance est trop payé
« Ah, le printemps ! La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. »
Kaamelott, Arthur.
SNCF Connect, petit bilan d’une catastrophe industrielle. 21 Feb 2022 1:14 AM (3 years ago)
Je vais essayer de faire un petit bilan de la nouvelle app SNCF Connect et des problèmes qu’elle pose aussi bien en termes d’interface et qu’en termes de processus de conception ou « Comment peut-on en arriver là ? »
Si vous voulez vous faire une idée de la catastrophe industrielle que ça représente, vous pouvez lire les articles sur le sujet ou encore simplement les commentaires sur les stores en triant par les plus récents. C’est à un tel point que le ministre des Transports en a remis une couche (ce qui ne servira à rien) et que les patrons de la SNCF ont dû aller faire le service après-vente à la radio ou à la télé.
Vous pouvez aussi retrouver les principales critiques dans cet article «On se dit tout » publié par SNCF Connect et ses réponses méprisantes. Julien a fait une réponse à ce sujet sur twitter que je vous laisse dérouler.
Parlons de l’interface
Je ne vais pas faire un audit exhaustif de l’app, mais juste revenir sur quelques points basiques :
- Le contraste négatif et les raisons évoquées par la SNCF
- Lisibilité
- Reposant
- Économe
- et l’accessibilité
- La recherche mono-champ
- Les régressions fonctionnelles
Le mode sombre
Ma première réaction en ouvrant l’app SNCFConnect a été de chercher comment virer le mode sombre pour revenir à un truc lisible qui respecte mes choix d’où ma première remarque :
D’où c’est une bonne idée de proposer une interface avec un contraste négatif pour une app qui sera utilisée dehors au soleil ? Et qui ne respecte pas le choix de l’utilisateur sur son téléphone.
La réponse ne s’est pas fait attendre et on m’a opposé trois arguments pour ce choix : Lisibilité, Reposant, Économe.
Lisible
Est-ce qu’écrire en blanc sur fond noir améliore la lisibilité ? Un article scientifique de 1997 nous dit que NON.
Je n’ai pas trouvé d’études plus récentes disant le contraire.(mais j’ai pas cherché 3 jours)
Par contre, ce qui améliore la lisibilité c’est de respecter la norme iso 9241-303 sur la taille des textes.
« 5.5.4 Hauteur de caractère
Les caractères latins doivent avoir une hauteur minimale de 16′ d’arc ; il faut que le système ait la capacité de fournir une hauteur de caractère de 20′ à 22′ d’arc. »
Mon œil a été rapidement attiré par la petite taille de certains textes comme le « lire la suite » qui s’affiche en haut de l’écran d’accueil, ou sur des textes de tailles similaires par exemple « ouvrir le détail » pour permettre d’accès au détail d’un trajet et de l’acheter. Oui, il faut regarder le détail avant de pouvoir acheter.
Toujours est-il, ce texte fait 28 pixels de haut sur un iPhone 12, l’écran présente une définition 460 ppp, soit 1,49 mm de haut, tenu à 45 cm du visage, ça donne un angle de vue de 11,8’ d’arc. Bien loin des 16’ d’arc minium indiqué par la norme. Vous allez me dire pourquoi 45 cm ? Et bien 60 cm, c’est la longueur du bras pour un homme qui fait 1,80 m et 25 cm c’est le punctum proximum : le point le plus proche que l’on peut voir distinctement. J’ai pris une valeur moyenne entre les deux, qui correspond aussi à une position de confort.
Donc SNCF Connect, si tu veux que ça soit lisible : écrit plus gros sur tes liens d’actions.
Reposant
Est-ce que c’est reposant ? « Reposant » de quoi parle-t-on ? Est-ce que ça permet d’avoir un temps de lecture long sans fatigue oculaire ? Comme qui dirait ça dépend. Ça dépend principalement du contexte et notamment de la différence de luminosité entre l’écran et l’environnement. Si la différence est trop forte, les yeux vont passer leur temps à accommoder et ça devenir rapidement fatiguant, voir intenable. Donc en général on utilise un contraste négatif dans une ambiance tamisée ou de nuit.
De toute manière, là on parle d’une app qu’on va regarder par séquences de quelques minutes. Dans mon cas, c’est de l’ordre de la dizaine de minutes au total sur une semaine quand je suis en déplacement. Donc la fatigue oculaire ne doit pas être un problème.
Un autre problème du contraste négatif c’est qu’au soleil, ça fait un joli miroir. Dans le cas de SNCFConnect , c’est bien une app utilisée en mobilité. Sur un quai de gare en plein soleil, sous la pluie, les mains encombrées, dans le stress du départ. Donc pour que ça reste utilisable, dans ces conditions il faut « forcer » le contraste. La plage de contraste négatif utilisable et accessible est réduite par rapport à un contraste positif.
En cherchant d’où venait cette idée que le mode sombre améliorait la lisibilité, je suis retombé sur le passage de la norme iso 9241 de 1997, qui dit effectivement que le mode sombre est plus reposant sur les écrans qui scintillent, autrement dit sur les écrans cathodiques. Aujourd’hui ce n’est plus du tout d’actualité sur les écrans plats modernes.
Économie d’énergie
Dernier point : l’économie d’énergie. Alors oui l’Ademe recommande d’activer le mode sombre sans préciser le gain réel ou donner des chiffres. (Si quelqu’un a, je suis preneur), Mais là on parle de quoi ? De 10 min d’utilisation ? Ce n’est pas Twitter. Je peux retourner la question : est-ce que la difficulté à lire l’écran ne va pas entrainer un temps d’usage plus long supprimant le bénéfice énergétique d’un écran sombre ? Ou si on veut être réellement dans une démarche d’éco-conception, il faut commencer par supprimer la tripoté de trackeurs ou encore le « partage en continu de votre position » qui lui est clairement un gouffre énergétique. Là le mode sombre passe pour un pipi sous la douche.
De l’accessibilité
Dernier point l’accessibilité. La règle « zéro » de l’accessibilité c’est : respecter les choix de l’utilisateur. Si j’ai choisi de ne pas activer le mode sombre, il y a sans doute une bonne raison que tu es prié de respecter en rentrant chez moi sur MON TÉLÉPHONE. Bisous. Donc « Le parti pris de proposer un mode sombre (sans alternative de passer en light mode) est fort. » Moi, je traduirai ça en « On s’est fait plaisir, vous ne connaissez pas vos besoins, pauvres utilisateurs ». C’est très infantilisant comme attitude. C’est aussi considéré que son app est au centre de la vie de l’utilisateur et va devenir la norme, faisant fi des guidelines édités par le concepteur de l’environnement (Apple ou Google).
Comply with the appearance mode people choose in Settings. If you offer an app-specific appearance mode option, you create more work for people because they have to adjust more than one setting. Worse, they may think your app is broken because it doesn’t respond to their systemwide appearance choice.
En conclusion, je conseillerai aux concepteurs de regarder le temps d’utilisation de leur app, par semaine et de le comparer au temps global. Ça devrait rationaliser quelques décisions.
Le champ de recherche unique
Ce champ de recherche unique est symbolique du problème de SNCF Connect, que je résumerai en « Bon à rien, mauvais à tout ». Sous prétexte de minimalisme et de modernité, d’intelligence artificielle, on se retrouve avec un champ unique qui ne dit pas ce qu’il fait et ne fait pas ce qu’il dit.
Le premier point est simplement sont fonctionnement : la validation au clavier a un comportement différent de la liste des résultats qui s’affiche lors de la saisie. En réalité, cette liste donne systématiquement des résultats nuls, là où la « vraie recherche » donne globalement les bons résultats. À noter que sur un ordinateur le fonctionnement est encore différent, la validation au clavier valide le 1er résultat de la liste, alors que l’icône lance la « vraie recherche ».
On en revient au problème de base : SNCF Connect, c’est fait pourquoi ?
Pour acheter et utiliser des billets de train.
Pour le reste, il y a d’autres applications (Plan, Waze, … ).
Donc même si on se centre sur les trajets en train, est-ce que c’est une bonne idée de faire un champ unique ? Jean-Daniel Guyot, ex-capitaine train, nous donne la réponse.
« La première interface de Capitaine Train n’avait… (roulement de tambour… )… qu’un simple champ texte. On ne peut pas faire plus simple qu’un champ texte. C’est limpide. C’est Google. Nous pensions là avoir un concept imbattable, qui allait écraser le géant monopolistique. Nos clients allaient tomber amoureux de cette simplicité. Une idée géniale.
Sauf que…
Test après test, nous nous sommes rendu compte à quel point c’était une fausse bonne idée. Il y a 1 000 façons de décrire le trajet que vous voulez faire. Les utilisateurs ne connaissent pas toujours l’orthographe d’une ville. Il y a beaucoup de façon d’écrire une heure. Mais est-ce l’heure de départ ou d’arrivée ? Comment gérer le retour ? Comment gérer les « via » ? Comment gérer les passagers ? Les cartes de réduction ? …
Nous nous sommes arraché les cheveux, pour finir par tout jeter. »
« Nous avions oublié qu’un bon design était d’abord et avant tout un design évident. »
On revient aux bons vieux critères de Bastien et Scapin : Guidage et Incitation
« 1.1. Incitation
Définition : Le terme Incitation a ici une définition plus large que celle qu’on lui confère généralement. Ce critère recouvre les moyens mis en œuvre pour amener les utilisateurs à effectuer des actions spécifiques, qu’il s’agisse d’entrée de données ou autre. Ce critère englobe aussi tous les mécanismes ou moyens faisant connaître aux utilisateurs les alternatives, lorsque plusieurs actions sont possibles, selon les états ou contextes dans lesquels ils se trouvent. L’Incitation concerne également les informations permettant aux utilisateurs de savoir où ils en sont, d’identifier l’état ou contexte dans lequel ils se trouvent, de même que les outils d’aide et leur accessibilité. »
Comme quoi, les fondamentaux c’est toujours valable.
Je fais aussi l’hypothèse que les concepteurs, voir les testeurs de ce superbe champ de recherche unique sont tous parisiens et donc il est évident pour eux que le point de départ, c’est Paris…
Les régressions fonctionnelles
Je vais passer rapidement, mais les plus visibles que j’ai notés sont :
- L’impossibilité d’ajouter ton billet à ton calendrier : Bah oui, ce n’est pas comme si ta préoccupation principale une fois le billet acheter, c’est de ne pas louper ton train et de te mettre des alertes.
- L’absence de luminosité sur l’affichage des QRCodes, difficultés à passer les contrôles et il parait qu’ils ont testé ?
- La voiture et la place… Il faut chercher bien loin, pour trouver l’info. Alors que c’est juste dans le triptyque des infos dont on a besoin pour prendre le train : heure, quai, place.
C’est pourtant des « petites fonctions » qui existaient déjà. Mais elles ont dû passer à la trappe lors des développements pour trucs jugés plus importants. Sauf que d’un point de vue utilisateur, c’est juste qui ce te simplifie la vie et limite le stress du voyage aux moments clefs.
Comment peut-on en arriver là ?
On constate là qu’un certain nombre de choix de design se font à l’encontre des besoins des utilisateurs et des règles du métier. Pourtant la SNCF communique sur des tests :
« Pour la conception et les décisions clés, 4 400 clients ont par exemple été interrogés sur la barre unique de recherche ou le choix du bleu nuit.
En juin 2021, une version Alpha a été lancée impliquant 5 000 clients et collaborateurs (tests des parcours, interfaces…).
Une version bêta était en test dès novembre avec plus de 4 000 personnes : clients, collaborateurs, agents SNCF et associations d’usagers. Ces tests en vie réelle ont permis de confirmer les choix tout en améliorant l’app et le site avant le lancement grand public. »
Comment avec une telle débauche de moyens, de tests, les problèmes n’ont pas été identifiés, remontés et corrigés, voire la sortie de SNCF Connect reportée ? Comment malgré un tsunami de remontées clients négatives on a encore ce type de remarques paternalistes : « Pour certains, ce n’est pas intuitif du premier coup, ça veut dire qu’ils ont besoin d’être accompagnés… » ?
Du fonctionnement des grandes entreprises
“Un connard de chef a décidé de tout changer en un an, alors on a fait ce qu’on a pu coté dev, en réutilisant des composants web dans l’app (d’où des problèmes) et coté UX … ça s’est passé comme tu peux l’imaginer… (sous-entendu : les designers ne sont pas les décideurs) ”
Mon petit doigt m’a dit.
C’est un des retours que j’ai recueilli et ça corresponds à ce que je connais dans de ce type d’organisation. Les managers ne sont pas là pour rendre un service public, ou satisfaire le client. Issus des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerces, ils sont là pour faire carrière, montant les échelons le plus rapidement possible, changeant d’entreprise si besoin. Donc la réussite réelle ou non d’un projet n’a que peu d’impact, si ça réussi c’est grâce à eux, si ça foire c’est à cause des autres. Il suffit de cocher la case « gros projet » pour monter sur la marche d’après. Avec un peu de chance, si le projet à une belle visibilité et fait gagner de l’argent, ils peuvent espérer sauter une marche. Si c’est une catastrophe, ils sont passés à autre chose, laissant les opérationnels se démerder.
Bien sûr le design n’est pas représenté dans les comités de direction, car les designers ne sont pas issus de ces grandes écoles.
L’innovation à tout prix
Mais donc pour pouvoir briller en comité de direction, il faut de l’innovation et l’innovation qui se voit, qui utilise des termes techniques, des anglicismes, alors on va parler d’intelligence artificielle, machine learning, de choix esthétiques forts à la Spotify, être le Netflix du voyage. Là, je suis quand même déçu que les billets ne soient pas sur la blockchain avec des NFTs.
Dans ces conditions, il est alors difficile de faire réellement de l’innovation sur des bases scientifiques ou sur des données utilisateurs. Pour donner un exemple, une télécommande comme celle proposée par Orange à la nécessité 4 ans de maturation, de haut et de bas avant d’arriver à émerger. Elle est innovante par sa simplicité et par sa conception basée sur les usages (les touches sont réparties en fonction de la fréquence d’usage).
Le facteur temps joue aussi, pour une telle application. Si les délais, posés par le management, sont irréalistes à la vue de la complexité technique qu’il y a derrière, c’est l’échec assuré. L’alternative a ça est de changer les choses une par une, de ne pas modifier le back, le front, la marque, l’UX en même temps.
L’effet Janis
« L’effet Janis tendrait à se constituer lorsqu’un groupe vise à établir un consensus sur la solution la plus acceptable pour sauvegarder la cohésion du groupe et éviter les discussions susceptibles d’être source de conflit. »
C’est un effet que j’ai déjà observé dans les grands groupes ou dans les grandes équipes, où la hiérarchie est omniprésente et tout doit bien se passer, bien se passer, tellement bien,…. On se retrouve avec des décisions qui se caractérisent par :
- la pauvreté de l’information recherchée ;
- les biais et les distorsions dans le traitement de l’information et la définition des objectifs ;
- l’absence de prise en compte des risques potentiels que la décision comporte ;
- le manque de recherche d’alternatives logiques et cohérentes.
Le résultat c’est bien sur des catastrophes, avec une perte de contact entre des décisionnaires, des équipes techniques et la réalité du terrain. Par exemple, les infos remontées du terrain par la recherche utilisateur vont être édulcorées pour ne pas contredire d’autres choix jugés plus importants par le marketing, les devs ou les chefs. On se retrouve par exemple sans la possibilité d’ajouter son trajet à son calendrier, sans augmenter la luminosité du QR code. Sans doute parce que ces fonctions jugées « petites » sont gentiment passées à la trappe alors que c’est juste une étape clef du parcours utilisateur dans le stress du départ.
La conclusion & la communication
L’impression globale c’est que la SNCF est tombé dans le piège de se croire seule au monde avec une application qui soit l’alpha et l’oméga. Une app toute seule sur le téléphone du client, dans la vie de ses clients oubliant le contexte, les habitudes, les bonnes pratiques ou simplement l’historique de ce même service.
Au final, je ne sais pas trop ce qui est le pire dans cette catastrophe industrielle ? Ce qui est certain c’est que la communication est mode « On est génial, vous n’avez pas compris, pauvres petits utilisateurs, nous avons raison » est bien sûr un désastre en soit. Une attitude simplement plus humble aurait sans doute permis de mieux faire passer les erreurs de jeunesse de cette version de oui.sncf.
Biblio
En complément, Économie d’énergie et mode sombre : https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q3/dark-mode-may-not-save-your-phones-battery-life-as-much-as-you-think,-but-there-are-a-few-silver-linings.html
Offre d’emploi en design et diversité 21 Nov 2021 10:29 PM (3 years ago)
Je suis tombé en passant sur linkedin, oui, grosse erreur de base, sur une belle série d’offres d’emploies chez Décathlon. Disons tout de suite que les postes proposés sont sans aucun doute très bien, ce qui est plus problématique c’est le recrutement, à commencer par l’annonce.
J’ai regardé plus longuement celle portant sur le poste « HEAD OF RESEARCH DESIGN – CORE DESIGN (H/F) » ou le PDF de l’Offre d’emploi head of design
À la fin sera le commencement.
Le dernier paragraphe de l’annonce est le suivant :
Décathlon est engagé dans l’inclusion et la non-discrimination, et agit ainsi quotidiennement en faveur du handicap, des séniors, de la mixité sociale, de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous recrutons avant tout des personnalités et la diversité au sein de nos équipes est un enjeu majeur, car elle est source d’innovation et de performance.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez consulter ce site : https://recrutement.decathlon.fr/nos-engagements/diversite/
La question que je me pose c’est : « Est-ce que cette offre d’emploi est compatible avec cet engagement ? »
Déjà pourquoi cet engagement vient en dernier ? Tout le monde sait ce que fait Décathlon, pas besoin de l’expliquer en long et en large, mais l’engagement sur l’inclusion, c’est différencient, ça mérite d’être en premier. Si c’est correctement mis en œuvre, ça à un gros impact sur l’organisation.
Donc regardons le début de cette annonce :
- Présentations de Décathlon, attention ça parle de valeurs « Vitalité, Responsabilité, Générosité et Authenticité. »
- Le contexte du poste : 4 métropoles possibles et on te le dit deux fois. C’est important pour la suite.
- Une petite dose de franglais des familles au passage « Nous recherchons un-e head of research pour leader la practice Research »
- Créer un environnement de travail efficient et « bienveillant » le mot magique, sauf que c’est aux RH de faire ce boulot-là en recrutant correctement et en écartant les gens toxiques.
- Les futures missions ne sont pas déconnantes, mais tu ne sais pas trop quel est ton réel pouvoir et les moyens dont tu disposes, mais tu auras toujours le temps de poser la question.
Rien de bien méchant jusque là, ça reste dans le très classique de l’offre d’emploi.
Sur le profil, ça commence bien avec l’expérience requise, puis ça dérape, avec des éléments qui n’ont rien de mesurable. Et qui sont d’ailleurs présents dans toutes les offres :
- Vos arguments sont avant tout porteur de sens et vous prouvez par l’exemple
- « Nan, d’habitude je pipote et je m’en tire avec une pirouette. »
- L’intraprenariat est votre mindset, l’utilisateur-rice est votre meilleur-e ami-e et la data est votre langage.
- NO, attention BULLSHIT WARMING comme on dit en Franglish
- Vous avez d’excellentes qualités à l’oral, à l’écrit (et aussi sur le terrain, le stade, le mur, les airs ou dans l’eau aussi)@!
- Si tu as un handicap physique, tu fais comment ? C’est un peu récurrent dans l’annonce cette « passion du sport » comme si tu demandais à un médecin d’être passionné de médecine ou de 1er soin ? Non lui demande d’être compétent ou expert, mais pas passionné.
- Vous avez d’excellentes qualités d’organisation
- Pourquoi ? On peut être un excellent designer et être parfaitement bordélique ou du moins avoir sa propre organisation. Tu ne recrutes pas un comptable, mais un designer expert.
- Vous êtes ceinture noire 2 Dan en anglais (Niveau C1)
- L’anglais, ça c’est un bon exemple de discrimination. C1 ça veut dire « Utilisateur expérimenté », parler vraiment couramment, autrement dit il faut avoir vécu ou travailler dans un environnement anglophone à un moment de sa vie. Pour quelqu’un de dyslexique, ça peut être un niveau très difficile à atteindre ou conserver sans pratiquer régulièrement.
- La question derrière ça c’est pourquoi un tel niveau ? Ça va servir à quoi ? C’est pour parler anglais toute la journée ? Ou juste comprendre les 3 emails qu’un collègue d’une autre nationalité aura écrits dans un mauvais anglais ?
Là on commence à percevoir la dissonance entre « On veut de la diversité », mais vous devez renter dans le moule de « la bienveillance, du séjour dans un pays anglophone, du bon orateur » L’archétype du gars sportif sorti d’école de commerce, sauf que ce n’est pas du tout le boulot !
Et le démoulage ne tarde pas, avec la cerise sur le gâteau
- On dit de vous que vous inspirez votre entourage.
- Vous avez évangélisé la research dans une autre entreprise.
- Vous avez une expérience internationale à nous raconter.
- Vous avez déjà une expérience dans une entreprise de sport.
Donc en fait ça serait bien de ressembler au stéréotype du candidat parfait, ça serait rassurant. Ta « personnalité », ton « authenticité » on s’en fout un peu dans la réalité vraie, il ne faudrait pas accrocher au fond du moule.
Le « nous offrons » est une caricature. Déjà tu n’offres pas, tu rémunères un travail.
- Déjà la première contrepartie que tu proposes c’est un salaire, du pognon ! Ça serait bien d’en parler là directement en donnant une fourchette, voir une grille précise et pas un râteau. Tu sais pour éviter les putains de 20% de différence entre hommes et femmes.
- Sur la flexibilité du travail « lieu et rythme », ça serait mieux d’être précis et cohérent. Flexible : c’est juste les horaires comme tous les cadres ou c’est télétravail, pendulaire, à 100%, ça peut être un 4/5 éme ? Et le lieu ? Parce qu’au début on a deux fois «Lille, Paris, Lyon ou Nantes » ce n’est pas à proprement parlé « hyper diversifié », là, c’est parti pour recruter des urbains.
- Mac ou PC, bah oui j’espère bien que je peux choisir mes outils et que si j’ai besoin de matos, il ne faut pas faire trente mille demandes.
- Équipe, ok
- Formations, je crois, bien que c’est une obligation légale de l’employeur.
On garde le meilleur pour la fin, le processus de recrutement :
- Un premier entretien
- Un « case-studies » donc plusieurs heures/jours de travail pour un post de lead ? On demande en gros à un lead de faire un boulot d’étudiant en faisant une étude de cas. Sérieusement ? La réponse est simple, soit le cas est trop simple et peut être traité sur un temps court, une journée max, et donc ça ne va rien montrer pour le recrutement, soit il est complexe, il faudra beaucoup de temps et ça n’a rien à faire dans un recrutement.
- 3 Entretiens avec des chefs : que des hommes, ça fait super envie, mais « qui se ressemble, s’assemble… »
- Une journée de visite à Lille. Pourquoi pas ? C’est au frais de Décathlon ?
Donc au bas mot 3 jours de disponibilité ou de boulot minimum… Si tu es déjà en poste, avec une famille, la charge mentale qui va avec et genre une femme. Ça va être un peu compliqué, non ?
En quoi ce processus assure d’embaucher le ou la meilleure candidate pour le poste ? Par exemple, les entretiens sont un très mauvais moyen pour faire un choix éclairé parmi de bons candidats. Combien de personnes sans doute parfaites, mais pas dans « la norme », pour le poste vont juste être rebutées par le processus ? Ce n’est pas comme si les « HEAD OF RESEARCH DESIGN » expérimentés ça couraient les rues. On est sur un marché de niche.
Et enfin il y a un truc qui s’appelle « la période d’essai » et qui est faite justement pour savoir si l’entreprise et la personne recrutée sont compatibles !
Globalement, cette annonce mériterait d’être rédigée plus sérieusement et plus en cohérence avec l’objectif de diversité. C’est décevant d’avoir une annonce générique à 50% pour un poste de ce niveau.
Quelques notions d’ergonomie 25 Jun 2021 12:07 AM (4 years ago)
L’expérience utilisateur puise une partie de ses méthodologies dans l’ergonomie, l’étude de l’humain au travail. Je vous propose donc découvrir quelques notions importantes liées aux situations de travail.
L’ergonomie telle qu’elle est pratiquée actuellement se base sur une observation des situations de travail afin d’en comprendre le déroulement, d’identifier les tenants et les aboutissants de l’écosystème que forme le travail. Donc en ergonomie, on parlera toujours d’un utilisateur, dans un contexte de travail, qui a une tâche à réaliser avec un outil.
C’est pour ça qu’un outil, par exemple une chaise, ne peut pas être ergonomique dans l’absolu. Une chaise de bureau va être ergonomique pour faire un travail de bureautique sur un poste informatique, mais elle sera inadaptée pour un vendeur dans un magasin qui devra régulièrement se lever et là où une chaise assis-debout sera plus adaptée. À l’inverse, un fauteuil bien confortable et profond sera parfait pour regarder un bon film chez soi.
Pour comprendre cela, il faut passer du temps à observer les situations de travail afin de pouvoirs les décomposer. En ergonomie, on est souvent appelé à intervenir sur des situations qui peuvent paraître simples au premier abord mais qui sont en réalité plus complexe qu’il n’y paraît.
L’importance du contexte
Une fois, je suis intervenu pour le compte d’une assurance. Alors qu’un nouveau système informatique était en cours de déploiement, on m’a demandé d’aller expertiser un service en particulier car celui-ci remontait de nombreuses difficultés avec le logiciel et les tensions sociales commençaient à poindre. Le service en question travaillait plus spécifiquement des collectivités publiques et des associations. Il ne recevait que très rarement des visiteurs et travaillait essentiellement à distance. Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, il donnait sur la zone d’accueil des clients classiques. La première impression en rentrant dans l’open space de ce service était une odeur de « présence humaine ». Les bureaux étaient relativement proches les uns des autres et ils disposaient tous d’un écran antibruit noir créant une atmosphère lourde. En observant la situation, en discutant avec les salariés, en regardant aux alentours. Je me suis aperçu que le nouveau logiciel n’était pas réellement le souci. Certes, il y avait quelques questions le concernant mais rien d’insurmontable. Le problème était ailleurs. C’est simplement que les toilettes étaient à l’autre bout du bâtiment. Il fallait donc passer dans la zone d’accueil pour y aller, se confrontant aux visiteurs qui attendaient et qui ne comprendraient pas pourquoi ils n’étaient pas reçus plus rapidement. Les salariés étaient donc confinés dans leur open space, mal à l’aise, ne pouvant se dégourdir les jambes ou simplement aller chercher un café et aller aux toilettes. Cela créait des tensions, un malaise diffus, rien de très marqué mais ça s’était exprimé sous la forme récrimination envers le logiciel. Mes recommandations ont porté beaucoup plus sur l’environnement physique de travail que sur les interfaces du logiciel.
La tâche : l’activité prescrite et réelle
Une notion qui importante aussi c’est la différence entre l’activité prescrite et l’activité réelle.
- L’activité prescrite c’est celle qui a été décidée par l’organisation et qui est écrite dans les consignes.
- L’activité réelle c’est qu’on observe sur le terrain.
Il y a toujours une différence entre les deux. C’est inévitable. Si tout se passait comme c’est écrit dans les manuels, aurait pas besoin d’humains pour s’adapter aux situations, les robots auraient envie le monde !
Par exemple, sur une aire de jeux pour enfants, un panneau précisait les conditions d’utilisation :
- “Interdit aux animaux” ; L’aire de jeux n’est pas clôturée.
- “Éviter les bousculades” ; On fait comment avec un groupe d’enfants en train de courir, de sauter et de jouer ?
- “Ne pas remonter les toboggans à l’envers” ; L’exemple parfait de la consigne qui ne sera jamais respectée.
- “Les jeux doivent être utilisés suivant l’usage pour lequel ils sont conçus” ; Oui, et l’usage c’est quoi ? Jouer ? Ça consiste en quoi “Jouer” ? Vous avez quatre heures…
- “Jeux conformes aux exigences de sécurités” ; Concernant le tourniquet qui datait au minimum de mon enfance soit plusde 30 ans, j’avais quelques doutes.
- “Les cordons d’anoraks, écharpes, capuches sont des causes fréquentes d’accidents” ; Fréquentes c’est à partir de combien ? Donc en hiver, ils ont le droit de jouer mais en tee-shirt.
Donc un bien bel exemple de consignes et de prescriptions qui ne seront jamais mises en œuvre car inapplicable pour la population et l’activité visée. Dans ce cas-là, la sécurité devait passer par la prévention du risque et la rénovation de l’aire de jeux, tous en considérant que l’imagination des enfants pour faire des bêtises ou inventer de nouveaux usages est sans limites.
Il faut donc prendre en compte que le service ou le produit que vous êtes en train de concevoir ne va pas être utilisé comme vous l’imaginez. Il va être détourné, malmené et utilisé à d’autres fins que celles prévues ! Mais tant mieux, c’est d’autant intéressant de découvrir alors ce qu’en font pour de vrai vos utilisateurs.
L’utilisateur
L’utilisateur est bien sûr au centre de la démarche en ergonomie. Il faut comprendre ce que regroupe la notion d’utilisateur, c’est en fait un ensemble diffus de personnes devant réaliser un travail. Et cet ensemble peut présenter une grande variabilité :
- Une variabilité entre les utilisateurs
- Une variabilité pour un même utilisateur
- Des novices et des experts
- Lié au contexte
Une variabilité des utilisateurs
Les utilisateurs entre eux présentent une grande variabilité, de par leur parcours de vie, les âges, leurs expériences passées. Ça implique donc de bien définir les groupes d’utilisateurs cibles. Si vous voulez faire un jeu pour les enfants de 5 à 7 ans, il faut prendre en compte que l’apprentissage de la lecture commence vers 6 ans et ne sera probablement pas vraiment maîtrisée à 7 ans. Il faudra donc présenter une interface qui se basera sur des dessins ou du vocal, mais qui pourra être complété par du texte relativement en court.
Cette variabilité peut s’exprimer sous différentes formes au sein d’un même groupe qui peut sembler homogène au premier abord, que ce soit les capacités physiques ou intellectuelles ou une combinaison des deux. Et des caractéristiques similaires peuvent aussi se trouver dans des groupes différents, par exemple les personnes âgées ont une vision des couleurs qui tend vers le vert, ainsi que certains hommes jeunes et moins jeunes qui ont des problèmes de perception des couleurs.
Un même utilisateur va aussi présenter des variations fortes.
- Ces capacités peuvent varier dans le temps, à courts termes. Si vous mal dormis, parce que vos enfants étaient malades la nuit précédente ou que vous avez fait la fête, vous aller être moins attentif et performant le lendemain.
- Les périodes d’attentions et d’inattention au cours de la journée sont connues, par exemple, en début d’après-midi après le repas il existe période favorable au relâchement, d’où la sieste postprandiale. Pour le travail de nuit, il faut s’intéresser aux cycles veille, sommeil et faire en sorte de ne pas trop les contrarier. Il est plus facile de repousser l’heure du réveil, que l’avancer.
- À moyen termes, il se peut aussi que divers accidents viennent réduire les capacités physiques ou intellectuelles des utilisateurs, temporairement ou non. Une mauvaise chute en faisant du sport et l’utilisateur se retrouve avec mobilité réduite, ou un bras dans le plâtre l’empêchant temporairement d’utiliser correctement un clavier. Un traitement médical lourd et l’utilisateur est rapidement fatigable.
- À longs termes, L’âge va apporter son lot de modifications. La presbytie, par exemple, commence à 40 ou 45 ans rendant difficile la vision de près, même si elle peut être en suite corrigée facilement.
Donc un même utilisateur va voir ces capacités évoluer dans le temps. Cela va lui demander alors de mettre en place des stratégies d’adaptations pour contourner les difficultés qu’il rencontre. Il peut reporter une tâche demandant de la précision un jour où il se sent trop peu attentif, ou trouver un moyen pour utiliser sa souris avec un bras plâtré.
Novice & expert
Il y a un élément important à prendre en compte aussi vis-à-vis de l’utilisateur. C’est le niveau de compétence de l’utilisateur par rapport à la tâche qui lui est demandé. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que c’est toujours vis-à-vis d’une tâche et ce n’est pas une généralité. On entend souvent que « les jeunes » sont des petits poucets (poucet : qui utilise intensivement ses pouces) qui seraient très à l’aise avec les outils informatiques. Ce n’est pas vraiment cela, ils sont globalement à l’aise avec les codes des réseaux sociaux et avec leurs manipulations, mais ils ne sont pas forcément compétents avec les outils informatiques. Demandez à un « jeune » ou un moins jeune, qui a pour doudou un smartphone, s’il serait capable de le démonter pour le réparer ou changer un composant ? La réponse est bien souvent : « non » ou dans le meilleur des cas « Attend, je vais regarder sur Youtube si je trouve un tuto ».
Donc l’utilisateur va voir des compétences dans son domaine professionnel, un comptable sera expert en comptabilité, un boulanger sera expert pour faire du pain, mais ils ne seront pas forcément experts pour utiliser des outils informatiques.
Il faut retenir que l’expert présente trois caractéristiques :
- La possibilité d’automatisation de ses comportements, avec donc une forte économie des moyens cognitifs à mobiliser pour réaliser les tâches courantes.
- La simplification opérative des procédures. L’expert va sauter des étapes ou du moins en faire d’autres qui seront plus économiques en termes de moyens.
- Des métaconnaissances (connaissances sur les connaissances) disponibles et bien utilisés qui permettent à l’expert de gérer ses ressources et de se constituer des heuristiques plus efficaces, notamment par analogies et généralisations.
Il est intéressant de pouvoir comparer les différences de stratégies entre un expert et un novice. Cela permet, dans une certaine mesure, de comprendre la genèse des compétences. C’est là qu’intervient l’ergonomie. Une bonne ergonomie permettra une prise en main rapide à l’expert avec une courte phase d’apprentissage et accompagnera le novice dans sa progression.
Une difficulté majeure dans la conception est de fournir un outil, un service qui soit à la fois facile à prendre en mains, suffisamment guidant pour le novice et qui soit adaptable et puissant pour l’expert.
Le succès de la tâche : l’utilisateur, le contexte, des outils, la tâche
Qu’est ce qui fait le succès d’une tâche ? En ergonomie, on va distinguer trois notions : l’efficacité, l’efficience, la satisfaction.
- L’efficacité : Certaines tâches ont un résultat binaire, réussite ou échec : Finir une commande sur un site ou finir une partie dans un jeu. On sait quand ça commence et on sait quand ça se termine.
- L’efficience : D’autres taches ne sont pas forcément aussi claires sur leur finalisation : Vous peignez un tableau, vous faites un dessin ? Quand est-ce qu’il est fini ? On peut donc parler aussi d’efficience, c’est-à-dire le rapport entre les moyens à mis en œuvre par l’utilisateur et l’ampleur de la réussite. Un étudiant qui passe les trois quarts du temps pour finir le premier exercice d’un devoir, c’est effectivement une réussite, mais c’est peu efficient. Et donc le devoir en entier peut être un échec. L’efficience n’est pertinente qu’en cas de réussite de la tâche. Par exemple, si on demande à un utilisateur de remplir un formulaire complexe et qu’il n’y arrive pas malgré ses nombreuses tentatives, on ne va pas prendre en compte son temps de réalisation car n’est pas finalisé la tâche.
- Un troisième facteur rentre aussi en compte c’est la satisfaction de l’utilisateur. Que l’utilisateur réussisse ou non la tâche, il va être plus ou moins content de l’expérience vécue. Il va exprimer un ressenti positif ou négatif vis-à-vis de ce qu’il vient réaliser. Un utilisateur peut parfaitement réussir une tâche et cela de manière performante, mais la trouver peu satisfaisante car c’est une tâche routinière sans grand intérêt pour lui. À l’inverse, il peut échouer mais se trouver très satisfait car il aura appris des choses ou sa curiosité a été aiguisée.
Les bons outils, dans le bon contexte pour la bonne tâche vont favoriser ces facteurs mais ne sont pas un gage de réussite absolue car l’utilisateur est toujours là avec sa variabilité. Une question qui est souvent posée à des dessinateurs ou des photographes de talents est « Mais quels pinceaux, quels matériels tu utilises ? » bien sûr ce ne sont pas les pinceaux qui font le talent, ou l’appareil photo qui fait le cadrage.
À retenir
- En ergonomie, on parlera toujours d’un utilisateur, dans un contexte de travail, qui a une tâche à réaliser avec un outil. Il n’y a pas d’outils ergonomiques dans l’absolu.
- Pour mesurer le succès d’une tâche on va s’appuyer sur trois critères :
- L’efficacité : réussite ou échec.
- L’efficience : rapport entre les moyens mis en œuvre pour l’ampleur de la réussite.
- la satisfaction de l’utilisateur.
- Les utilisateurs sont très variés même au sein d’une population qui semble homogène et un même utilisateur va évoluer à court ou à longs termes.
Des entretiens aux personas 12 Jun 2021 12:41 PM (4 years ago)
Vous avez réalisé vos entretiens. Vous avez recueilli pleins de données auprès des utilisateurs. Il va falloir les affiner et les mettre en forme afin que ces données puissent être utilisées par les différents intervenants du projet.
Ça va se faire en plusieurs étapes :
- Dans un premier temps il faut nettoyer les données et les organiser.
- On peut les compléter, les croiser avec des informations venues d’autres sources.
- Il faut ensuite construire des personas, qui sont une représentation type des utilisateurs.
- À partir de ces personas, on va décrire le parcours global de ces utilisateurs.
Faire le bilan des entretiens.
Vous venez de finir les entretiens, 5, 10 ou vingtaine peu importe. Vous vous avez à peu près mis ça au propre, suivant le mode de prise de notes que vous avez choisi. Au final, dans tous les cas, vous vous retrouvez avec un paquet d’informations.
À partir de là, vous avez à organiser cela pour que ce soit diffusable et utilisable avec auprès des autres personnes. Pour cela un petit nettoyage est nécessaire :
- Sur une vingtaine d’entretiens, il arrive qu’un entretien n’est aucun intérêt pour diverses raisons déjà évoquées que ce soit un mauvais recrutement, que l’utilisateur soit visiblement perturbé par l’entretien.
- Il faut anonymiser les entretiens, pas seulement supprimer le nom et le prénom, mais aussi supprimer les informations indirectes qui figurent dans l’entretien et qui permettraient de retrouver facilement l’utilisateur à partir de la liste initiale. Ça peut être un lieu d’habitation, les prénoms de proches cités, des habitudes particulières (si elles ne rentrent pas dans le champ de l’entretien) ainsi que toutes les informations de religions, de politiques et de sexualité.
- Si vous faites les entretiens dans le cadre d’une entreprise, soyez encore plus vigilants. Je vous déconseille de transmettre les retranscriptions des entretiens à l’entreprise. Il serait facile pour l’entreprise d’identifier chaque salarié et de se servir de ces entretiens contre eux, un jour ou l’autre.
- Si vous êtes plusieurs à faire passer les entretiens et à prendre des notes, le plus efficace est de faire une relecture croisée chacun relisant les notes des autres. Ça permet de prendre connaissance des autres entretiens ou de se les remémorer et en plus, on voit mieux les erreurs des autres que les siennes.
Il peut être aussi pertinent de faire un résumé de chacun des entretiens notamment si vous travaillez à plusieurs, cela permet de partager les principales informations recueillies dans chaque entretien.
Compléter et croiser les sources
Les entretiens ne sont pas les seules sources d’information dans un contexte « exploratoire ». Il est intéressant de diversifier les sources afin de les croiser et de les compléter. Ça va dépendre du sujet bien sûr mais on trouve généralement trois types de sources :
- Les traces de l’activité
- Les études scientifiques
- Les « communautés »
Les traces de l’activité
Globalement, les traces de l’activité correspondent à toutes les traces que les utilisateurs laissent plus ou moins volontairement suite à leur passage. C’est souvent une source riche d’information, mais elles peuvent prendre des formes très différentes. La plus classique dans le numérique est les statiques des visites du site (nombre de visites par pages, parcours, etc…) qui peuvent donner lieu à des analyses statistiques parfois automatiques avec par exemple Google Analytics.
Pour reprendre la liste des courses, les listes sont des traces de l’activité. Si vous récupérez des listes après usages, elles vont être raturées, cochées, pliées etc… Certains vont les avoirs organisés, d’autres seront en vrac ou avec une organisation très spécifique. Tout cela donne des informations sur les usages des utilisateurs, leurs habitudes et sur leur créativité pour contourner certains problèmes.
Si vous faites des entretiens sur le lieu de travail des personnes, vous pouvez aussi observer des traces de l’activité, ça peut être des post-it très classiquement avec l’identifiant le mot de passe du poste de travail, ou celui du chef qui permet de faire plus de chose ou encore l’accès au Wifi. Des cahiers avec les notes prises par la personne au cours de leur activité.
Les études existantes
Sur beaucoup de sujets, il est possible de trouver des études scientifiques, sociologiques, statistiques ou ethnologiques. Ces études ne vont pas être forcément très spécialisées sur la thématique que vous étudiez, mais elles peuvent donner un contexte plus global.
Par exemple, il y existe des études ethnologiques sur l’usage de la télévision dans les foyers ou sur l’usage des technologies (source Insee). Ces études ne vont pas porter précisément sur des problématiques d’interactions ou des problématiques liées à certains services. Mais elles vont expliquer les contextes d’usages possibles, seul ou en famille, les enjeux derrière le choix du programme regardé, qui détient la télécommande, est-ce qu’on regarde la télévision en mangeant ou non ? Ça donne des éléments de contexte et une culture de la situation.
Pour la liste de course, il y a bien sur des statistiques que ce soit sur la consommation des ménages, les temps de trajets, la part des courses en lignes ou les nouvelles habitudes de consommations. L’INSEE par exemple publie Les comportements de consommation en 2011.
Il existe aussi de nombreuses publications ou d’études professionnelles parfois payantes et relativement chères, parfois gratuites. Ça peut prendre la forme d’étude complète sur un domaine en particulier ou de magazine avec une publication régulière concernant une profession. Vous y trouverez souvent des actualités mais aussi des statistiques précises et à jour sur le domaine que vous étudiez.
Les communautés
Quelles soient formelles comme des associations ou informelles sur des réseaux sociaux ou des forums, les communautés d’utilisateurs sont souvent une source inépuisable d’informations auprès de personnes très, voir trop au courant des problématiques. Je vous propose deux exemples qui peuvent vous donner des idées concernant les communautés.
J’ai eu à réaliser une mission pour une chaîne de distribution de matériaux de construction et de bricolage. J’ai bien sûr réalisé des entretiens auprès de divers corps de métiers concernés par la construction. J’ai pu compléter ces informations notamment en allant parcourir les forums parlant de bricolage. On y retrouve des particuliers, des semi-pros qui échangent sur leurs besoins et leurs réalisations. Ils y racontent aussi les difficultés qu’ils rencontrent et l’aide qu’ils ont trouvé sur le forum ou en magasin.
Certains logiciels open source comme Prestashop, permettant de faire des boutiques en lignes, ont une communauté d’utilisateurs importante avec qui il est possible d’échanger. Cette communauté est fortement engagée car pour la majorité Prestashop est un outil essentiel pour leur travail quotidien. Ils revendiquent plus d’un million de membres.
Créer des personas
Les personas sont des représentations des utilisateurs. L’idée est de partager avec les équipes d’un projet les connaissances que vous avez recueillies sous la forme d’un portrait de chacun des types d’utilisateurs. Globalement les personas permettent de :
- Créer une représentation parlante des utilisateurs finaux, pour les intervenants sur un projet.
- Partager, communiquer autour de ces profils utilisateurs, pour sensibiliser à l’expérience utilisateur.
- Faire des choix de conceptions en fonction de ces personas, et non en fonction des idées ou des choix de telle ou telle personne.
Pour créer ces personas, il va donc falloir extraire des données que vous avez recueilli les principaux traits pertinents qui vont constituer et différencier vos personas.
Traiter les données, faire émerger les personas
Un post-it = une idée
Pour plus lisibilité de loin, écrire en majuscule
Le processus pour traiter les entretiens et les informations sur d’autres sources est le suivant :
- Vous allez reprendre chacun des entretiens. À chaque fois, vous noter sur un post-it les éléments significatifs. Vous prenez une couleur de post-it par utilisateur ou si besoin vous prenez un code pour identifier chaque utilisateur. Si vous êtes plusieurs à faire passer les entretiens c’est aussi intéressant de le faire apparaître avec un petit signe distinctif. Un élément peut être par exemple :
- La fréquence d’usage « je fais les courses deux fois par semaine »
- Le type de course « je fais les grosses courses au drive et l’alimentaire au marché le samedi » ça fait deux post-it
- « J’organise ma liste de course en fonction des rayons »
- « Si il fait beau, je prends mon vélo aller faire mes courses »
- Vous allez donc vous retrouver avec un grand nombre de post-it pour chaque entretien. Il faut maintenant les regrouper sémantiquement. L’idéal pour ça est de disposer d’un grand mur, un outil de tableau blanc comme Miro ou Mural, permettant de coller les post-it pour les voir tous. Le premier designer va coller ses post-it en indiquant le contexte et ce qu’il signifie. Il va organiser ses entretiens et regrouper les post-it qui parlent d’un même sujet. Les autres designers vont compléter les groupes avec leurs propres post-it et dire le lien, et ainsi de suite. Une fois que tous les post-it sont collés, on fait une deuxième, voir une troisième passe pour affiner les regroupements. Certains post-it peuvent rester orphelins, on n’en teindra pas compte pour la suite, mais on les garde quand même, car ils peuvent représenter une situation particulière ou une idée inédite.
- Vous allez maintenant détailler chaque groupe de post-it. Pour chacun, il faut trouver un titre et axe répartition. Certains sont assez évidents, comme la fréquence, avec d’un côté « Je fais les courses tous les jours » et de l’autre « je fais les courses une fois par mois ». Pour d’autres regroupements, cela peut-être un peu plus complexes. Par exemple, l’organisation de la liste ne va pas se réduire à organisée/pas organisée, mais sera plus probablement sur un axe « En fonction du magasin/ En fonction du contexte utilisateur ». Sur les contraintes autour de la liste de courses, on peut trouver un axe « Budget / Bio et qualité »
- Une fois les axes établis, il faut reprendre les post-it et les positionner correctement sur les axes. Il faut parfois inverser certains axes afin de les rendre plus cohérents avec les autres axes.
- En prenant du recul, avec les différentes couleurs des post-it, vous allez voir des motifs se former, plusieurs utilisateurs vont avoir répondu de manières assez proches sur plusieurs axes dégageant ainsi des profils d’utilisateurs types.
Sur la liste des courses, on peut par exemple trouver un persona « Budget serré » qui va peut-être être très organisé pour gérer ses dépenses, respecter strictement sa liste de course et utiliser au maximum les promotions ou un persona « Gourmet » qui au contraire à une liste minimum et qui va faire ses courses au gré de ses envies et des produits disponibles.
Une vidéo produite par Julien Champagne explique le processus :
Combien de personas pour un projet ?
C’est une question qui revient souvent. Dans la pratique, le nombre de personas tourne souvent autour de trois ou quatre. S’il y a trop de personas, il est probable que certains soient trop précis ou trop complexes et pas assez générique. Le persona perd alors de son intérêt aussi bien en termes de communication que pour la conception du projet.
Donc idéalement, on va faire 2 personas principaux qui sont le cœur de cible du projet et deux personnes secondaires qui viennent compléter le panorama en donnant des informations sur des cibles spécifiques.
Par exemple, sur la mission pour une chaîne de distribution de matériaux de construction, on avait initialement trois personas : l’artisan, le castor (amateur qui fait tout), la bricoleuse. Après la phase de recherche, on a ajouté deux persona : le couple qui rénove avec des matériaux écologiques et le rentier qui gère un parc de logement qu’il rénove régulièrement. Donc au final, on a trois personas principaux qui représentent les clients « classiques » et deux personas secondaires représentant deux niches qui peuvent être des relais de croissances.
Il peut être aussi intéressant de faire un « anti-persona ». C’est-à-dire une représentation de l’utilisateur qui va se trouver plein de bonnes raisons de ne pas utiliser le service ou le produit que vous proposez. Ça permet souvent de donner un point de vue décalé sur ce qu’on fait et d’identifier des failles ou des points de blocages qui passent inaperçus pour les autres utilisateurs.
Finaliser les personas
Une fois vos personas définis, il va falloir les rendre lisible pour tout le monde. Le persona est généralement représenté sous la forme d’une page présentant ses principales caractéristiques. Il faut penser cette fiche persona comme un outil de conception mais aussi un outil de communication.
Quelques modèles de personas sont disponible dans cet article sur le sujet.
Les points suivants sont abordés, mais ils ne sont pas tous forcément présents :
- Une photo ou un dessin représentant le portrait du persona
- Son état civil : nom, prénom, âge, situation familiale et sociale, métier ou niveau scolaire, lieu d’habitation,…
- Un slogan qui résume les attentes du persona : « Des économies à tout prix » (Oui, on est designer pas forcément publicitaire !)
- Une biographie racontant l’histoire du persona par rapport au service. Cette biographie doit s’appuyer sur des éléments que vous avez recueillis lors des entretiens, mais il y a toujours une part de réécriture afin d’en faire quelque chose de cohérent.
- Les objectifs de l’utilisateur, par rapport à votre problématique, mais ça peut être des objectifs très larges. « Je veux que ma famille soit en bonne santé, pour ça j’achète que des produits bios. »
- Les attentes : C’est généralement les attentes vis-à-vis du service « la liste de course doit me permettre de faire des économies et de me faire gagner du temps »
- Les frustrations : « J’oublie toujours quelque chose » « Il y a toujours un produit qui manque, qui n’est pas rayon » C’est souvent des freins à l’usage, des éléments qui vont ralentir l’utilisateur dans ce qu’il veut faire.
- L’expérience idéale : Ça peut être directement issu d’une question de l’entretien « Idéalement, comme ça se passerait pour vous ? »
- Le niveau de compétence dans certains domaines : Ces informations vont permettre de cerner les capacités d’adaptations de l’utilisateur. Par exemple, il peut être très bon en informatique, mais médiocre dans la compréhension des réseaux sociaux et excellent en cuisine !
- Les produits et services types utilisés (Téléphone, magasin fréquenté, Service en ligne : Blablacar, AirBnB,… ) : Ça permet de renseigner sur le style de vie de l’utilisateur, s’il est urbain ou rural, s’il suit la dernière mode ou est au contraire réfractaire au changement.
Cette liste n’est pas exhaustive bien sûr ! Doit s’adapter au projet et aux personnes qui vont les utiliser. Vous pouvez faire des personas très simple, d’autres complexes ou encore des personas très graphique et illustré ! De plus ces personas peuvent évoluer avec le temps, certains designers les font vieillir et évoluer en fonction des mises à jour du service.
À retenir
Les entretiens exploratoires sont une source riche d’information qu’il peut être difficile d’exploiter correctement.
- Des sources complémentaires peuvent venir poser un décor autour de ces entretiens et valider ou préciser certaines impressions.
- Les personas ne sont pas inventés mais construit sur la base des entretiens. Ils doivent représenter des typologies d’utilisateurs.
- Il n’y a pas un modèle de personas, un modèle qui sera adapté à votre projet et à ce que vous voulez communiquer au sujet des utilisateurs.
Exercices – 02 – Entretiens 8 Jun 2021 9:03 AM (4 years ago)
Quelques thèmes pour pratiquer incognito…
Si vous voulez vous exercer dans la pratique des entretiens, je vous propose quelques thèmes qu’il est facile d’aborder avec des proches ou des connaissances, sans forcément se lancer dans quelque chose de très formel. Dans les sujets qui sont « faciles » à évoquer, je vous propose les suivants :
- La pratique de la photo numérique : tout le monde à téléphone qui fait des photos dans sa poche ou presque, il est alors facile d’aborder le sujet, puis de questionner sur les usages, les types de photos, la diffusion etc…
- Les transports en commun, au sens large, trains, bus, mais aussi vélos, si vous habitez dans une grande ville, c’est un sujet intarissable d’anecdotes plus ou moins drôles et d’améliorations possibles.
- Les sujets autour de la transition écologique : Sujet d’actualité qui permet d’avoir des retours sur une grande diversité de comportements.
Faites des entretiens courts de 10 à 20 minutes pour commencer. Cela vous évitera d’être submergés d’informations au début, puis allonger progressivement la durée des entretiens quand vous avez pris le coup de main.
Réaliser des entretiens avec les utilisateurs 8 Jun 2021 8:51 AM (4 years ago)
L’entretien avec les utilisateurs est la technique de base à maîtriser quand vous faites de l’UX. Elle sert tout le temps. Si elle ne vous sert pas, c’est que vous ne voyez pas les utilisateurs et donc que vous ne faites pas l’UX.
Je vais donc vous expliquer comment réaliser des entretiens exploratoires, le cadre d’un projet. Mais l’attitude que vous allez adopter lors de ses entretiens est aussi valable pour toutes les fois ou vous rencontrez des utilisateurs.
À ce sujet, il est de votre devoir d’avoir une attitude irréprochable vis-à-vis vos utilisateurs. Cela veut dire un strict respect de la confidentialité et de l’anonymat et plus globalement de la confiance qu’ils vous accordent. Mais ça veut aussi dire que vous n’allez porter aucun jugement de valeurs sur ce qu’ils vont vous dire, sur ce qu’ils sont, sur les histoires qu’ils vont vous raconter ou sur leurs capacités physiques ou cognitives. Neutre et bienveillant sont les maîtres-mots lors des entretiens avec les utilisateurs. À ce sujet vous pouvez consulter le code de conduite l’UXPA, qui précise les différents points et les règles à respecter. Si vous n’êtes pas capables de respecter cela en permanence, faites un autre métier qu’UX designer.
Ceci dit revenons à nos entretiens. Le but de ces entretiens exploratoire est de découvrir l’activité des utilisateurs. Quand on commence un nouveau sujet, un nouveau projet, on a souvent des idées près conçues qui sont le reflet de nos expériences passées bonnes ou mauvaises. Il va falloir essayer de faire table rase de ces idées pour les remplacer par une connaissance précise, scientifique des usages en vigueurs dans le contexte des utilisateurs. Pour cela, il faut procéder à des entretiens individuels avec les utilisateurs potentiels du service ou de l’application que l’on est en train de concevoir.
Pour illustrer cela, je vous propose de prendre l’étude de cas de la liste de course et de dérouler cela. Donc le contexte est le suivant :
Votre agence travaille pour une enseigne de la grande distribution (Ex : Leclerc, Carrefour, Intermarché). Cette enseigne dispose de magasins de différentes tailles allant d’hypermarchés au magasin de proximité en passant par le Drive et bien sûr le site internet. Elle souhaite fournir à ses clients un service autour de la liste des courses. L’enseigne avait déjà fait un travail préalable sur la liste des courses, mais ça, c’est relevé être un échec et l’idée a été abandonnée provisoirement. Votre agence vous demande de travailler « en amont » sur le sujet pour proposer une expérience utilisateur cohérente autour de la liste des courses et d’éviter un nouvel échec. L’objectif est de proposer quelque chose de cohérent aux utilisateurs d’ici un an.
L’objectif va donc être de recueillir les usages autour de la liste de course : comment les personnes s’organisent ou pas pour la faire ? comment ils l’utilisent ? Sur quels supports ? Quelles sont leurs habitudes autour de cette liste ? Des usages collaboratifs ? etc… Le but des entretiens va être de recueillir tous ces usages sans aucun a priori. Les personnes qui n’utilisent pas de listes de courses sont aussi intéressantes à interroger pour comprendre comment ils fonctionnent ou quels sont les freins qu’ils rencontrent.
Avant les entretiens
Avant les entretiens, il va falloir faire plusieurs choses :
- Trouver un lieu pour les entretiens
- Recruter les utilisateurs
- Écrire le guide d’entretiens
- Un accord de participation
- Un dédommagement pour les utilisateurs
- Enregistrement audio
Le lieu
Deux solutions se présentent à vous pour les entretiens, soit vous les faites en présentiel, soit à distance en visioconférence.
En présentiel, il vous faut trouver un lieu calme, facilement accessible pour vos utilisateurs. Si vous êtes dans une entreprise, une salle de réunion conviendra parfaitement, sinon les espaces de coworking sont des lieux propices pour les entretiens et ils louent souvent des petites salles de réunion. Je vous déconseille les cafés et autres bar. C’est souvent bruyant, avec du passage. Vos utilisateurs et vous-mêmes, vous serez déconcentrés et vous ne serez pas forcément évidents à trouver.
Pour commencer à faire des entretiens, je vous déconseille la deuxième solution. C’est souvent plein de petits problèmes techniques à résoudre et ça donne une situation un peu artificielle. Garder à l’esprit que c’est possible, mais dans un premier temps vous pouvez le réserver aux personnes que vous connaissez par ailleurs et qui seront déjà à l’aise et contente de vous voir.
Recruter les utilisateurs
Pour recruter les utilisateurs, la difficulté récurrente est de trouver des utilisateurs qui vont être représentatifs du public visé. D’une manière plus générale, il faut envisager de recruter entre 10 et 20 utilisateurs. Une vingtaine d’utilisateurs va vous permettre d’avoir un échantillon assez grand pour avoir une certaine diversité. Si l’échantillon est plus grand, vous allez y passer beaucoup de temps et donc ça va devenir coûteux, sans forcément apporter des informations nouvelles. Vous allez commencer à tourner en rond. Il est alors préférable de changer de méthodes, par exemple en faisant un questionnaire.
Donc pour recruter les moyens sont les suivants :
- L’entourage et les relations professionnelles ou personnelles
- Les réseaux sociaux, les forums ou les lieux où certains publiques se retrouvent. Votre service est destiné à des étudiants ? Allez dans une école ou une université pour recruter, ou passez par une association d’étudiants.
- Les entreprises spécialisées dans le recrutement de panels. C’est bien sûr plus coûteux, mais elles s’occupent aussi de les appeler, de les faire venir, de vous proposer des locaux adaptés, etc… Dans un cadre professionnel, c’est souvent la solution la plus simple.
Pour la liste de course, si vous interrogez que des personnes de votre entourage, elles vont avoir probablement un mode de vie proche du vôtre, avec le même niveau social, le même environnement urbain ou rural, etc… C’est un début, mais ça ne va pas représenter une diversité suffisante. Votre entourage peut être une piste pour vous entraîner à faire passer des entretiens, mais il faut aussi arriver à interroger des personnes que vous ne connaissez pas. Il va donc falloir en trouver d’autres à interroger.
Écrire le guide d’entretiens
Le guide d’entretiens va vous donner une trame à suivre, mais ça ne doit pas être un script à dérouler ! Nous verrons ensuite comment le rédiger, mais garder à l’esprit que c’est essentiel pour le bon déroulement des entretiens. Ça vous servira dans les moments où il faut relancer l’utilisateur et ça vous permettra d’avoir un socle d’informations communes pour tous les entretiens. Il faut compter un à deux jours de travail pour rédiger le guide, le faire relire, et éventuellement le compléter.
Un accord de participation
Vous devez avoir l’accord écrit de vos participants pour les entretiens, il faut donc leur faire signer un document précisant dans quel cadre vous aller faire ces entretiens, comment vont être utilisées les données recueillies, comment elles vont être anonymisées, etc… Si l’utilisateur ne veut pas signer, ce qui est strictement son droit, l’entretien s’arrête là.
Un dédommagement pour les utilisateurs
Les utilisateurs vont vous consacrer du temps, peut-être se déplacer pour venir vous voir. Il est donc logique de prévoir un dédommagement pour les utilisateurs. Généralement, c’est sous la forme de cartes-cadeaux allant de 20 à 150 € suivant la durée de l’entretien et le profil recherché, mais ça peut aller de simplement offrir une boisson à une rémunération réelle.
Enregistrement audio
Il peut être intéressant de réaliser un enregistrement audio des entretiens. Ça vous permettra d’écouter par la suite les passages que vous manquez lors de l’entretien. Pour faire les enregistrements, un simple smartphone suffit avec un micro dédié si vous êtes dans un environnement bruyant. Il faut bien sûr l’autorisation de l’utilisateur. Je vous déconseille par contre de faire un enregistrement vidéo, car ça va être assez envahissant et vos utilisateurs pourraient être mal à l’aise, là ou un simple micro se fait oublier.
Comment se déroule un entretien ?
Précisions :
- Les entretiens sont individuels.
- Ils durent 45 minutes généralement, un peu plus d’une heure si le sujet est complexe ou si l’utilisateur a beaucoup à dire.
- Vous ne pourrez pas faire plus de 4 ou 5 entretiens dans une journée. Ça demande beaucoup d’attention. C’est fatigant.
Le déroulement d’un entretien est généralement le suivant :
- Vous accueillez l’utilisateur, vous présentez et vous expliquez dans quel cadre vous travaillez et le but des entretiens. Vous vous occupez des aspects administratifs.
- Les premières questions vont vous permettre de faire connaissance et de détendre un peu l’atmosphère. Cela vous permet aussi de trouver le bon rythme que vous voulez donner à l’entretien.
- En suite, vous attaquez la partie principale de l’entretien. Dans un premier temps il faut inciter la personne à évoquer largement le sujet. Puis vous allez revenir sur certains points que vous souhaitez préciser ou que vous n’avez pas encore abordés dans votre guide d’entretien.
- Enfin, vous concluez l’entretien et vous remerciez l’utilisateur.
Le guide d’entretien
Il faut maintenant rédiger le guide d’entretien qui va suivre le déroulé ci-dessus, en plus détaillé.
L’accueil
Vous pouvez rédiger le texte d’accueil :
- Vous présentez, rapidement mais honnêtement : « Bonjour, je suis Raphaël, je travaille pour la société Bidule, qui a été mandatée par la grande entreprise Machin, pour réaliser ces entretiens. »
- Il faut préciser à l’utilisateur le cadre de l’étude, comment vont être utilisées les données recueillies, comment elles vont être anonymisées et globalement à quoi ça va servir.
- Vous demandez à l’utilisateur s’il a des questions par rapport à ce que vous venez d’expliquer.
- Vous demandez aussi spécifiquement le droit de l’enregistrer.
- Ça vous permettra d’aboutir à la signature de l’accord de participation, ou non. S’il refuse de signer, prévoyez aussi comment procéder. Est-ce que vous lui donnez quand même le dédommagement ou non ? Ou juste une partie ?
- Vous pouvez prévoir une liste de tâche à valider, pour être sûr de rien oublier, car ça ne va pas nécessairement se passer dans l’ordre prévu. Sinon ça ne serait pas drôle !
- Présentation
- Café, boisson, gâteaux
- Présentation de l’étude
- Enregistrement
- Accord de participation
Le corps de l’entretien
Les entretiens dans la phase exploratoire sont des entretiens non-directif ou semi-directif. En clair ça veut dire que vous ne suivez pas un script défini comme des téléopérateurs cherchant à vous vendre des fenêtres ou des assurances, mais que vous allez rebondir sur les propos de l’utilisateur, pour explorer votre thématique.
Donc, nous reprenons le thème de la liste de course. Vous allez commencer par quelques questions qui vont vous permettre de connaître votre utilisateur. Généralement, ces questions ont été posées lors du recrutement, mais ça vous permet de commencer et d’être sûr d’avoir les bonnes informations. Ça peut être par exemple :
- Est-ce que vous pouvez me dire votre âge ?
- Votre profession ? Ou votre ancienne profession si vous êtes à la retraite.
- Où est ce que vous habitez ? Où est ce que vous travaillez ?
- Votre situation familiale ? En couple, des enfants, etc… ?
- Vos habitudes alimentaires ?
Après vous allez commencer à aborder la thématique qui nous intéresse, en l’occurrence les courses, peut être aussi l’alimentation afin de connaître les habitudes globales de l’utilisateur. Avec les questions suivantes :
- Comment vous organisez pour faire vos courses ?
- À quelle fréquence ? Plusieurs fois par semaine ? Un jour précis ?
- Dans le couple, qui fait quelles courses ? Ça change ?
- Vous allez où pour faire vos courses ? Alimentaires ? Non alimentaires ?
- Est-ce que vous planifiez vos repas/menus ?
Puis vous allez attaquer plus spécifiquement la liste de course :
- Comment vous établissez votre liste de course ? En famille, comment ça se passe ?
- Est-ce que vous pouvez me montrer un exemple de liste de course (demander à l’avance à l’utilisateur de les apporter) ?
- Vous utilisez une application ? Ou une messagerie ? Pour les partager ?
- Si/quand vous faites des courses en ligne, vous procédez comment ?
- Si/quand vous ne faites pas liste, comment procédez-vous ?
Enfin vous pouvez prévoir des questions supplémentaires ou des petits exercices :
- Est-ce que vous me décrire votre organisation type sur une semaine ? Vous lui présentez une semaine et vous lui demandez de remplir ou pas chaque jour.
- Comment vous procédez avec votre liste une fois en magasin ?
- Ça serait quoi pour vous la liste de course idéale ?
La conclusion
Pour conclure, quand vous avez parcouru toutes vos questions ou que la durée de l’entretien approche de sa fin, vous demandez à l’utilisateur s’il a des questions et s’il veut ajouter quelque chose que l’on aurait oublié.
- Vous le remerciez
- Vous lui donnez la compensation, si vous l’avez pas fait au début.
- Vous le remerciez (c’est jamais de trop)
- Vous le raccompagnez… Et là attention, il va encore vous dire des choses, ou revenir sur un sujet, et ça va être sans doute le plus intéressant, donc restez attentifs.
En résumé, le but est de recueillir une ou plusieurs expériences de l’utilisateur vis-à-vis de votre sujet. On va donc l’inciter à raconter un moment vécu, une habitude. On va privilégier les questions ouvertes et toutes les réponses sont bonnes. Il faut essayer d’identifier :
- Les usages actuels
- Les contraintes, peurs, barrières
- Les besoins, les manques
- Les éléments récurrents et les fréquences d’usages
- les influences extérieures
Il est toujours intéressant de proposer à l’utilisateur d’imaginer l’expérience idéale, la situation rêvée ou à l’inverse la pire situation vécue.
Petit point pour la prise de notes : numérotez les questions, cela vous permettra de faire le lien entre la question et la réponse.
Mener l’entretien
Pour vos premiers entretiens et par la suite, il peut être intéressant d’être en binôme pour les mener. Le premier va poser les questions et relancer et l’autre va plus jouer le rôle de secrétaire et prendre des notes. Le secrétaire pourra aussi poser des questions bien sûr, ou prendre le relais à certains moments. Je ne vous dirais pas de jouer « au bon policier et mauvais policier », mais le fait est que chacun à un style dans la manière de poser des questions et d’écouter, il peut être intéressant de jouer avec. Le fait d’être deux permet aussi de croiser les impressions après l’entretien.
Toujours est-il, seul ou à deux vous devez avoir l’attitude suivante :
- Neutre : C’est la base, mais concrètement ça veut dire quoi ? Neutre, vous ne portez pas de jugement sur ce que dit l’utilisateur et même si c’est inévitable de porter une appréciation. Mais surtout vous ne l’exprimez pas à l’utilisateur. Il peut y avoir un moment ou vous vous dites « Heu, ce n’est pas très intéressant ce que tu me racontes là » ou « Ha, mais là clairement tu tiens des propos racistes ». Dans ce cas, il faut savoir rebondir et relancer sur un point différent : « J’entends bien ce que vous dites, et par contre sur ce point-là comment vous faites ? »
- Bienveillant : En clair, il faut veiller à ce que ça se passe bien pour l’utilisateur, donc lui éviter au maximum toutes situations inconfortables et trop stressantes, mais aussi le réconforter et l’encourager. Attention, bienveillant ne veut pas dire naïf et qu’il faut accepter n’importe quoi. Il faut aussi clairement poser le cadre de l’entretien et si besoin le rappeler. Ça ne nécessite parfois un peu de fermeté et d’aplomb de votre part.
- Naturel et poliment curieux : La discussion que vous avez avec l’utilisateur doit se dérouler de manières naturelles, comme si un collègue vous racontait ses vacances ou ses soucis personnels. Il ne faut pas s’accrocher au guide d’entretiens mais laissez se dérouler l’entretien en posant les questions qui vont vous permettre de le guider et de recueillir les infos.
- Les faits, rien que les faits, il faut avoir une approche scientifique. Vous devez intéresser aux faits et laissez de coter au maximum les éléments secondaires qui seraient des interprétations. L’idée c’est de se conduire comme Sherlock Holmes, d’essayer d’être le plus factuel possible.
Lors de l’entretien, il va inévitablement y avoir des phases où l’entretien va ralentir, où l’utilisateur ne va plus savoir quoi dire. Il faut alors relancer l’entretien, pour ça il existe quelques techniques simples à maîtriser.
- Le silence vous dites simplement « Oui, et … », « Je comprends, … » et vous laissez le silence s’installer. Vous pouvez continuer de noter si vous êtes mal à l’aise avec le silence, ça sera aussi le cas de l’utilisateur et va naturellement reprendre et continuer d’expliquer ce qu’il était en train de décrire. La maîtrise du silence, accompagner d’un regard attentif, permet aussi de faire comprendre à son interlocuteur qu’on l’écoute vraiment.
- Reformuler, résumer « Si j’ai bien compris ; vous …» Vous reprenez ce qu’a dit l’utilisateur avec vos propres mots et en rappelant les principaux éléments que vous avez retenus. L’utilisateur va alors préciser certains points ou vous corrigez si vous avez mal compris. Cet exercice est particulièrement intéressant car il vous permet de vous assurer que vous avez bien compris et il montre à l’utilisateur que vous avez écouté, ou si vous loupez des choses, vous assumez et il est encore temps de compléter.
- La clarification « Que voulez-vous dire par là ? » Vous revenez sur un point et vous demandez à l’utilisateur de clarifier. « Vous dites que vous organisez votre liste de course ? Est-ce que vous pouvez m’en dire plus ? Ou me donner un exemple ? »
- L’écho Vous reprenez la dernière phrase dites « – Et à un moment, on a arrêté de travailler. » « Arrêté de travailler ? » et là normalement l’utilisateur va préciser et continuez ce qu’il était en train de dire.
- Exprimer un sentiment « Et ça vous attriste ? » L’exercice est parfois un peu difficile car il faut exprimer un sentiment, ce que la personne aurait ressenti, et non une critique. Mais cela permet d’aborder les aspects hédoniques d’une expérience. Le but est bien de connaître l’état émotionnel de l’utilisateur à un moment du parcours, donc à ne pas confondre avec votre sentiment sur ce qui est raconté.
Pour résumer, cela peut paraître compliqué de mener des entretiens après avoir lu ces conseils. Il faut vous rassurer, considérer juste cela comme une discussion sur un sujet avec un proche. Commencez par le faire avec des personnes que vous connaissez et en fin d’entretien demandez-leur, quels ressentis elles ont de l’entretien et comment vous pourriez vous améliorer ?
Prise de notes et enregistrement
Lors de l’entretien, vous allez prendre des notes. Comme évoqué précédemment si vous êtes deux, ça facilite grandement les choses, mais dans tous les cas vous devez prendre des notes. Pour cela, il existe plusieurs méthodes suivant les objectifs que vous avez. Par contre, je vous déconseille de prendre des notes directement sur un ordinateur, même si vous tapez rapidement sans regarder le clavier, car ça va former une « barrière » entre vous et votre interlocuteur.
Vous pouvez donc envisager les solutions suivantes :
- Le guide d’entretien avec la place pour les réponses : Tout simple, vous prévoyez de la place entre les questions du guide d’entretiens pour les réponses et quelques pages blanches pour les notes diverses. Ça permet de suivre votre guide. Si vous êtes plusieurs à faire passer les entretiens vous devriez retrouver les réponses dans le même ordre. C’est parfait, sauf que … Et bien, vous n’allez pas suivre le guide d’entretiens pile poil dans l’ordre. Donc parfois il va falloir jongler un peu retrouver la question qui avec la réponse que vous donne votre interlocuteur. Et vous allez aussi poser des questions nouvelles, c’est pour cela qu’il faut prévoir quelques feuilles blanches. La variante, c’est de remplir uniquement les questions fermées du début sur le guide et de faire les autres questions sur papier libre en notant les numéros des questions. Si vous enregistrez en même temps, il peut être intéressant de noter le temps quand l’utilisateur développe une réponse particulièrement intéressante. Comme cela, vous pouvez aller réécouter directement le bon passage.
- Les post-it : Si vous faites des entretiens en mode « fait maison » ou guérilla, vous pouvez essayer de noter directement les idées principales qui ressortent de vos entretiens sur des post-it en respectant le principe une idée/un post-it. Ça permet de passer directement à la phase suivante de restitutions des usages. Si vous ne vous sentez pas assez agile pour le faire directement, rien n’empêche de le faire par la suite sur la base de vos notes ou de l’enregistrement. Pensez alors utiliser un code couleur ou un pictogramme, un utilisateur correspondant à une couleur ou un pictogramme.
- Sketchnotes : C’est bien beau de prendre des notes, mais c’est pour en faire quoi ? Que vont devenir vos comptes rendus d’entretiens ? Oui, parce que très souvent, ils ne vont jamais être relus. Oui jamais. C’est la dure réalité de la vie d’UX designer. Alors, je vous propose de faire autrement. Un des usages du sketchnote, la prise de notes graphiques, était justement de faire des comptes rendus de réunions qui soient lisibles et relues. Ça correspond exactement à la problématique des entretiens. Il faut par contre un peu d’entraînement pour réaliser directement les comptes rendus en sketchnotes, mais souvent ça permet aussi d’illustrer certaines situations. Par exemple : « Ma liste de course est organisée comme ça : en haut à droite l’alimentaire, en haut à gauche le frais, au milieu » il est beaucoup plus parlant de dessiner la feuille et de placer juste « alimentaire » « frais » au divers emplacement. Ces restitutions visuelles pourront être aussi affichées dans un espace de co-conception ou servir de support pour la restitution des entretiens. Ils seront par la suite beaucoup plus utilisés qu’un simple compte rendu écrit.
- Retranscription des enregistrements : Dans certains, on va vous demander de retranscrire l’ensemble de l’entretien. Sincèrement, c’est long et fastidieux. Sauf que depuis quelque temps, la reconnaissance vocale marche de mieux en mieux et se démocratise. Il est aussi possible de détourner des outils comme le sous-titrage automatique de You-tube pour produire le gros de la retranscription. Il faut corriger par la suite, mais ça peut faciliter grandement le travail. Bien sûr Cela marche mieux avec un enregistrement de qualité sans bruit de fond. Ces retranscriptions peuvent donner lieu par la suite à une analyse sémantique détaillée mais cela reste très rare ou dans un cadre universitaire.
Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises de retranscription des entretiens. Il faut par contre réfléchir avant les entretiens à ce que vous voulez en faire après et adopter le bon moyen en fonction du temps et du budget dont vous disposez.
Les erreurs à ne pas commettre
Il y a quelques erreurs qu’il faut essayer d’éviter quand vous débutez dans la passation des entretiens :
- Certains sujets sont délicats avec certaines personnes Parler de garde d’enfants avec une femme qui n’arrive pas à en avoir, parler d’alimentation avec quelqu’un qui a des troubles du comportement alimentaire… Dès que vous avez détecté le problème, soit vous changez de sujet (vous vous excusez) parce que c’est secondaire, soit vous proposez d’arrêter l’entretien, soit vous écourtez proprement l’entretien. En aucun cas vous ne devez mettre l’utilisateur mal à l’aise et encore moins en souffrance.
- Donner la réponse dans la question : « Est-ce que cela s’est bien passé ? » La question donne le sens de la réponse : « bien ». Il faut mieux demander « Et comment ça s’est passé ? » là libre à l’utilisateur de dire si c’était positif ou négatif. Il est parfois difficile de formuler la question correctement dès le départ, mais vous pouvez l’atténuer donnant des nuances : « bien, médiocre, mal, … , expliquez-moi ? »
- Enchaîner les questions trop vite : C’est l’erreur type du débutant, qui enchainer les questions sans respirer. Il faut y faire très attention, car ça va complètement stériliser l’entretien. L’utilisateur va vous donner des réponses de plus en plus courtes. Il aura l’impression que vous ne l’écoutez pas et que c’est interrogatoire de police. Donc prenez le temps entre chaque question de noter la réponse, de laisser l’utilisateur préciser, de relancer avec une petite approbation (« d’accord », « et… », hochement de tête). C’est pas la course, pensez à boire entre deux questions, voilà tranquillement…
- Utiliser un jargon Que ce soit des abréviations ou des termes trop techniques ou militants, il faut être sûr d’être compris par l’utilisateur. Donc il faut éviter d’employer tout jargon. Au contraire, si l’utilisateur utilise un de ces termes, vous pouvez lui demande quel sens il lui donne ? Ça peut être un sens différent de celui que vous utilisez et il peut apporter des nuances pertinentes.
- Éviter les questions fermées « Vous faites des listes de courses ? » « oui » Les questions fermées vont apporter des réponses courtes qui ne sont pas forcément intéressantes. Il faut privilégier les questions les plus ouvertes possible afin de favoriser le dialogue.
Mais n’oubliez pas l’immense majorité des entretiens se passent très bien. Les utilisateurs en ressortent content de vous avoir aidés sur un sujet qui les concerne.
À retenir
Les entretiens exploratoires sont une phase clef pour commencer un nouveau projet ou aborder une nouvelle thématique.
- Neutre et bienveillant sont les maîtres-mots de la relation aux utilisateurs. À Tout moment le code de conduite de l’UXPA, tu respecteras.
- Faire une check-list des différents points que vous devez préparer avant, pendant et après les entretiens.
- Faites table rase de vos a priori, les utilisateurs vont agréablement vous surprendre par leurs habitudes, leurs idées, leurs besoins. Ça va très bien se passer !
Références
- Code de conduite de l’UXPA en PDF
Connaître les utilisateurs 8 Jun 2021 7:40 AM (4 years ago)
Dans ce chapitre, je propose de découvrir comment mieux connaître les utilisateurs pour qui vous concevez et comment restituer cela sous différentes formes qui soient utilisables et compréhensibles par les différents acteurs d’un projet.
Afin de vous proposer une progression cohérente sur l’ensemble de ce chapitre, je vous propose de travailler sur le cas décrit ci-dessous. Il a l’avantage d’être simple à comprendre avec des utilisateurs faciles à trouver, mais pouvoir présenter pas mal de nuances quand on gratte un peu.
Je vais parler d’utilisateur pour les personnes interviewées et de designers pour les personnes qui font passer les entretiens. Pour la suite, le terme de designers sera utilisé pour identifier « ceux qui font » en l’occurrence vous ou vos collègues.
Étude de cas : Liste des courses
Contexte
Votre agence travaille pour une enseigne de la grande distribution (Ex : Leclerc, Carrefour, Intermarché). Cette enseigne dispose de magasins de différentes tailles allant d’hypermarchés au magasin de proximité en passant par le Drive et bien sûr le site internet. Elle souhaite fournir à ses clients un service autour de la liste des courses. L’enseigne avait déjà fait un travail préalable sur la liste des courses, mais ça, c’est relevé être un échec et l’idée a été abandonnée provisoirement. Votre agence vous demande de travailler « en amont » sur le sujet pour proposer une expérience utilisateur cohérente autour de la liste des courses et d’éviter un nouvel échec. L’objectif est de proposer quelque chose de cohérent aux utilisateurs d’ici un an.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer une variante « sans emballage », en remplaçant Leclerc par Biocoop, ou comment préparer ses courses en minimisant les emballages et donc les déchets ?
Les infos
Les quelques informations que sont capables de vous fournir le chef de projet et le marketing sont les suivantes :
- Le marketing souhaite une présence forte des promotions sur les produits et des bons de réductions « dès la page d’accueil »
- L’enseigne garde un historique sur deux ans de l’ensemble des achats des clients.
- Les produits disponibles dans les différents magasins ne sont pas les mêmes. Les drives présentent moins de produits que les hypermarchés, mais plus que les magasins de proximités.
Ces informations sont très limitées et partiales, il est donc nécessaire que vous trouviez vos propres sources d’information sur les usages des listes de courses.
Travail à réaliser
Le but du projet est donc de réaliser un travail de recherche utilisateur en amont et d’en déduire des pistes conceptions à présenter sous la forme de wireframes, de schéma ou de story-board (situation d’usage illustrée). Il n’est pas demandé de réaliser un site ou une app en entier mais simplement d’esquisser les interactions possibles.
Vous pourrez réaliser notamment, mais pas exclusivement
- Des entretiens avec les utilisateurs,
- Des persona,
- Une expérience map,
- Des pistes de conceptions (sous la forme wireframes ou autres)
Les erreurs à ne pas commettre !
- Le formulaire est une solution de facilité pour connaître les usages. Ça ne peut pas être la seule méthodologie de recherche, car les utilisateurs ne font que répondre aux questions que vous posez.
- Ne concevez pas une app mobile. Ce n’est pas ce qui est demandé. Il faut intégrer la liste des courses dans un écosystème déjà existant (Site web, Magasin, drive, app mobile,…). Il faut penser au service à rendre et non en termes d’interface.
Une synthèse en vidéo
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de beta.gouv.fr. Elle permet d’avoir une vue globale sur la passation des entretiens.